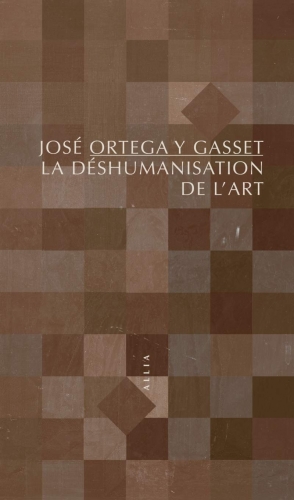Alain de Benoist : « La violence peut être parfois condamnable, mais je ne la condamne pas par principe ! »
Aujourd’hui, toute action politique peut se trouver disqualifiée, en termes médiatiques s’entend, dès lors qu’elle en vient à s’exprimer de façon violente, que cette violence soit réelle ou supposée. C’est donc l’effet qui se trouve condamné, et non point la cause. Angélisme ou cynisme ?
Je dirais plutôt : « mécompréhension ». La condamnation sans nuances de la violence est le fait, d’une part, des pacifistes, qui se retrouvent du même coup condamnés à « faire la guerre à la guerre », position inconfortable, d’autre part, de l’éternel parti bourgeois, acquis aux idées libérales, qui s’imagine que la discussion, la négociation, le compromis, voire le « doux commerce », peuvent toujours permettre d’éviter l’affrontement. Les maîtres de l’idéologie dominante capitalisent sur cette condamnation inconditionnelle de la violence pour se prémunir contre les insurrections qu’ils redoutent. Mais une telle attitude est irréaliste. La violence est un caméléon. Non seulement elle est omniprésente et protéiforme, mais elle n’apparaît pas toujours comme telle. Elle est partout, même là où on ne la voit pas.
À la violence ouverte, explosive, s’ajoute la violence structurelle, systémique et virale. La dérégulation libérale est une violence, le conditionnement publicitaire, la propagande de la pensée unique, l’esclavage du salariat, les aliénations dont le monde moderne est le lieu, la mondialisation elle-même, sont autant de formes de violence. La politique s’apparente elle aussi à la guerre dans la mesure où son critère essentiel est la distinction de l’ami et de l’ennemi. En politique, seul est souverain celui qui décide, et la décision est également une façon de mettre un terme aux parlotes et aux palabres.
« Une planète définitivement pacifiée », écrit Carl Schmitt, « serait un monde sans politique. » Le droit lui-même ne peut être instauré et garanti que par un rapport de force. Quant aux révolutions, inutile de rappeler qu’elles n’ont jamais été des promenades de santé. Il n’y a tout simplement pas de vie en société sans la possibilité d’une violence.
La violence, je la condamne personnellement souvent, je dirais même le plus souvent, surtout quand elle est gratuite, stupide et contre-productrice, mais je ne la condamnerai jamais par principe. Tout dépend des circonstances et du contexte. Dans les affaires humaines, il ne faut jamais se prononcer sur des abstractions, qu’il s’agisse de la violence (à quelle fin s’exerce-t-elle ? Par quels moyens ?), de l’immigration (qui immigre ?) ou de l’avortement (qui avorte ?). Toutes les violences ne sont pas destructrices. Elles peuvent aussi être fondatrices. Pendant la guerre, tous les mouvements de résistance ont fait usage de la violence. À l’époque de la décolonisation, tous les mouvements de libération en ont fait autant – et avec succès.
Une formule canonique, attribuée à Max Weber, réserve à l’État le « monopole de la violence légitime ». Quand on voit l’état actuel des choses, ne peut-on pas dire que l’État a depuis longtemps perdu ce monopole ?
Notons d’abord qu’on ne peut prétendre avoir le monopole de la violence légitime qu’aussi longtemps qu’on est soi-même légitime. La notion de légitimité est donc centrale, dans cette affaire. Un gouvernement, même régulièrement élu, peut perdre sa légitimité de bien des façons. Il n’est a priori légitime qu’à la condition de servir le bien commun en assurant la paix à l’extérieur et la concorde à l’intérieur. Face à une autorité devenue illégitime, à un État qui ne fait plus son travail, à des dirigeants qui ne se préoccupent plus que de leurs seuls intérêts, le contrat social est rompu et les citoyens doivent prendre leurs responsabilités car, comme l’observe Éric Werner (Légitimité de l’autodéfense), « il est bon en soi de se défendre ».
Bien entendu, une déclaration d’illégitimité peut être tout à fait arbitraire et injustifiée, j’en suis bien conscient. Mais ce qu’il faut retenir est que, contrairement à ce que prétend le positivisme juridique, la légalité et la légitimité ne sont pas synonymes. D’où l’éternel combat d’Antigone contre Créon.
Aujourd’hui, le « monopole » dont parlait Weber est effectivement partout battu en brèche. Nombre de guerres opposent désormais acteurs étatiques et non étatiques. Ce n’est pas nouveau : Clausewitz donnait déjà le nom de « petite guerre » à la guerre de partisans, à laquelle se rattache également le terrorisme. Violences sur la voie publique, violences sexuelles, violences conjugales, la violence brutale est partout : elle éclate dans la rue, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les transports. Dans certaines banlieues, elle est devenue un mode de vie. Cela signifie qu’aux yeux d’un nombre croissant d’individus, elle devient acceptable. Face à cette violence, les « appels à la raison » ne peuvent que tomber dans le vide. Seule la force peut briser la force.
Quid de la violence que l’on a vue s’exprimer en marge du mouvement des gilets jaunes ?
Il ne faut pas s’y tromper, la violence qui s’est révélée lors des manifestations des gilets jaunes a d’abord été la violence étatique. Les forces de police n’ont pas été chargées de maintenir l’ordre mais de faire de la répression. Elles l’ont fait avec une violence dont on n’avait pas vu l’équivalent depuis la guerre d’Algérie – et dont les pouvoirs publics n’ont jamais fait usage à l’encontre des racailles des banlieues. Bien des gilets jaunes ont subi de véritables blessures de guerre : mains arrachées, yeux crevés, visages défigurés. Au total, 2.200 blessés parmi les manifestants, dont plus de 200 blessures à la tête, sans oublier les procès devant les tribunaux, là encore beaucoup plus sévères qu’avec les voyous et les bandits : 1.800 condamnations, 1.300 comparutions immédiates, 300 incarcérations. À cela s’est ajoutée la violence provocatrice des Black Blocs qu’il était parfaitement possible d’enrayer, mais qu’on a objectivement encouragée pour discréditer le mouvement. Enfin, il y a eu des actes de violence de la part des gilets jaunes qui, eux, ont au moins servi à faire reculer le gouvernement. S’ils étaient allés plus loin, il aurait peut-être reculé plus encore. Ce n’est, en tout cas, pas moi qui vais pleurer sur l’incendie du Fouquet’s !
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 4 décembre 2019)