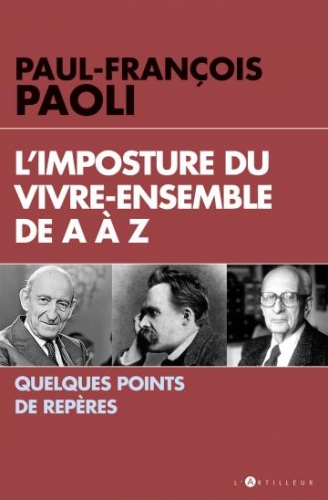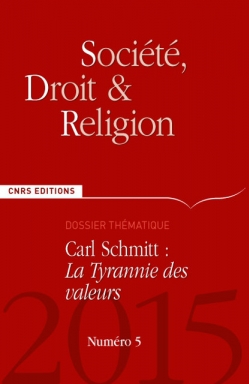"En raison de la la présence en France de près de quatre millions et demi de travailleurs immigrés et de membres de leur familles, la poursuite de l’immigration pose aujourd’hui de graves problèmes. Il faut les regarder en face et prendre rapidement les mesures indispensables.
La cote d’alerte est atteinte. (…) C’est pourquoi nous disons : il faut arrêter l’immigration, sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage.
Je précise bien : il faut stopper l’immigration officielle et clandestine.
Il faut résoudre l’important problème posé dans la vie locale française par l’immigration.
Se trouvent entassés dans ce qu’il faut bien appeler des ghettos, des travailleurs et des familles aux traditions, aux langues, aux façons de vivre différentes.
Cela crée des tensions, et parfois des heurts entre immigrés des divers pays. Cela rend difficiles leurs relations avec les Français.
Quand la concentration devient très importante (…), la crise du logement s’aggrave.
Les HLM font cruellement défaut et de nombreuses familles françaises ne peuvent y accéder. Les charges d'aide sociale nécessaires pour les familles immigrées plongées dans la misère deviennent insupportables pour les budgets des communes."
Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, dans L'Humanité du 6 janvier 1981

"Ce n'est pas tant l'Europe qui est fatiguée, ou vieille (selon un fantasme américain), que nous, esprits libres, qui sommes las de ce que l'Europe est devenue par son américanisation : non pas une poubelle ethnique, comme certains le soutiennent avec excès, mais, au contraire, un espace de disneylandisation ethnique, Disneyland n'étant pas seulement un parc d'attraction mais le modèle du « parc humain » de l'avenir, où l'esprit est mis à mal par le divertissement et le spectacle : Disneyland comme résurgence hédoniste des camps de concentration, en même temps que superstition née de la peur du vide. Cette intransigeante gestion de la sous-culture dominante nous en dit plus que bien des traités sur ce que nous sommes appelés à devenir."
Richard Millet, Fatigue du sens (Pierre-Guillaume de Roux, 2011)

"Quand le terrestre – le matériel – ne dispose plus d’une vocation propre à l’élever quelque peu au-dessus du sol et que son niveau ne dépasse guère celui des pâquerettes, les mots cultes tels "humanisme" ou "droits de l’homme" commencent à sonner singulièrement creux. La morale, démonétisée, n’a plus vraiment cours et l’on espère seulement que les poncifs médiatiques habituels feront illusion. Le langage, à son tour, se corrompt. A quoi se réduit alors la politique ? A la gestion empirique, au jour le jour, au coup par coup. Le critère est la réussite : quel que soit son objet, quels que soient les moyens, la fin les justifie. L’étrange est que les politiciens pour qui tout se mesure en productivité, statistiques et rentabilité, n’aient pas abandonné les cérémonies et symboles évoquant d’autres temps. On n’aura jamais autant salué le général de Gaulle en commémorations que depuis l’abandon de toutes ses leçons. On n’aura jamais autant invoqué ses principes depuis qu’ils sont tellement oubliés. Ont-ils une telle peur du vide ceux qui se travestissent en des servants d’un culte qu’ils ne professent plus ? Quand le vertige les saisit, ils parlent des valeurs qu’il convient de maintenir ou même de restaurer. L’ennui est qu’ils en parlent comme de valeurs boursières, en suivent leur cote dans l’opinion et ses fluctuations, en fonction de quoi ils en déterminent l’importance."
Marie-France Garaud, Impostures politiques (Plon, 2010)

"Tant qu'on n'aura pas compris que les droits de l'homme ne peuvent être qu'une conséquence des droits des peuples, les droits des peuples à exister, à perdurer, à avoir leur terre, leur langue, leur autonomie, leur identité, leurs mœurs, leur façon d'écrire l'histoire et ainsi tout simplement leur avenir, on ne fera jamais avancer concrètement les droits humains. Car l'homme concret appartient à un peuple. C'est par la mise en oeuvre des droits des peuples – le droit notamment de contrôler leurs ressources-, de s'émanciper de la dictature mondiale des marchés, de l'empire de la finance – que les droits humains peuvent être pris en compte. L'homme est d'abord un être social, un être en communauté, un être politique."
Pierre Le Vigan, La tyrannie de la transparence (L'Aencre, 2011)

"[...] BHL est certainement le modèle même du « faussaire », le maître absolu, le mètre étalon. Il a créé le prototype et en a fait une référence. [...] Il a bâti sa carrière en maniant sans vergogne le mensonge. Pour autant, il se présente comme l'archétype de l'intellectuel pesant sur la vie des idées et montrant par son engagement un dévouement désintéressé et sans limite pour les causes les plus nobles.
BHL passe pour un intellectuel éclairant le public alors que c'est un désinformateur. Il passe pour quelqu'un de profondément engagé en faveur de la morale alors que c'est le cynisme même. Il passe pour un défenseur intransigeant de la liberté alors que c'est un maccarthyste virulent. Il passe pour un universaliste alors que c'est un communautariste forcené."
Pascal Boniface, Les intellectuels faussaires (Jean-Claude Gawsewitch, 2011)

"Grâce à Internet, c’est la première fois que l’on voit la société à l’état brut. Sans la mince couche de civilisation qui fait que les relations humaines restent correctes. La violence sur le Net est extraordinaire. C’est l’état primitif de la vie ! C’est le point ultime de la modernité qui nous montre l’état primitif de la société. C’est fascinant. La société sophistiquée peut voir ce qu’elle serait sans sa sophistication.[...] Et cela me rend partisan du suffrage censitaire..."
Alain Minc, dans un entretien donné à Paris Match (28 septembre 2010)

"Il s'est constitué à cette occasion dans la société française une superclasse dirigeante dont, pour parler comme le sociologue Pierre Bourdieu, la droite constitue la fraction dominante et la gauche, la fraction dominée, mais qui, en toute occasion, défend avec âpreté ses intérêts propres, transcendants par rapport aux péripéties de la démocratie électorale. C'est d'elle que je disais ici même, il y a quinze jours, qu'elle fait régner une connivence de tous les instants entre la banque, les affaires, l'administration, le barreau, la politique, le journalisme, parfois les arts, l'université, l'édition ...
Si vous ne me croyez pas, allez faire un tour, à condition que l'on vous laisse entrer, à l'Automobile Club de France (hôtel Crillon), place de la Concorde, un soir où Le Siècle, le club de cette superclasse dirigeante, se réunit pour dîner. A défaut, vous verrez au moins les chauffeurs des limousines noires qui attendent patiemment la sortie de leurs maîtres. A l'intérieur, des hommes en costume gris et quelques femmes en tailleur sobre échangent des opinions, des adresses, des tuyaux, des services, parfois des fonctions, des positions sociales, voire des amants ou des maîtresses. Dans ce milieu fermé où les socialistes ont leur place à côté des gros bataillons de la droite française, fermente l'idéologie de la classe dominante: modernisme discret, bien-pensance sociale et culturelle, conformisme économique, respect absolu de la puissance de l'argent. La pensée unique, comme dit Jean-François Kahn, est là, et bien là. Il existe, derrière les apparences successives des combinaisons ministérielles, un gouvernement de facto, un gouvernement invisible des élites financières et institutionnelles, qui à défaut de dicter sa loi, fournit la pensée et inspire l'action des élites françaises."
Jacques Julliard, dans l'article DSK, la gauche et l'argent, publié dans Marianne (4 au 10 juin 2011)