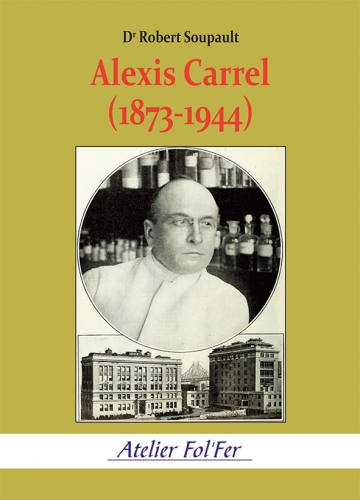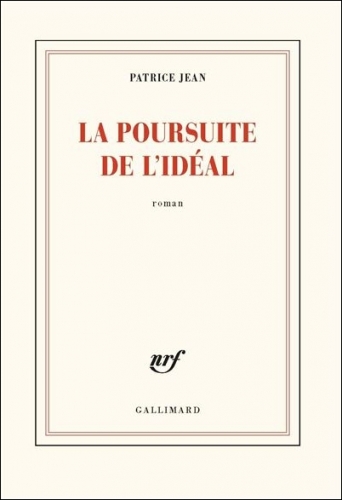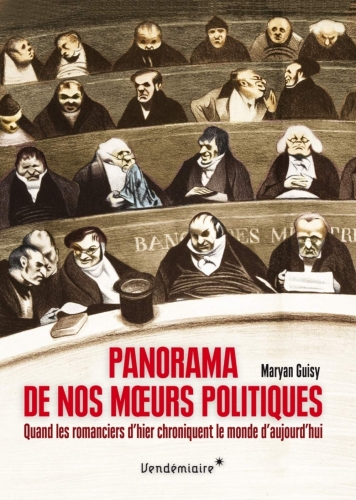Marin de Viry: «Le tourisme est une des modalités de destruction de la vie intérieure»
FIGAROVOX. - Vous écrivez dans Tous touristes: «Si le monde est un vaste dance floor sans frontières, quel sens a le mot tourisme?». Pouvez-vous expliquer ce paradoxe? La mondialisation, en tuant la possibilité d'un «ailleurs» par l'uniformisation du monde, aurait-elle tué le tourisme?
Marin DE VIRY. - Le tourisme n'a plus rien à voir avec ses racines. Quand il est né au XVIIIe siècle, c'était l'expérience personnelle d'un homme de «condition», un voyage initiatique au cours duquel il devait confronter son honneur - c'est-à-dire le petit nombre de principes qui lui avaient été inculqués - à des mondes qui n'étaient pas les siens. Il s'agissait de voir justement si ces principes résisteraient, s'ils étaient universels. Un moyen d'atteindre l'âge d'homme, en somme. Le voyage, c'était alors le risque, les accidents, les rencontres, les sidérations, autant de modalités d'un choc attendu, espéré, entre le spectacle du monde et la façon dont l'individu avait conçu ce monde à l'intérieur de sa culture originelle. Au XIXe, tout change: le bourgeois veut se raccrocher à l'aristocrate du XVIIIe à travers le voyage, qui devient alors une forme de mimétisme statutaire. Le bourgeois du XIXe siècle voyage pour pouvoir dire «j'y étais». C'est ce qui fait dire à Flaubert lorsqu'il voyage avec Maxime Du Camp en Égypte: mais qu'est-ce que je fais ici? - C'est-à-dire qu'est-ce que je fais à me prendre pour un aristocrate du XVIIIe siècle-? Avec l'époque contemporaine, on a une totale rupture du tourisme avec ses racines intellectuelles. Même chez ceux qui aujourd'hui veulent renouer avec le voyage, pour s'opposer au tourisme de masse, il n'y a plus de profonde résonance, de profond besoin, car le monde est connu, et le perfectionnement de leur personne ne passe plus forcément par le voyage. Là où le voyage était un besoin, au XVIIIe, pour devenir un homme, se former, parachever son âme et son intelligence, il devient quelque chose de statutaire au XIXe, puis une simple façon de «s'éclater» aujourd'hui. C'est devenu une modalité de la fête permanente, laquelle est devenue banale. Le monde est ennuyeux parce qu'il est le réceptacle de la fête, devenue banale. Solution: il faut «rebanaliser» le monde et débanaliser la fête.
Dans notre monde globalisé, est-il encore possible de voyager?
Toute la question est de savoir s'il reste des destinations ouvertes à la curiosité. Or, plus elles sont organisées, balisées par le marketing touristique de la destination, moins elles sont ouvertes à la curiosité. L'exemple du musée Guggenheim à Venise est éclairant. Je l'ai connu avant qu'il ne soit aseptisé, on avait l'impression de visiter en catimini une maison privée, comme si Peggy Guggenheim l'avait quitté la veille, c'est tout juste s'il n'y avait pas un œuf à la coque encore tiède dans la salle à manger. Dans sa version actuelle, avec des faux plafonds traités par des architectes néo-suédois et une signalétique d'aéroport, la curiosité ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'on articule ce qu'on est avec ce qu'on voit, c'est que ce que l'on voit n'est pas préparé, organisé de façon à produire une impression prédéterminée. De la même manière dans les musées, les panneaux explicatifs à côté des œuvres ont pris une importance incroyable. Il est devenu impossible d'avoir un regard spontané, vierge, ouvert sur les œuvres, bref de les regarder vraiment, en prenant le risque d'être désorienté et renvoyé à son absence de culture.
Les dispositifs marketing et commerciaux des destinations ont tué toute possibilité de l'ailleurs, toute curiosité. Pour être un touriste authentique, désormais, c'est dans le quotidien, dans la banalité du réel, qu'il faut se promener. Pour être dépaysé, il faut aller visiter la réalité, des usines, des champs, des bureaux. Le tertiaire marchand est devenu authentiquement exotique. D'une façon générale, le monde réel est plus exotique que le monde touristique définitivement balisé.
Cette perte de sens n'est-elle pas due tout simplement à la démocratisation du voyage et à l'avènement du tourisme de masse qui fait perdre toute prétention intellectuelle au voyage?
Je vais être néo-marxiste, mais je crois que c'est le salariat, plus que la démocratisation, qui change tout. Les congés payés font partie du deal entre celui qui a besoin de la force de travail et celui qui la fournit. À quoi s'ajoute la festivisation, qui est d'abord la haine de la vie quotidienne. Et il est convenu que la destination doit être la plus exotique possible, car la banalité de la vie quotidienne, du travail, est à fuir absolument. Au fur et à mesure de l'expansion du monde occidental, la fête se substitue à la banalité, et la banalité devient un repoussoir. Il n'y a pas d'idée plus hostile à la modernité que le pain quotidien.
Autour de ce deal s'organise une industrie qui prend les gens comme ils sont, individualisés, atomisés, incultes, pas curieux, désirant vivre dans le régime de la distraction, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire le désir d'être hors de soi. Le tourisme contemporain est l'accomplissement du divertissement pascalien, c'est-à-dire le désir d'être hors de soi plutôt que celui de s'accomplir. Promener sa Game boy à 10 000 kilomètres de la maison, si ce n'est pas s'oublier, qu'est-ce c'est?
Où, quand et par qui est inventé le tourisme de masse?
C'est Thomas Cook qui invente le tourisme de masse. Cet entrepreneur de confession baptiste organise, en juillet 1841 le premier voyage collectif en train, à un shilling par tête de Leiceister à Loughborough, pour 500 militants d'une ligue de vertu antialcoolique. C'est la première fois qu'on rassemble des gens dans une gare, qu'on les compte, qu'on vérifie s'ils sont bien sur la liste, qu'on déroule un programme. Les racines religieuses puritaines ne sont pas anodines. Il y a comme un air de pèlerinage, de communion collective, dans le tourisme de masse. Le tourisme est très religieux. Et il y a en effet quelque chose de sacré au fait de pouvoir disposer de la géographie du monde pour sortir de soi. S'éclater à Cuba, c'est une messe!
Vous essayez dans votre livre de ne pas tomber dans la facilité qui consiste à opposer «bons» et «mauvais touristes», les ploucs contre Paul Morand, les touristes sexuels de Houellebecq contre les voyages de Stendhal. Est-ce à dire pour autant qu'il n'y a pas de bons touristes?
Les poulets de batterie, je veux dire les touristes de masse, ont une âme. Faire une distinction entre un globe-trotter qui fait du «tourisme éthique» et un hollandais en surcharge pondérale et en tongs qui ahane à Venise, c'est d'une goujaterie incroyable vis-à-vis du genre humain. C'est pourquoi je déteste le livre Venises de Paul Morand: c'est un bourgeois du XIXe qui essaie d'imiter l'aristocrate du XVIIIe en crachant sur le peuple du XXe, alors qu'il est moralement inférieur à lui.
Comme l'homo «festivus festivus» décrit par Muray, qui «festive qu'il festive» et «s'éclate de s'éclater» le touriste moderne se regarde voyager, et il ne semble voyager que pour vérifier que ce qu'il a lu dans son guide est bien réel et pour «prendre des photos». Que vous inspire cette dimension spectaculaire du tourisme?
Nous sommes dans la culture de l'éclate, de la distraction permanente, sans aucune possibilité de retour sur soi. Le monde moderne est une «conspiration contre toute espèce de vie intérieure», écrivait Bernanos. Je crois que le tourisme est une des modalités de destruction de la vie intérieure.
Prenons l'exemple du «syndrome de Stendhal». Stendhal s'est senti mal à force de voir trop de belles choses à Rome et à Florence. Trop de beauté crée un état de sidération, puis de délire confusionnel: en Italie, on est souvent submergé par le superflu. C'est l'expérience limite de la vie intérieure: la beauté vous fait perdre la raison. C'est exactement le contraire que vise l'industrie touristique, qui cherche à vendre la beauté par appartements, en petites doses sécables d'effusions esthétiques marchandisées. Elle ne veut pas que ses clients abdiquent leur raison devant la beauté, mais qu'ils payent pour le plaisir. Immense différence.
Pourquoi faites-vous du romantisme le terreau idéologique du tourisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui?
Lamartine écrit Graziella en 1852. C'est l'histoire du tour en Italie complètement raté d'un jeune aristo français. Quand un jeune homme du XVIIIe siècle (car Lamartine appartient encore au XVIIIe, ou en tout cas le voudrait) va tester son honneur de par le monde pour le renforcer, il doit en revenir plus fort, raffermi dans ses principes. Mais Lamartine tombe amoureux d'une jeune fille de 16 ans en Sicile, qu'il n'a pas le courage d'épouser pour des raisons sociales, car elle est fille de pêcheur, et lui d'un comte. Lamartine revient à la niche à l'appel de sa mère et Graziella meurt de chagrin. Le romantisme, c'est l'histoire d'un voyage raté. L'ailleurs devient le lieu, où, au lieu de se trouver, on se perd. L'expérience de la découverte de soi dans le voyage devient une expérience malheureuse. Donc, il faut se venger du voyage en lui interdisant de devenir une expérience intérieure. Les générations suivantes ont parfaitement compris le message.
Dans La Carte et le territoire, Michel Houellebecq décrit une France muséale, paradis touristique, vaste hôtel pour touristes chinois. Est-ce là le destin de la France?
Dans un éditorial, Jacques Julliard écrivait que la France avait 60% de chances de finir dans un scénario à la Houellebecq, 30% de chances de terminer selon le scénario de Baverez, et 10% de chances de finir autrement. Je ne suis pas totalement dégoûté par le scénario de Houellebecq. C'est une France apaisée, bucolique. On retournerait tous à la campagne pour accueillir des cohortes d'Asiatiques et de Californiens. On leur expliquerait ce qu'est une église romane, une cathédrale, une mairie de la IIIème République, un beffroi. Ce serait abandonner notre destin pour se lover dans un scénario tendanciel dégradé mais agréablement aménagé, et nous deviendrions un pays vitrifié plutôt qu'un pays vivant. Nous aurions été détruits par la mondialisation, mais notre capital culturel nous sauverait de l'humiliation totale: on nous garantirait des places de médiateurs culturels sur le marché mondial. Si on pense que Dieu n'a pas voulu la France, ou que l'histoire n'a pas besoin de nous, on peut trouver ça acceptable.
Marin de Viry, propos recueillis par Eugénie Bastié (Figaro Vox, 17 août 2017)