L'historienne Mona Ozouf, spécialiste de la Révolution, a récemment publié Composition française - Retour sur une enfance bretonne aux éditions Gallimard, un livre de souvenirs et de réflexion sur l'identité de la France, identité faite d'une tension entre l'esprit national et le génie des pays qui la composent. La revue Eléments a rendu compte de cet ouvrage sous la plume de Fabrice Valclérieux.
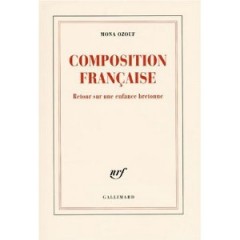
Les trois écoles de Mona Ozouf
Agrégée de philosophie, Mona Ozouf devint historienne sous l’influence de son mari Jacques Ozouf (auteur notamment de Lire et écrire : l'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry) et de son condisciple à l’École normale supérieure, François Furet. Après un premier livre sur L’École, l’Église et la République. 1871-1914 (1962), elle fera paraître La Fête révolutionnaire, 1789-1799 (1976), puis L'École de la France. Essai sur la Révolution, l'utopie et l'enseignement (1984). Elle dirigera ensuite avec F. Furet le monumental et magistral Dictionnaire critique de la Révolution française publié en 5 volumes de 1988 à 1993 (« Idées », « Acteurs » « Événements », « Institutions et créations » « Interprètes et historiens »). Sa fascination pour « [cette] énigme, [cette] rupture dans le tissu de l’Histoire » (*) que fut la Révolution ne l’empêchera pas d’aborder dans la suite de son œuvre des thèmes comme Les Mots des femmes. Essai sur la singularité française (1995), Les Aveux du roman. Le XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolution, (2001), ou encore Jules Ferry (2005).
Dans un registre à la fois semblable et très différent, elle a publié il y a quelques mois Composition française. Retour sur une enfance bretonne, un essai sur ses « souvenirs d’enfance et de jeunesse » à Plouha, un bourg des Côtes d’Armor, en même temps qu’un ensemble de réflexions sur la France et ses régions, sur son unité et sa diversité, au sens, bien sûr, où l’entendait Fernand Braudel.
Le fil rouge de la partie mémorielle du livre est une phrase de l’avant-propos : « Dans ma corbeille de baptême, les croyances [ont été] déposées par trois fées qui ne s’aimaient guère, l’école, l’église et la maison ». Toutes trois vont structurer les années d’apprentissage de la jeune Mona. Elle a quatre ans lorsque son père, instituteur, militant de la cause bretonne, pacifiste et antimilitariste meurt brutalement. Tôt affirmé « patriote breton », contre son milieu familial et contre l’École normale d’instituteurs « foyer d’impérialisme français », il adhéra à divers groupes autonomistes, dont le Parti national breton, tout en se réclamant de la gauche, soit, selon sa fille, « un socialiste nationaliste breton, espèce improbable ». Son rêve : « Une Bretagne autonome dans une France fédérée ». Devenu Yann ar scholaer (Jean le maître d’école), il crée un journal, Ar Falz, qui milite en particulier pour la défense de la langue bretonne. Entre-temps, il épouse une jeune finistérienne qui va embrasser sa cause et militer avec lui. Devenue veuve, elle éleva l’enfant en compagnie de sa mère venue s’installer chez eux. En cette grand-mère, se souvient Mona. Ozouf, tout parlait de l’identité bretonne, notamment la langue, « vigoureuse, expressive, anthropomorphique » mais en même temps « elle était, elle se savait française ».
Pour la jeune Mona, il y a trois écoles. D’abord « l’école de la Bretagne » représentée par la bibliothèque de son père : dictionnaires et grammaires de breton, histoires de Bretagne, livres qui expriment si bien le « génie celtique », comme le Barzaz Breiz, l’Iliade de Bretagne, ceux d’Anatole le Braz, de Charles Le Goffic et de Roparz Hémon, puis ceux venus d’Irlande « notre seconde patrie » (Synge, Yeats, O’Flaherty), enfin les « grands Bretons », Lamennais, Chateaubriand, Renan…
Ensuite c’est « l’école de la France », en l’occurrence l’école laïque de Plouha où elle est élève, celle de « l’égalité sur les bancs », mais où le classement récompense « nos seuls mérites et notre seul travail », celle aussi hélas « où l’on oublie d’où on vient », qui est indifférente, sinon hostile aux singularités bretonnes. Ce reproche n’empêche cependant pas l’auteur de L’École, l’Église et la République d’exprimer une vibrante défense et illustration des instituteurs de l’école de la République qui s’efforçaient de faire connaître « les coutumes et les savoirs locaux », en se faisant « ethnologues des terroirs, [en] recueillant les chansons, les proverbes, les mille et une façons de vivre et de mourir… ».
Il y a enfin « l’école de l’Église », celle de sa grand-mère qui décide de lui apprendre « ses » prières le jour de ses cinq ans, puis celle du catéchisme où elle découvre l’existence des enfants de l’école religieuse du village qui représente pour elle « le lieu de l’inégalité ». A l’église, un prêtre lui enseigne, en pratiquant une « pédagogie de la peur », une religion formaliste, froide et roide, « sans rien ou presque qui donnât à rêver ».
De fait, la jeune Bretonne devait vivre « trois lots de croyance : la foi chrétienne de [ses] ancêtres, la foi bretonne de la maison, la foi de l’école dans la raison républicaine », croyances qui composaient sa « tradition » et qui souvent s’ignoraient. « L’école, au nom de l’universel, ignorait et en un sens humiliait la particularité. Et la maison, au nom des richesses du particulier, contestait l’universel de l’école ». Par ailleurs, les mots liberté et égalité n’avaient pas la même signification pour l’école et la maison. Pour l’école, c’était la liberté « par l’abstraction des différences », pour la maison c’était la liberté d’un groupe particulier (les Bretons). Quant à l’égalité, c’était à l’école celle de la ressemblance, tandis qu’à la maison c’était celle du droit à affirmer sa différence. Toutefois, bien qu’elles s'ignorassent la maison et l’école vivaient toutes deux « dans la religion, du mérite et croyaient à la possible correction des inégalités ».
Après l’école primaire viennent les années de collège où peu à peu la spécificité bretonne s’éloigne et où « l’idéologie de l’école républicaine » prend le pas sur celle de la maison. Elève du collège Ernest Renan de Saint-Brieuc à partir de 1941, elle a comme professeur la femme de Louis Guilloux, l’auteur du Sang noir, qu’elle rencontre et qui devient pour elle un « indicateur de lectures ». Dans cet établissement « national », elle continue d’exprimer son « allégeance » à « la matière de Bretagne » ce qui lui vaut, à treize ans, d’être accusée par la directrice d’avoir constitué un réseau Sinn Fein au collège !
Les années suivantes au lycée représentent le temps du « ralliement à l’universel ». Après une hypokhâgne à Rennes, elle rompt les amarres avec la Bretagne et la « fidélité celtique » pour le Paris de la khâgne, de la Sorbonne, de l’École normale supérieure, et du Parti communiste auquel elle adhère en 1952 après la manifestation du 23 mai contre le général Ridgway. Adhésion qu’elle justifie d’une part par la fidélité à son père qui savait gré à « la patrie soviétique » de pratiquer, croyait-il, une « généreuse politique des minorités », et d’autre part par la sécurité intellectuelle et affective que le PC était censé apporter à des jeunes gens épris de justice et avides de solidarité. Mais la brillante normalienne devait vite déchanter : fin 1952, c’était à Prague la condamnation à mort de Slansky, début 1953 le « complot des blouses blanches », la mort du « Grand Staline » (L’Humanité du 18 mars), en juin, les émeutes ouvrières de Berlin-Est ..., autant d’événements qui lui ouvrent les yeux sur la réalité du « socialisme scientifique ». Elle quittera le Parti après la répression de l’insurrection hongroise de 1956.
Au-delà des vicissitudes de l’engagement politique, les années d’étudiante qui la mèneront à l’agrégation de philosophie s’achèvent sur le constat que « la foi de l’école semblait l’avoir emporté décisivement sur celle de la maison, l’idéologie française sur les attaches bretonnes ». Cette victoire de « l’universalité française » sur « la particularité bretonne » va conduire la jeune agrégée à entreprendre des recherches sur l’école républicaine, « temple neuf d’une humanité affranchie de Dieu, le lieu où on professe la perfectibilité indéfinie et la prise de l’homme sur son destin », puis à s’attaquer, seule ou avec François Furet, au monument de la Révolution française. A ce moment du récit, le livre bascule dans une dernière partie plus théorique, consacrée à la « composition française », c'est-à-dire à la « tension entre l’universel et le particulier ». A travers l’évocation de l’Ancien Régime où l’unité du roi permettait à la diversité du pays de se manifester, puis de la Révolution qui visait à la résorption de la diversité dans l’unité, enfin de la Troisième République qui proclamait avec Jules Ferry qu’il faut « refaire à la France une âme nationale », Mona Ozouf illustre les deux conceptions antithétiques de l’appartenance collective des Français : celle de Julien Benda, « la France est la revanche de l’abstrait sur le concret », et celle d’Albert Thibaudet, « La France est un vieux pays différencié ». Cette tension toutefois s’est relâchée avec l’assouplissement du modèle jacobin et le fait que la République s’est enracinée en prenant appui sur les singularités locales, comme le montre le Tableau de la géographie de la France de Vidal de la Blache dans lequel la diversité française n’est pas une menace, mais une chance. « Cette articulation heureuse du local et du national sous le signe de l’harmonie [se] retrouve dans l’enseignement dispensé par l’école républicaine ». Une exception cependant à ce tableau apaisé : le sort réservé aux langues régionales (que l’abbé Grégoire dénonçait comme « le fédéralisme des idiomes »), pourchassées sous la IIIe République et aujourd’hui encore contestées. A preuve le refus par le Conseil constitutionnel en 1999 de ratifier la signature de la Charte européenne des langues régionales, et la levée de boucliers, notamment au Sénat et à l’Académie française, suscitée par l’inscription dans l’article 1er de la Constitution de la formule « Les langues régionales font partie du patrimoine national ». Commentaire de Mona Ozouf : « La République n’a pu se défaire de son surmoi jacobin ». De fait, un certain intégrisme républicain, qui n’a plus l’Église comme adversaire principal, brandit désormais l’épouvantail du communautarisme « chaque fois qu’un individu fait référence à son identité ». Il faut en finir, dit-elle encore, avec « l’opposition binaire simpliste » entre universalistes et communautaristes et accepter de vivre, « tant bien que mal entre une universalité idéale et des particularités réelles ».
Qu’on les nomme appartenance, identité, enracinement (dans lequel Simone Weil voyait « le besoin le plus important de l’âme humaine »), ces spécificités sont dénigrées par tous les « pourfendeurs du communautarisme » qui ne voient en elles que « petitesse, étroitesse, enfermement ». A tous ceux pour qui « toutes les attaches sont des chaînes », donc des déterminations, Mona Ozouf répond, et ses propos revêtent une dimension particulière dans le contexte du débat actuel sur « l’identité nationale », qu’on ne saurait vivre sans déterminations, car « nous naissons au milieu d’elles, d’emblée héritiers d’une nation, d’une région, d’une famille, d’une race, d’une langue, d’une culture ».
Au « grand clapot tiède de l’indifférenciation » qui caractérise la vie démocratique de la France, l’auteur de La fête révolutionnaire oppose « la résistance des hommes à la rêverie de l’homogène » telle qu’elle s’exprime en Bretagne, ce « miraculeux conservatoire des origines celtes de la nation ».
Composition française est un livre passionnant, courageux et lucide, d’une telle richesse que l’on voudrait en citer des passages entiers, tant ceux où Mona Ozouf se souvient et se raconte que ceux où elle relit l’Histoire et réfléchit sur des questions essentielles pour la France. Ajoutons que la profondeur de la pensée s’accompagne d’une grande qualité d’écriture, comme en témoignent ces lignes sur sa Bretagne natale dont elle évoque joliment, après le Michelet du Tableau de la France ; « [la] « neige d’été du sarrasin dans les champs, [le} vent d’ouest autour des tombes, [les] pierres dressées sur la lande comme une noce pétrifiée ».
Fabrice Valclérieux (Eléments n°134, janvier-mars 2010)
