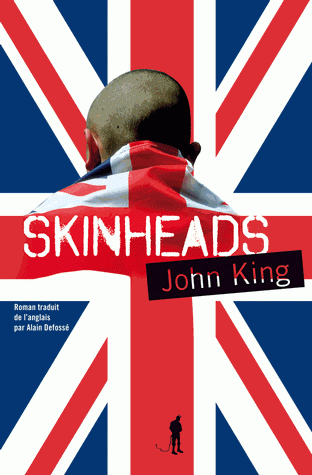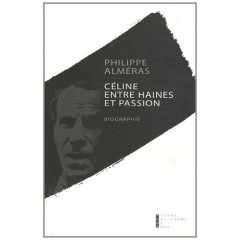OUI, LE STYLE, C’EST L’HOMME !
Il fut un temps où Paris donnait le ton. Cette mode était une grande chose. Puis les modes se sont succédé de plus en plus rapidement, devenant souvent de plus en plus absurdes. Et finalement, la mode a été qu'il n'y ait plus de mode du tout. On a commencé à s'habiller n'importe comment (c'était plus pratique), en même temps qu'on s'habituait à dire n'importe quoi et à penser avec n'importe qui. Les fabricants de salopettes ont réussi là où d'autres occupants avaient échoué : à mettre tout le monde en uniforme. Que ce soit à la radio, à la télévision ou ailleurs, la vulgarité semble être devenue la règle.
C'est le règne du « treizième César », ce despote dont l'un des traits, disait Montherlant, est « la volonté de dégradation systématique des caractères et le détraquage systématique des esprits ». « La domination mondiale de l'imposture, et la facilité avec laquelle elle s'est imposée, grâce au snobisme né de l'abaissement de l'intelligence, écrivait-il encore, sont des nouveautés aussi importantes dans l'histoire de l'humanité que les inventions atomiques ». Déjà avant la guerre, Montherlant s'en prenait à la « morale de midinettes ». Mais c'était encore une morale – et il n'y a plus de midinettes. On est descendu plus bas.
Qu'on ne vienne surtout pas parler de manières de classe ou de mœurs de salon ! C'est dans les salons, précisément, qu'on se met en dégueulasse. Ce n'est jamais le peuple qui a donné l'exemple du laisser-aller, mais la plèbe dorée des petits marquis pour qui le « populaire » est un alibi commode pour se laisser glisser sur la planche de leurs instincts. D'ailleurs, une classe, cela peut se dépasser de deux façons : par le haut ou par le bas. Par l'aristocratisme ou par la chienlit. N'oublions pas Flaubert : « J'appelle bourgeois quiconque pense bassement ». Voilà les barrières de classes enfoncées !
Le laisser-aller, qu'il soit vestimentaire ou intellectuel, n'est à la vérité qu'une des formes de la régression. Ce laisser-aller, sous prétexte que c'est plus « simple » ou plus « pratique », revient à perdre toute forme. Or, le but de la vie, c'est de se donner une forme – et subsidiairement d'en donner une au monde. La distinction, elle aussi, vise à donner une forme. C'est une catégorie de l'être, plus encore que du paraître. Qui nous donnerait une forme si nous ne nous en donnions nous-mêmes ?
On parle beaucoup des droits de l'homme ces temps-ci. On parle moins de ses devoirs. Cela a choqué Soljénitsyne, qui en parlait en juin dernier dans son discours de Harvard. La vérité est qu'on a des droits en proportion qu'on a des devoirs. Ni plus ni moins. Et parmi les devoirs de l'homme, il y a celui d'en être un, c'est-à-dire de ne pas déchoir, de ne pas tomber en dessous de sa condition. L'homme est né d'un singe redressé. Il ne lui vaut rien de se remettre à quatre pattes. Il gagne par contre beaucoup à se redresser encore. On a sans doute le droit de refuser les contraintes des autres. Mais à condition d'être capable de se contraindre soi-même.
La conviction qui agite secrètement les sociétés modernes, c'est qu'au fur et à mesure que la vie devient plus « facile », l'effort devient inutile. C'est en réalité l'inverse. L'effort change seulement d'objet. Plus il y a d'éléments sur lesquels nous pouvons agir, plus il nous faut d'énergie pour les mettre en forme. La volonté, non l'espérance, est une vertu théologale. C'est aussi l'une des formes de la possession de soi, laquelle en italien se dit maestria.
Le style, c'est l'homme : vieille formule. Iversen, le héros de La ville, roman d'Ernst von Salomon, déclare : « Peu importe ce qu'on pense ; ce qui compte, c'est la façon de penser ». Propos à peine paradoxal, mais qu'une certaine classe d'hommes (une classe qui n'a rien à voir avec la lutte des classes) aura toujours du mal à comprendre. L'engagement et la manière de s'engager, la lettre et l'esprit, le physique et le moral : c'est tout un. Aucun « préjugé » là-dedans : on est aussi ce qu'on paraît être.
Il y avait une chanson de Jacques Brel (« Voilà que l'on se couche, de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour… ») dont le refrain était : « Serait-il impossible de vivre debout ? » Le poète Brel est-il mort au moment où de tels mots ne pouvaient plus se chanter ? On se le demande. C'est que les gens qui ne se respectent pas sont trop souvent vainqueurs des autres. Quelques années avant de se donner la mort – à la façon des vieux Romains –, Montherlant écrivait à propos du préfet Spendius, héros d'un roman que nous ne connaîtrons jamais : « Spendius feint de se tuer parce qu'il est atteint d'un mal inguérissable, et il se tue parce que c'est sa patrie qui est inguérissable ».
Alain de Benoist (Le Figaro magazine, 14 octobre 1978)