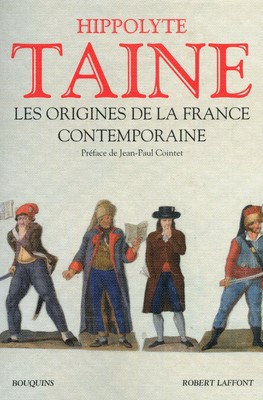Nous reproduisons ci-dessous un texte important de Jacques Sapir, cueilli sur son carnet RussEurope et consacré à une réflexion sur les notions de nation, de souveraineté et de démocratie. Economiste hétérodoxe, Jacques Sapir est notamment l'auteur d'un essai intitulé La démondialisation (Seuil, 2011).

Un marché des nationalités ou de quoi Arnault, Bardot et Depardieu sont-ils le nom
Un commentaire sur une note de Michel Wieviorka
Michel Wieviorka vient de publier sur son carnet une réaction aux cas Arnault, Depardieu et Bardot1 qui soulève des problèmes de fond. Avec ce texte, court mais dense, nous sommes à mille lieux des remarques et réactions journalistiques suscitées par l’« exil fiscal » des uns et des autres. Ce texte est important, et sans doute plus que ne le pense son auteur, car il touche à des problèmes qui sont réellement fondamentaux. C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d’aller au fond de ce débat.
Michel Wieviorka pointe, à très juste titre, que ces comportements remettent en cause l’idée même de Nation. Il dit, et je le cite :
« La citoyenneté, l’identité nationale deviennent un attribut de la personne, qui peut dans cette perspective nouvelle juger bon de s’en dessaisir, de faire le choix d’une autre citoyenneté. »
Comment ne pas constater que telle est bien la logique dans laquelle s’inscrivent, pour des raisons d’ailleurs différentes, tant Arnault que Depardieu ou Bardot. Cette citation cependant renvoie à une remarque antérieure sur le débat que Nicolas Sarkozy a voulu lancer sur l’identité nationale (et que Jean-François Copé à sa manière très instrumentale a repris). Michel Wieviorka remarque alors :
« Il n’est pas ici question de droit du sang, puisque l’appartenance à une nation devient un choix personnel qui n’a rien à voir avec un quelconque déterminisme sanguin.
Il ne s’agit pas pour autant de droit du sol, la question n’est pas de savoir où l’on vit en citoyen, physiquement, géographiquement, sur quel territoire, en solidarité avec la population et, comme dit Renan, avec une conscience morale partagée. Mais de soupeser et de comparer les législations fiscales pour opter pour celle qui apparaît la plus avantageuse, ou tout simplement de faire de son appartenance nationale un instrument de chantage (Bardot).
Ainsi s’esquisse une mise en cause du cadre philosophique et politique à l’intérieur duquel s’est construit le grand débat sur l’identité nationale à partir de la fin du XVIIIème siècle. »
En remarquant que ces comportements s’inscrivent dans ce qu’il appelle le « grand débat » sur l’identité nationale, Michel Wieviorka a certainement raison, mais sans doute pas pour les raisons qu’il croit ; de plus, il fait une erreur de perspective en opposant que ce soit Renan ou Fichte aux comportements de notre « sainte trinité » bien française. Les choses sont à la fois plus profondes et plus triviales. Il est par contre parfaitement à sa place quand, en sociologue, il pressent que ceci pourrait anticiper sur des fractures radicales dans nos sociétés. Pour tenter de démêler l’écheveau de cette affaire, entre représentations immédiates et problèmes réels, il faut commencer par revenir sur l’Histoire.
La Nation, le noble et le bourgeois
Rappelons, tout d’abord, qu’un tel comportement où l’on met les États, et leurs souverains, en concurrence, a été considéré comme « normal » dans la très haute noblesse d’ancien régime qui se considérait naturellement comme apatride. Pour cette haute noblesse, la notion de Patrie n’avait pas de sens. Seul comptait le lien de vassalité et les alliances familiales. Or, ces dernières étaient suffisamment entrelacées entre pays pour que tel ou tel puisse décider de servir un jour le Roi de France, le lendemain celui d’Espagne, ou le surlendemain le Prince d’Orange. Il suffit de rappeler quelles furent les carrières militaires du Grand Condé, de Turenne et de bien d’autres. Et, lorsque Condé négocie son ralliement à Louis XIV après l’échec de la Fronde et avoir offert ses services au Roi d’Espagne, il ne le fait point sur une base « nationale » mais sur une base dynastique. D’ailleurs Louis XIV lui-même est autant espagnol ou autrichien qu’il n’est français. Eugène Lavisse remarque dans son livre qu’il est autant un « infant » qu’un dauphin. Mazarin fut d’ailleurs le serviteur de plusieurs maîtres avant de se donner à la famille royale française. Est-ce donc à dire que le patriotisme n’existe pas à l’époque ?
Le sentiment d’appartenance nationale apparaît en fait autour de deux événements clefs de l’Histoire de France. Le premier est bien connu, c’est l’épisode symbolisé par Jeanne d’Arc. Issue des frontières de l’Est, elle est particulièrement réceptive à l’idée de Nation qui s’oppose ici directement au principe dynastique. Dans cette guerre de 100 ans, qualifiée par un historien anglais de « problème d’héritage envenimé par des avocats ambitieux », se heurtent ces deux principes, celui de la logique dynastique et celui de la Nation. Jeanne d’Arc symbolise alors une forme de soulèvement populaire contre le premier et en faveur du second. Le second événement fondateur se situe à l’époque des guerres de religions. À un principe religieux transcendant les frontières s’oppose, porté tant par la bourgeoisie, la noblesse de robe et une partie de la noblesse d’épée, le principe de Nation. C’est lui qui motive le camp des Catholiques dits « politiques » qui finiront par s’allier aux Protestants conduits par Henri de Navarre pour chasser la Ligue et ses alliés espagnols du territoire français. Et c’est aussi pourquoi Henry IV, même après son abjuration, reste le symbole d’une unité nationale dépassant les religions. Il forme d’ailleurs avec son double protestant, Sully, l’intéressante figure d’un Janus uni pour l’intérêt du Royaume.
Dans ces deux cas, on constate que des principes que l’on pourrait qualifier, au prix d’un anachronisme, « d’internationalistes », comme le principe dynastique et le principe religieux, se sont heurtés à l’idée d’un enracinement du « vivre ensemble » sur un territoire donné. Dans le « Dialogue du Maheustre et du Manant », texte datant de la fin des guerres de religions, l’auteur met en scène l’opposition entre un principe fondamental, Dieu est Dieu et ne peut être que catholique, et ce principe du vivre ensemble qu’ouvre la cohabitation de deux religions via l’Edit de Nantes. Jean Bodin, l’un des pères de la pensée politique moderne en France au XVIème siècle en avait pris conscience. En contrepoint à son chef d’œuvre, Les Six livres de la République, il a produit un ouvrage bien moins connu mais non moins important, le “Colloque des Sept” ou Colloquium Heptaplomeres2. Organisant, sous la forme classique du “banquet” socratique, un dialogue entre sept personnages incarnant les diverses religions de son temps, Bodin montre la futilité des controverses théologiques. Dans le domaine de la croyance, on ne peut convaincre l’autre, seulement le convertir. Il prend alors le deuil de l’unité religieuse et en tire la seule conclusion possible. Pour vivre ensemble, ses sept personnages décident de ne plus jamais parler entre eux de religion, c’est-à-dire d’exclure le religieux de l’espace public et de le renvoyer à l’espace privé. Bodin fonde ainsi la notion moderne de laïcité.
Mais, si l’unicité de religion ne peut plus être un principe fondateur, alors il faut organiser autour de la « chose publique » les principes de la politique. Ce n’est pas un hasard si Jean Bodin écrit à ce moment même les Six livres de la République3. Car, ce que l’on oublie un peu vite, est que si l’on veut « dépasser » la Nation, il faut nécessairement trouver des principes légitimes alternatifs. Mais, pour l’instant, les seuls compétiteurs possibles restent le marché ou la religion, et l’on sait trop à quelles abominations ils conduisent.
L’adhésion au principe national n’a jamais été totale. Le XVIIIème siècle témoigne justement de la coexistence d’une élite apatride et d’une majorité qui s’enracine dans le sentiment national. Pour Louis XVI, il était « normal » d’aller chercher de l’aide auprès d’autres souverains. Pour la bourgeoisie comme pour la paysannerie française, cela constituait une trahison qui délégitimait radicalement la dynastie. Et c’est là que nous butons sur le principe de souveraineté.
Le principe de souveraineté
À l’origine, nous trouvons l’articulation entre légitimité et légalité. La légitimité est fonctionnellement antérieure à la légalité en ceci que toute action légale peut être questionnée en justesse et non pas seulement en justice (la vérification technique de la légalité). Un monde qui confondrait justesse et justice serait une tyrannie en ceci qu’il supposerait que le législateur ne puisse se tromper. La souveraineté signifie donc l’identification de qui règle et organise les modalités de vérification de la légitimité, soit l’organisation d’une Constitution. Hors de ces modalités, la légitimité ne serait qu’un vain mot. La souveraineté signifie donc le pouvoir de décider et la capacité à déterminer des procédures de légitimation. Il reste que ces procédures ne peuvent se matérialiser que si l’on a précisé qui était soumis aux lois dont on vérifie la légitimité, qui pouvait être contrôlé par l’institution chargée de faire exécuter la loi. La légitimité n’a de sens que dans une communauté sociale et politique définie. Elle implique un principe d’inclusion (qui est citoyen) et un principe d’exclusion (qui ne l’est pas).
Mais la souveraineté n’est pas seulement cela. Elle est la capacité à décider en ultime recours dans le cadre d’une communauté sociale et politique donnée. Cette capacité représente une extension ultime du principe précédent. La souveraineté signifie la capacité à définir quelle est l’idée de droit valable pour une communauté donnée. Ceci implique qu’il ne saurait y avoir de droit sans définition simultanée de la communauté souveraine. Si l’on admet l’idée qu’il n’est pas de droit qui ne pense la légitimité, alors il n’est pas de droit sans une définition préalable de l’espace de souveraineté et une identification du souverain.
Comme une décision sans mise en œuvre n’est qu’un mot, la souveraineté implique que la communauté sociale et politique ait la possibilité de faire pleinement appliquer les principes du droit qu’elle a décidée. Une souveraineté qui ne pourrait dire qu’une partie du droit, ou qu’un droit ne s’appliquant que sur des segments de la communauté, est une contradiction dans les termes. Il faut donc que la possibilité de dire le droit soit pleine et entière ou que la communauté prenne conscience qu’elle a été privée de sa souveraineté.
En ce sens, la souveraineté fait tout autant référence à un espace qu’à un mécanisme d’inclusion/exclusion, à un principe qu’à l’ensemble des domaines sur lesquels se manifestera la vérification de ce principe. Le Souverain est donc, par nature, au-dessus de tout statut constitutionnel puisqu’il le crée4. Mais il n’est pas au-dessus d’une communauté politique. C’est un point extrêmement important quand on veut penser la Nation comme communauté politique.
Ce statut particulier ouvre la possibilité au Souverain en des temps exceptionnels d’user de méthodes exceptionnelles. Une action exceptionnelle qui n’aurait d’autres buts que de rétablir les conditions de fonctionnement de la légitimité et de ses principes fondateurs, palliant les effets d’une situation d’exception risquant de mettre à mal ces principes et d’empêcher leur application, ne saurait constituer une violence hors de toute règle. Elle peut s’affranchir pour un temps limité des règles communes pour rétablir le cadre d’application des principes fondamentaux. Elle n’en reste pas moins liée au cadre dont elle est issue. Et ce cadre au sein duquel elle peut s’exercer, c’est justement la Nation. Les formes et la taille de cette dernière peuvent varier. Une Nation peut se fondre dans une autre, mais sans souveraineté il ne peut y avoir de constitution.
La souveraineté doit se penser avec le principe de légitimité. C’est cela qui permet de faire la distinction entre le Dictateur (forme de la démocratie) et le Tyran (qui est la négation de la démocratie). Ainsi, l’action d’un gouvernement qui, face à une crise économique et financière extrême, suspend les règles de circulation des capitaux, ou les règles comptables, afin d’empêcher un petit groupe d’agents d’imposer indûment leur volonté au plus grand nombre par l’agiotage et la spéculation, n’est pas un acte d’arbitraire, quand bien même seraient alors piétinées règles et lois nationales et internationales. Ce serait bien au contraire un acte plus fidèle à l’esprit des principes de la démocratie que l’application procédurière des lois et règlements qui, elle, serait alors un acte illégitime. Affirmer cela implique, bien entendu, que la responsabilité du gouvernant face aux gouvernés soit préservée. Ceci implique bien le maintien de la formule du Peuple Souverain comme seul fondement possible, hors les dérives théologiques, à la possibilité d’une action exceptionnelle.
La critique de la souveraineté
Le principe de souveraineté, tout comme celui de légitimité, ont fait l’objet de nombreuses critiques. Ainsi, la critique de la souveraineté comme concept vide de sens ou dépassé est un point de passage obligé des argumentations qui prétendent « dépasser » le stade de la Nation. Traditionnellement, la critique porte alors sur les limitations « objectives » de l’État.
Dans la mesure où ce dernier contrôlerait du moins les choses en raison des effets d’interdépendance avec d’autres acteurs étatiques, son importance et sa pertinence en diminueraient d’autant. La thèse de la « mondialisation » de l’économie sert ainsi à « démontrer » la réduction des pouvoirs de l’État et à justifier des abandons progressifs de souveraineté. Mais il y a là une série de confusions. Comme le montre Simone Goyard-Fabre, le fait que l’exercice de la souveraineté puisse être techniquement difficile, par exemple pour des raisons de complexité, n’affecte nullement la nature de la souveraineté.
“Que l’exercice de la souveraineté ne puisse se faire qu’au moyen d’organes différenciés, aux compétences spécifiques et travaillant indépendamment les uns des autres, n’implique rien quant à la nature de la puissance souveraine de l’État. Le pluralisme organique (…) ne divise pas l’essence ou la forme de l’État; la souveraineté est une et indivisible”5.
L’argument prétendant fonder sur la limitation pratique de la souveraineté une limitation du principe de celle-ci est, quant au fond, d’une grande faiblesse. Les États n’ont pas prétendu pouvoir tout contrôler matériellement, même et y compris sur le territoire qui est le leur. Le despote le plus puissant et le plus absolu était sans effet devant l’orage ou la sécheresse. Il ne faut pas confondre les limites liées au domaine de la nature et la question des limites de la compétence du Souverain.
On avance souvent l’hypothèse que les traités internationaux limitent la souveraineté des États. Les traités sont en effet perçus comme des obligations absolues au nom du principe Pacta sunt servanda 6. Mais, ce principe peut donner lieu à deux interprétations. On peut considérer qu’il n’est rien d’autre qu’une mise en œuvre d’un autre principe, celui de la rationalité instrumentale. Il implique donc de supposer une Raison Immanente et une complétude des contrats que sont les traités, deux hypothèses dont il est facile de montrer la fausseté. Nul traité n’est rédigé pour durer jusqu’à la fin des temps. On peut aussi considérer qu’il signifie que la capacité des gouvernements à prendre des décisions suppose que toutes les décisions antérieures ne soient pas tout le temps et en même temps remises en cause. Dans ce cas, l’argument fait appel à une vision réaliste des capacités cognitives des agents. Un traité qui serait immédiatement rediscuté, l’encre de la signature à peine sèche, impliquerait un monde d’une confusion et d’une incertitude dommageables pour tous. Si tel était le cas mieux vaudrait n’en pas signer. Mais dire qu’il est souhaitable qu’un traité ne soit pas immédiatement contesté n’implique pas qu’il ne puisse jamais l’être. Il est opportun de pouvoir compter, à certaines périodes, sur la stabilité des cadres qu’organisent des traités, mais ceci ne fonde nullement leur supériorité sur le pouvoir décisionnel des parties signataires.
C’est pourquoi d’ailleurs le droit international est nécessairement un droit de coordination et non un droit de subordination7. L’unanimité y est la règle et non la majorité. Cela veut dire que la communauté politique est celle des États participants, et non la somme indifférenciée des populations de ces États. Un traité n’est contraignant que pour ses signataires, et chaque signataire y jouit d’un droit égal quand il s’engage par signature, quelle que soit sa taille, sa richesse, ou le nombre de ses habitants. Il ne peut y avoir de droit de subordination que si les États signataires se fondent en une seule et même communauté sociale et politique. C’est le cas de la fédération. Dès lors, un souverain unique se substitue à tous les autres. Quand l’État indépendant du Texas décida librement au début du XIXème siècle de rejoindre les États-Unis, il abandonna sa souveraineté pour rejoindre tous les autres composants de cette fédération.
Fors ce processus, vouloir substituer le droit de subordination au droit de coordination n’a qu’une seule signification : la création d’un droit qui serait séparé du principe de souveraineté et n’aurait d’autre fondement à son existence que lui-même. Un tel droit, s’il se rattache ou prétend se rattacher à un principe démocratique, nie le principe de légitimité.
De l'origine de la souveraineté
Cela conduit à revenir sur l’origine des deux origines du principe de souveraineté de l’État et donc de la Nation. La première, telle qu’elle se manifeste en France au XIVème siècle, vise à dégager un espace d’action sur un territoire donné et d’une puissance qui se veut non territorialisée, celle du pape, et d’une puissance qui au contraire se fonde sur un micro-territoire, la seigneurie8. La seconde, telle qu’elle s’exprime deux siècles plus tard dans l’œuvre de Jean Bodin, réside dans la prise en compte d’intérêts collectifs, se matérialisant dans la chose publique. Le principe de souveraineté se fonde alors sur ce qui est commun dans une collectivité, et non plus sur celui qui exerce cette souveraineté9. La souveraineté correspond ainsi à la prise de conscience des effets d’interdépendance et des conséquences de ce que l’on a appelé le principe de densité. Elle traduit la nécessité de fonder une légitimation de la constitution d’un espace de méta-cohérence, conçu comme le cadre d’articulation de cohérences locales et sectorielles. Cette nécessité n’existe que comme prise en compte subjective d’intérêts communs articulés à des conflits. Que des éléments objectifs puissent intervenir ici est évident ; néanmoins la collectivité politique ne naît pas d’une réalité « objective » mais d’une volonté affirmée de vivre ensemble.
La question de la souveraineté ne dépend donc pas seulement de qui prend les décisions, autrement dit de savoir si le processus est interne ou externe à la communauté politique concernée. La souveraineté dépend aussi de la pertinence des décisions qui peuvent être prises sur la situation de cette communauté et de ses membres. Une communauté qui ne pourrait prendre que des décisions sans importance sur la vie de ses membres ne serait pas moins asservie que celle sous la botte d’une puissance étrangère. Ceci rejoint alors la conception de la démocratie développée par Adam Przeworski. Pour cet auteur, dans un article où il s’interroge justement sur les transitions à la démocratie en Europe de l’Est et en Amérique du Sud, la démocratie ne peut résulter d’un compromis sur un résultat. Toute tentative pour pré-déterminer le résultat du jeu politique, que ce soit dans le domaine du politique, de l’économique ou du social, ne peut que vicier la démocratie. Le compromis ne peut porter que sur les procédures organisant ce jeu politique10.
Cela implique de déterminer ce qu’est l’ordre démocratique, qui s’oppose tant à l’ordre d’ancien régime qu’à l’ordre marchand que nous voyons en action sous nos yeux.
L'ordre démocratique et Jurgen Habermas
L’ordre démocratique a, alors, deux fondements. Il est d’abord une chaîne logique qui découle de la notion de souveraineté du peuple et des contraintes qui en découlent quant aux possibilités de dévolution. La souveraineté du peuple est première, à travers, d’une part le couple contrôle/responsabilité fondateur de la liberté comme on l’a montré plus haut. Elle fonde la légitimité du cadre politique qui est alors organisé par des lois, et soumis au principe de légalité. D’autre part, si l’on prend le parti de considérer les principes fonctionnels de la décision de manière réaliste11, l’ordre démocratique est une réponse au fait que la coordination de décisions décentralisées, dans une société répondant au principe d’hétérogénéité, implique que des agents ayant des positions inégales se voient mis dans une position formelle d’égalité. Le couple contrôle/responsabilité résulte ainsi du principe de densité sociale ; il en est une manifestation.Il implique alors que le peuple soit identifié à travers la détermination d’un espace de souveraineté. C’est pourquoi l’ordre démocratique implique des frontières (qui est responsable de quoi), mais aussi une conception de l’appartenance qui soit territoriale (le droit du sol). On le voit, ici resurgit un débat que l’on croyait pouvoir dépasser. Le droit du sol est une des conditions d’existence du couple contrôle/responsabilité qui, dans une société hétérogène est nécessaire à l’existence d’un ordre démocratique. De ce point de vue, l’absence de frontières, l’indétermination de la communauté de référence, conduit au découplage du contrôle et de la responsabilité.
Nier les frontières et les Nations est une démarche tentante. Telle est la base de la pensée politique de Jurgen Habermas qui propose un « dépassement » de l’opposition entre la conception dite « française » de la Nation (le droit du sol) et la conception dite « allemande » (le droit du sang) dans une Constitution européenne et dans un « patriotisme de la Constitution ». Le problème est de savoir ce qui rattacherait cette Constitution tant à la légitimité qu’à la souveraineté. La démocratie, soit l’existence d’un espace politique où l’on puisse vérifier et le contrôle et la responsabilité, implique l’une et l’autre. Cette dernière, en effet, ne peut se contenter, comme chez Jurgen Habermas d’être simplement délibérative12, ce qui reviendrait à concevoir le principe de légalité comme incluant la légitimité. Il y a certainement de nombreux points positifs dans la conception délibérative de la démocratie. Néanmoins, elle contient des dimensions idéalistes et irréalistes qui la rendent très vulnérable à la critique. Rappelons que la délibération doit être gouvernée par des normes d’égalité et de symétrie, que chacun a le droit de mettre en cause l’ordre du jour, et qu’il n’y a pas de règles limitant l’ordre du jour ou l’identité des participants aussi longtemps que chaque personne exclue peut de manière justifiée montrer qu’elle est affectée par les normes en discussion. De plus, si nous incluons la légitimité dans la légalité, cela revient à dire que tout ce qui a été décidé dans les règles démocratiques est par essence juste. On ne peut plus distinguer la justesse de la justice. Le législateur se constitue alors en Tyran.
On peut aller plus loin dans le questionnement de cette démocratie délibérative. Pour qu’une délibération ait un sens, il faut nécessairement qu’elle ait un enjeu. Il faut qu’elle porte sur un objet par rapport auquel existent des moyens d’action. Discuter d’une chose sur laquelle nous ne pouvons agir n’a pas de sens d’un point de vue démocratique. Une délibération n’a de sens que si elle se conclut sur une décision se traduisant par une action. Seulement, si l’action existe, la responsabilité des conséquences de cette action existe aussi par définition. L’identité des participants à la délibération doit donc être clairement déterminée pour savoir qui est responsable de quoi. On ne peut laisser dans l’indétermination le corps politique. Une constitution européenne est en théorie possible, mais à la condition que l’existence d’un peuple européen ait été au préalable constatée. Or, il faut ici rappeler l’arrêt de la cour constitutionnelle de Karlsruhe qui constate que la démocratie n’existe QUE dans le cadre des nations européennes13. De ce point de vue, la position d’Habermas revient à supposer qu’une Raison s’imposera sur toutes les autres, alors que l’on sait qu’il existe des modèles multiples de rationalité, et que les choix des individus sont changeants tout comme le sont leurs préférences individuelles14. En fait, sur ce point, Habermas ne fait que reprendre les hypothèses les plus discutables de l’économie orthodoxe15.
Ensuite, s’il est juste de mettre en garde contre des limitations des ordres du jour16, il est aussi clair que les ordres du jour doivent être organisés. Une discussion où tout pourrait être simultanément débattu ne serait plus une délibération. Il est légitime, compte tenu des limites cognitives des individus, de penser des ordres de priorité. Ces derniers peuvent être l’objet de discussions. Ils sont néanmoins contraignants et impliquent l’existence de procédures d’autorité et de vérification. Il n’est pas possible, sauf à accepter que la délibération soit vidée de son sens, de prétendre que ces ordres de priorité peuvent être en permanence contestés par n’importe qui. Il y a là une grande faiblesse dans la conception pure de la démocratie délibérative.
Supposer que la délibération puisse se faire dans un cadre entièrement homogène, ignorant la présence de routines et de délégations de pouvoir, témoigne d’hypothèses implicites quant aux capacités cognitives des individus qui ne sont pas recevables. En ce sens la position d’Habermas n’est pas compatible avec l’approche réaliste que l’on défend que ce soit dans ce texte ou dans d’autres qui sont antérieures17. Seulement, si on admet la présence des routines et des délégations de pouvoir, la composition des participants au débat doit être relativement stable au moins pour les périodes marquées par ces routines et délégations. De plus, il faut que les effets des routines et délégations que l’on doit mettre en œuvre s’appliquent bien sur ceux qui les ont décidées. La démocratie délibérative proposée par Habermas, et qui fonde son projet de Constitution Européenne, porte en elle un risque de dissolution à l’infini du constituant du pouvoir, et donc le risque de l’irresponsabilité généralisée. Il en est ainsi en raison des limites cognitives des individus et de ce qui en découle, le principe de densité et celui de la contrainte temporelle. On ne peut considérer les effets d’une délibération en niant la densité ou en considérant, ce qui revient au même, que le degré de densité est uniforme au niveau mondial.
Nous sommes donc bien obligés de constater la justesse et la force de l’arrêt du 30 juin 2009 de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe. La démocratie est toujours enracinée dans un cadre national, non par tradition (encore que le rôle de cette dernière ne soit pas négligeable) mais pour des raisons fonctionnelles et de principe. Toute tentative pour dépasser la Nation ne fait qu’ouvrir la voie soit à une régression de type technocratique ou à une régression de type religieux.
De quoi Arnault, Depardieu et Bardot sont-ils le nom ?
Nous voici loin de la France de cette fin d’année 2012, des aventures de Bernard Arnault, de Gérard Depardieu ou de Brigitte Bardot semble-t-il. En fait, bien au contraire.
Ce que montrent ces comportements, ce n’est pas une crise de l’idée de Nation, ni une remise en cause des différents modèles de définition de la nationalité. C’est au contraire le retour à une situation de l’Ancien Régime à la fin du XVIIIème siècle. Nous avons aujourd’hui une petite élite de « super-riches » qui s’est internationalisée au point de devenir apatride. Cette élite attire idéologiquement à elle de 5% à 8% de la population, soit la proportion des Français qui voyagent régulièrement à l’étranger. Cette élite rejette les entraves d’un pouvoir national, et en particulier son droit de lever l’impôt, tout comme elle a rejeté l’idée d’une monnaie nationale. Son mode de vie est cohérent avec ses intérêts et ses comportements. Mais, face à elle, nous avons l’immense majorité de la population, celle qui affirme à 62% son attachement à cette monnaie nationale (et 66% des moins de 35 ans)18. Les comportements des Arnault, Depardieu et Bardot indique que la confrontation entre cette petite minorité et cette immense majorité est devenue inévitable, et qu’elle sera probablement violente.
À cet égard l’article de Michel Wieviorka est le bienvenu. Il attire notre attention sur un problème majeur de notre société, sur un clivage qui va s’approfondissant ; telle est la tache du sociologue.
Jacques Sapir (RussEurope, 10 janvier 2013)
Notes :
- Michel Wieviorka, “Arnault, Bardot et Depardieu : qu’est ce qu’une nation ?”, billet publié sur le carnet de Michel Wieviorka sur hypotheses.org le 07/01/2013, URL: http://wieviorka.hypotheses.org/109 [↩]
- Cet ouvrage, publié bien après la mort de Jean Bodin, peut être téléchargé sur le site de la Bibliothèque Nationale (manuscrit). On trouvera un commentaire éclairant de sa contribution aux idées de tolérance et de laicité dans: J. Lecler, Histoire de la Tolérance au siècle de la réforme, Aubier Montaigne, Paris, 1955, 2 vol; vol. 2; pp. 153-159. Voir aussi, Marion L. Kuntz, “Bodin’s Demons” in New York Review of Books, vol. 24, n°3/1977, mars. [↩]
- J. Bodin, Les six livres de la République, Réimpression, Scientia Aulem, Amsterdam, 1961. [↩]
- G. Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1972, 15ème édition, pp. 28-29. [↩]
- S. Goyard-Fabre, “Y-a-t-il une crise de la souveraineté?”, in Revue Internationale de Philosophie, Vol. 45, n°4/1991, pp. 459-498, p. 480-1. [↩]
- Idem, p. 485. [↩]
- R. J. Dupuy, Le Droit International, PUF, Paris, 1963. [↩]
- Voir R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie Générale de l’État, Éditions du CNRS, Paris, 1962 (première édition, Paris, 1920-1922), 2 volumes. T. 1, pp. 75-76. [↩]
- J. Bodin, Les Six Livres de la République, Réimpression, Scientia Aulem, Amsterdam, 1961. [↩]
- A. Przeworski, “Democracy as a contingent outcome of conflicts”, in J. Elster & R. Slagstad, (eds.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 59-80. [↩]
- J’ai expliqué ce qu’il fallait entendre par « réalisme » dans deux ouvrages ; J. Sapir, Les Économistes contre la démocratie, Albin Michel, Paris, 2002 et J. Sapir, Quelle Économie pour le XXIe Siècle ?, Odile Jacob, Paris, 2005. [↩]
- Pour un exposé précis des conceptions d’Habermas, S. Benhabib, “Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy”, in Constellations, vol.I, n°1/avril 1994. [↩]
- Arrêt du 30 juin 2009, affirmant la suprématie du Parlement allemand sur les institutions européennes. Marie-François Bechtel, Fondation ResPublica, URL : http://www.fondation-res-publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-Europe-une-revolution-juridique_a431.html [↩]
- J. Sapir, Quelle Économie pour le XXIe siècle, Odile Jacob, Paris, 2005, chap 1. [↩]
- J. Sapir, Les Trous noirs de la science économique, Albin Michel, Paris, 2000. [↩]
- S. Holmes, “Gag rules or the politics of omission”, in J. Elster & R. Slagstad, (eds.), Constitutionalism and Democracy, pp. 19-58. [↩]
- J. Sapir, Les Économistes contre la démocratie – Les économistes et la politique économique entre pouvoir, mondialisation et démocratie, Albin Michel, Paris, 2002. Idem, Quelle Économie pour le XXIe siècle ?, op.cit. [↩]
- « Onze ans après la mise en place de l’euro, 62% des Français regrettent le Franc », Atlantico-IFOP, Atlantico, URL : http://www.atlantico.fr/decryptage/onze-ans-apres-mise-en-place-euro-62-francais-regrettent-franc-jerome-fourquet-590903.html [↩]