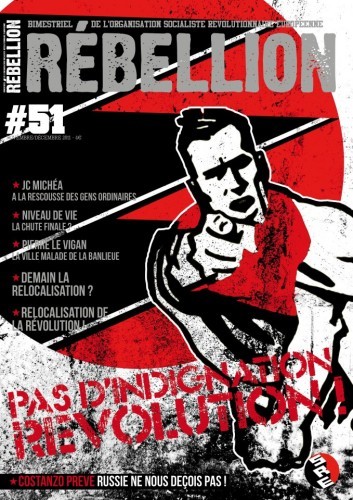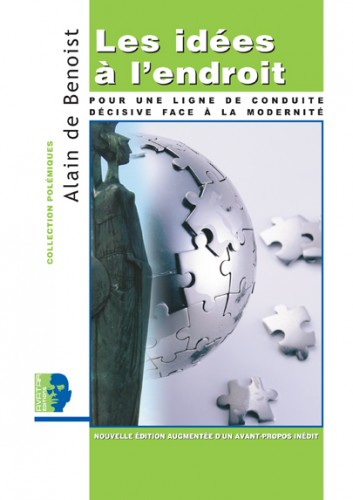Nous reproduisons ci-dessous l'analyse par Pierre Le Vigan du court essai de Jacques Généreux, intitulé Nous on peut ! , récemment publié au Seuil et préfacé par Jean-Luc Mélenchon. Economiste, Jacques Généreux est sécrétaire national à l'économie du Front de gauche.

Vertus et illusions du volontarisme de gauche
Voilà un ouvrage sympathique dans son principe et agaçant par son contenu. La perspective de redonner enfin ses droits à la politique ne peut que plaire. L’idée qu’il n’y a pas une seule politique possible ne peut que convaincre. Mais Jacques Généreux, économiste proche de Jean-Luc Mélenchon qui préface son livre, pêche par optimisme. Il donne l’impression qu’une autre politique est non seulement possible mais facile. C’est sous-estimer l’ampleur des mutations à mener.
Jacques Généreux croit pouvoir vraiment changer la France mais pour cela il lui faudrait abandonner un certain optimisme sociétal hérité des Lumières. Non, les hommes ne sont pas tous identiques, non on ne fait pas une révolution citoyenne avec des gens à qui on n’a rien appris des luttes sociales. Pour changer vraiment il faut revenir sur terre. La terre des hommes complexes et divers. Remettre en cause la libre circulation des capitaux oui mais il faut revoir aussi celle des hommes, ce que ne fait pas Jacques Généreux. La France ne peut pas être un hôtel, ou alors c’est la France qu’aime le grand capital : un simple segment du marché mondial.
Pourquoi et comment notre auteur se trompe ? Explications. Le diagnostic porté par Jacques Généreux est pourtant juste. Nos gouvernants, dit-il, ont une idéologie : « une société de marché dans laquelle chacun est seul responsable de son sort et ne doit compter que sur sa capacité à s’engager dans la libre compétition avec tous les autres. » Nos gouvernants ont aussi un projet. Celui-ci n’est pas tant l’Etat minimal, qui serait conforme à leur doctrine. C’est bien plutôt la démocratie minimale. « Il s’agit de mettre l’Etat à l’abri des revendications populaires et d’exploiter au contraire sa puissance au service d’intérêts privés. » Le néo-libéralisme colonise ainsi l’Etat pour en faire sa chose.
La mondialisation du capitalisme va avec sa financiarisation croissante : 98 % des transactions financières portent sur des produits financiers et non sur des biens économiques réels. L’argent n’est plus un moyen d’échange mais un but en soi. Les actionnaires exigent un taux de rendement de plus en plus élevé. L’élargissement de l’Europe (27 Etats et bientôt 28 avec la Croatie) a été conçue comme le moyen d’un dumping social. La thèse de Jacques Généreux est que ce qu’a fait une politique, une autre politique peut le défaire. On peut faire autrement que les néo-libéraux. « On » ? L’Etat contrôlé par des forces politiques nouvelles. Ni les libéraux ni les sociaux-libéraux mais la vraie gauche. Comment faire autrement ? En rompant avec le libéralisme. Jacques Généreux propose ainsi de refonder le système bancaire en séparant banques de dépôt d’une part, banques d’affaire et d’investissement d’autre part. Il faut aussi plafonner le rendement des actions. On doit encore monétiser une partie de la dette c’est à dire la transformer en création monétaire de la banque centrale. En ce qui concerne l’euro, Généreux préconise d’imposer sa réorientation et de n’en sortir qu’en dernier ressort. Il est selon lui possible de réorienter l’euro dans la mesure où seule l’Allemagne aurait intérêt à un euro fort. Un bloc européen pour un autre euro, ou éventuellement pour un euro zone sud, pourrait ainsi peser de manière décisive pour en finir avec l’euro « austéritaire ». Au minimum l’euro sera sauvé comme monnaie commune. Mais contrairement à Dupont-Aignan, Marine Le Pen et d’autres politiques y compris à gauche Jacques Généreux défend l’idée que l’euro pourrait aussi être sauvé comme monnaie unique, sous la forme d’un euro nouveau qui serait moins surévalué et donc meilleur pour la compétitivité de l’industrie française. Comment ? En restant dans la zone euro mais en sortant du traité de Lisbonne et en imposant une solidarité budgétaire européenne, une nouvelle politique de la Banque Centrale Européenne, une harmonisation fiscale et sociale par le haut, et le contrôle des mouvements de capitaux. Cela représente beaucoup de conditions. Ce qui est plus grave est que cela sous-estime la force de la logique du capital. Explications. Si les Européens réalisent encore entre eux les 2/3 de leur commerce, la part de celui-ci faite avec des pays, notamment la Chine, dotés d’autres normes économiques, sociales et environnementales, est suffisamment importante pour peser de manière décisive dans le sens de la désindustrialisation de l’Europe, particulièrement en France où la part de l’emploi industriel n’est plus que de 12 %. Le poids de l’industrie ne peut que se réduire encore sans une politique radicale de réindustrialisation. Or, Jacques Généreux en refuse les moyens. La délocalisation de notre économie pourra selon lui être arrêtée par des mesures essentiellement fiscales, le plafonnement du taux de rentabilité. On aimerait le croire. Le protectionnisme, même européen, n’est envisagé qu’en dernier recours, et il s’agirait si possible d’un « protectionnisme international », notion contradictoire. On comprend qu’il s’agit en fait d’espaces régionaux autocentrés. Pourquoi Jacques Généreux ne l’explique-t-il pas sous cette forme ? Parce qu’il lui faut à tout prix sauver un internationalisme de principe. Et si les autres pays du monde ne souhaitent pas des espaces autocentrés ? On ne ferait rien pour ne pas aller vers un protectionnisme unilatéral, fut-il européen ?
La question de la dette et du déficit public est aussi complétement minimisée. Il peut y avoir une bonne dette pour des investissements utiles, affirme l’auteur. Mais peut-on sérieusement ne pas s’inquiéter d’une dette servant à payer des dépenses de fonctionnement ? Il y a surtout une philosophie générale du projet de l’économiste du Parti de Gauche qui est d’une navrante faiblesse. Nous avons bien compris qu’il ne s’agit pas de chercher, nous dit-il, « une croissance indifférenciée ». Nous voulons bien « changer de gauche » mais nous aimerions surtout savoir ce que cela changera vraiment. Or, Jacques Généreux croit comme les gouvernants qui nous ont amené là où nous sommes au progrès indéfini. Il ne parait pas croire aux bienfaits de la libre circulation des capitaux mais continue de croire aux bienfaits de la libre circulation des hommes, en tout cas à l’impossibilité morale d’y mettre de quelconque bornes. Il est donc partisan de l’immigration, pensant sans doute que l’on peut, par du volontarisme politique, à la fois mettre au pas le capital qui n’a qu’à bien se tenir, et faire des citoyens français et européens de n’importe quels arrivants venus des quatre coins du monde. Sans doute les immigrés se rendront-ils compte en arrivant qu’ils vivaient dans l’obscurantisme et qu’il n’y a rien de mieux à aimer dans le monde que la France des Lumières et rien de plus urgent que de se débarrasser de leurs mœurs et coutumes, à moins que, séduits par le spectacle quotidien de fierté et d’affirmation nationale de notre pays, ils ne décident qu’il n’y a rien de plus normal que d’être fier d’être français – ce qui reviendra au même. C’est là un stupéfiant irénisme qui ne tient pas le moindre compte des leçons de l’histoire. Mais il n’y a cela rien d’étonnant. A aucun moment dans son analyse des dérives de la gauche s’abandonnant à la séduction du mondialisme, Jacques Généreux ne s’interroge sur la conjonction libérale-libertaire qui est née en son sein et qui a gagné la droite si facilement parce que l’une et l’autre se sont ralliées au libéralisme mondialisateur. A aucun moment Jacques Généreux ne remarque que plus la gauche est devenue libérale au plan économique plus elle a développé une idéologie de substitution : un pseudo « antiracisme » aboutissant à nier les problèmes posés par l’immigration de masse, une préconisation de la légalisation du mariage homosexuel qui, comme chacun sait, est un souci majeur du peuple français, les hommes y pensant tous les matins en se rasant, des positions d’ « ouverture » (sic) face aux drogues, une complaisance pour toutes les remises en cause des valeurs traditionnelles, et en l’occurrence celles du peuple : le respect du travail, de l’argent gagné proprement, de l’art qui ne se moque pas du public, et même, l’amour raisonnable de la patrie. Il n’est pas étonnant qu’avec une telle myopie intellectuelle sur ce qui a amené la gauche à être une solution de secours parfaitement praticable pour le nouvel ordre mondial et le turbocapitalisme, les solutions préconisées par Jacques Généreux, même quand elles vont dans le bon sens – et c’est le cas –, témoignent d’un optimisme indécrottable, il est vrai assez caractéristique de la gauche dépourvue du sens du tragique de l’histoire (on pense à Léon Blum, si perspicace, expliquant en 1932 que « la route du pouvoir est fermée devant Hitler »).
Voilà donc où en est l’ « autre gauche », celle qui se prétend une alternative aux sociaux-libéraux. Or il ne faut pas seulement changer de politique, et bien entendu changer les politiques au pouvoir. Il faut changer de paradigme, sortir de l’idée d’une civilisation universelle, bonne pour tous et partout, qui ne peut mener qu’à l’exact contraire de la « révolution citoyenne » à laquelle se réfère Jacques Généreux. La civilisation universelle de l’économie productiviste mondialisée, de la délocalisation généralisée ne peut être que la fin de toute République. Ce ne peut être que la démocratie réduite au procédural, ce ne peut être que la parodie de l’idée même de citoyen. Ce n’est peut-être pas ce que veut Jacques Généreux mais c’est très exactement ce à quoi nous mènent ses idées internationalistes. Dès lors, à quoi bon son « autre gauche » ? Si le but est d’homogénéiser le monde, qui a mieux montré son savoir-faire que le capitalisme ?
Pierre Le Vigan
Jacques Généreux, Nous on peut !, pourquoi et comment un pays peut toujours faire ce qu’il veut face aux marchés, face aux banques, face aux crises, face à la BCE, face au FMI, …, Seuil, 140 pages, 11 euros.