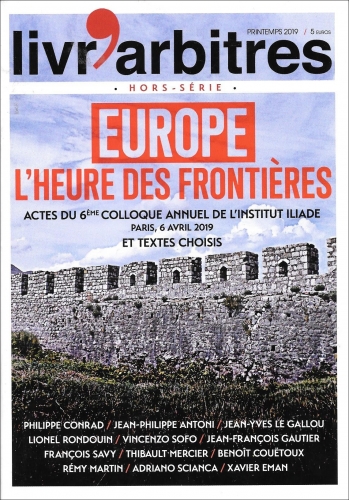Le front de la mémoire et de l’histoire
Depuis deux ans maintenant, les tenants de la déconstruction généralisée ont ouvert un nouveau front, avec le soutien, ce qui n’est guère une surprise, du quotidien du soir dit « de référence ». Le Monde a ainsi donné la parole à Patrick Boucheron, historien médiéviste, professeur au Collège d e France qui, devenu le héraut de la remise en cause du « roman national », a dirigé la réalisation d’une Histoire mondiale de la France censée rompre avec les préjugés ou les idées reçues généralement admises. L’intéressé déclare que »la recherche de l’identité est contraire à l’idée même d’histoire » s’étonne « que l’on attende de l’histoire qu’elle réassure notre identité », il ne croit pas « aux formes anciennes du magistère de l’histoire », dénonce « la passion des continuités », et rejette « l’injonction faite aux historiens de nous rassurer sur l’ancienneté, la consistance et la clôture de notre identité. » Face à cette question identitaire perçue comme un « poison contemporain », « il convient de refuser tout net toute compromission avec le projet idéologique qui prétend emprisonner la société dans la nostalgie d’un passé mythifié. ». Il conviendrait donc de se mobiliser contre « les apôtres de l’identité nationale », contre « le piège identitaire »…
De tels propos s’inscrivent dans l’offensive idéologique d’envergure de remise en cause de la transmission de l’histoire traditionnelle, notamment dans sa dimension « nationale ». Une remise en cause jugée inéluctable et souhaitable par ses thuriféraires, dans la mesure où la mondialisation en cours doit permettre de dépasser les frontières, de fabriquer un « citoyen global », un individu hors-sol coupé de ses racines et de tous les éléments susceptibles de garantir son inscription dans la longue durée historique. Dans la guerre sémantique à laquelle nous sommes confrontés, le vocabulaire utilisé est révélateur. Il est question de formes « anciennes » du magistère de l’histoire, de la « passion » des continuités, de « l’injonction » faite aux historiens de « rassurer », de « poison » contemporain. Il convient d’écarter toute « compromission » avec le projet « idéologique » qui « emprisonne » la société dans la « nostalgie » d’un passé « mythifié »…
Il est aisé de renverser la charge et de pointer justement le « projet idéologique » porté par les tenants d’un mondialisme droit de l’hommiste issu du messianisme démocratique à la mode wilsonienne et de ses divers avatars, une vision identique dans sa nature profonde aux défunts « lendemains qui chantent » contemporains du communisme en sa phase triomphante. Il s’agit en effet dans ce cas « d’emprisonner la société dans l’espérance obligatoire d’un avenir « mythifié », celui de l’Humanité indifférenciée et nomade rêvée par Jacques Attali, celui d’un monde où la France se verrait réduite à la fonction d’hôtel de passage dans le Grand Tout planétaire issu d’une mondialisation économique présentée comme fatalement heureuse…
Ce que l’on constate à l’inverse, c’est la permanence des identités « nationales » forgées au fil des siècles, dans des conditions très différentes d’un pays à l’autre. Même si les nations contemporaines se sont formées plus ou moins tardivement, au travers du modèle politique que nous connaissons, elles ont constitué et constituent toujours le cadre le plus adéquat à l’organisation des sociétés humaines. C’est avant tout à travers l’histoire de leur pays que les hommes appréhendent le passé et se trouvent en mesure de lui donner un sens. C’est dans ce cadre singulier qu’ils peuvent se doter d’un destin collectif dépassant les individus atomisés rêvés par les prophètes du mondialisme libéral (épithète bien discutable dans la mesure où cette vision obligatoirement planétaire de l’avenir n’a plus grand chose à voir avec les libertés authentiques). On doit donc mesurer aujourd’hui plus que jamais l’importance de l’enjeu que représente la transmission d’une mémoire fondée sur la perception d’un patrimoine commun, celui que Marc Bloch résumait quand il évoquait à propos de la France « le sacre de Reims et la Fête de la Fédération ».
On ne peut que remarquer, dans l’offensive idéologique en cours, la place accordée à la déconstruction du « roman » national. Ce terme de « roman », préféré à celui de « récit » à l’évidence plus pertinent, doit contribuer à la disqualification d’une histoire élémentaire qui, fondée certes sur une imagerie et un téléologie discutables nous conduit de Vercingétorix à De Gaulle, n’en est pas moins bien venue pour fournir les repères indispensables à la construction d’une mémoire commune elle-même nécessaire à l’affirmation d’une identité particulière, fondée sur les permanences ethniques, la langue, la perception d’un passé partagé, l’inscription dans la durée d’un ensemble de croyances, de coutumes, d’images et de représentations qui constituent le socle d’un « vivre ensemble » authentique, loin des caricatures véhiculées aujourd’hui par le clergé médiatique bien pensant.
L’entreprise de déconstruction du « roman national » n’est pas nouvelle. Il y a déjà près d’un demi-siècle, Paul Veyne mettait en cause les grilles de lecture et les éléments de langage qui fondaient jusque là les approches historiennes, avant d’être relayé un peu plus tard pat Suzanne Citron et par les apôtres des diverses « repentances » devenues la clé des représentations d’un passé voué à l’exécration. L’histoire quantitative — qui privilégiait la longue durée, l’économique et le social relativisait largement l’histoire événementielle réduite à « l’histoire-batailles » — a également joué son rôle même si le dernier ouvrage de Fernand Braudel portait finalement sur ‘’l’identité de la France »… Il était devenu en tout cas obligatoire de donner la primauté à la société par rapport à la nation ou à l’Etat, d’oublier le peuple majoritaire au profit des « minorités » fatalement opprimées.
La déconstruction en question s’inscrit dans une perspective « gramscienne » de mise en oeuvre d’une révolution culturelle d’envergure, indispensable à l’avènement de « l’homme nouveau », qui n’est plus celui du socialisme auquel aspirait le penseur et militant italien mais celui de la « mondialisation heureuse » imaginée par les oligarchies transnationales aujourd’hui dominantes. George Orwell l’avait déjà annoncé dans son 1984 : « Qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Qui a le contrôle du passé a le contrôle de l’avenir… »
Longtemps « école des princes » selon Michelet, l’histoire et devenue, au XIXème siècle, à la faveur de l’émancipation progressive des masses populaires, le bien commun de toute la nation. C’est la défaite de 1870, dans le moment qui voit Ernest Renan nous donner sa Réforme intellectuelle et morale que les républicains victorieux introduisent dans l’enseignement primaire l’histoire et la géographie. La fin visée par l’histoire ainsi enseignée était l’unité nationale, l’affirmation de son ancienneté inscrite elle même dans la continuité reliant la France monarchique à la nouvelle France républicaine … L’histoire devait alors contribuer à la formation d’une conscience civique et nationale en un temps où selon Pierre Nora, « l’instituteur et l’officier étaient les deux piliers jumeaux de la Patrie… »
Le terrible choc de la première guerre mondiale va ébranler le consensus très large entourant jusque là l’enseignement de l’histoire. Quand naissent en 1929 les Annales, leur sous-titre, Economies, sociétés, civilisations, a valeur de programme. On privilégie désormais l’histoire économique et sociale, celle des mentalités, celle du temps long. On promeut l’histoire quantitative et les structures sont privilégiées au détriment des événements. L’histoire politique n’apparaît plus que comme une superstructure aléatoire et secondaire qui ne peut rendre compte du jeu des forces profondes qui commande l’évolution des sociétés humaines. Le grand public va découvrir cette nouvelle lecture du passé avec le succès médiatique et éditorial remporté au cours des années 1970 par la « nouvelle Histoire », après que la Grammaire des civilisations de Fernand Braudel a fourni la matière d’un manuel de classes terminales au cours de la décennie précédente. La réforme Haby qui affecte l’enseignement secondaire en 1975 vise, dans le domaine de l’histoire, à transmettre, à travers le collège et le lycée ces nouvelles lectures. Le cadre national est largement évacué, de même que le souci d’une chronologie rigoureuse, au profit d’approches « transversales » et « thématiques ». Dans le même temps, les méthodes dites « actives » se substituent au cours « magistral » jugé anachronique, l’élève devant désormais « construire lui-même son savoir » à partir de l’étude de documents. Réduite à la portion congrue et laissée au caprice des instituteurs dans le primaire où elle se limite à des « activités » plus ou moins ludiques faisant table rase de toute continuité, devenue « discipline d’éveil » au collège, l’histoire vise à distraire plutôt qu’à transmettre un savoir solide et cohérent. Les années post-soixante- huitardes et leur pédagogisme envahissant, le le soupçon pesant sut toute autorité étatique, enfin l’européisme béat qui s’impose aggravent encore la situation.
Une première réaction intervient en octobre 1979, avec l’appel lancé par Alain Decaux dans le Figaro-Magazine. Très largement relayé, il rencontre un immense écho et fait largement consensus. Le futur académicien dénonçait l’effondrement des savoirs alors constaté et l’ensemble de la classe politique, bien consciente de l’adhésion que rencontrait son propos, se reconnut dans sa démarche. On vit ainsi Jean-Pierre Chevènement, devenu en 1984 ministre de l’Education nationale, réintroduire vigoureusement à l’école primaire l’enseignement de l’histoire.
Trente ans plus tard, l’incohérence et la faiblesse des programmes officiels, le vide abyssal des manuels et la concurrence que font les « mémoires » à l’histoire sont à l’origine d’un paysage largement dévasté. On privilégie les « mémoires » des minorités jugées opprimées ou victimes. La seconde guerre mondiale est réduite pour beaucoup aux persécutions et aux massacres de masse dont les Juifs ont été les victimes du fait de l’hitlérisme. D’autres mémoires, celle des anciens peuples colonisés, celle des Africains dont les ancêtres ont subi jadis l’esclavage sont ainsi entrées en concurrence victimaire. A l’inverse, la mémoire de la Révolution française, en bien comme en mal, ou le souvenir de la Commune de 1871 semblent avoir disparu des écrans…
L’utopie de la création en cours d’un « citoyen du monde » a remplacé celle de l’avènement rédempteur du prolétariat et comme cette utopie implique « l’intégration » réussie des minorités, il convient de faire une place privilégiée à leurs mémoires. Il faut également donner à l’histoire enseignée la dimension planétaire nécessaire, d’où l’importance inédite accordée à la Chine des Han, à l’Inde des Gupta et aux empires africains du Mali ou du Monomotapa, au détriment des séquences « classiques » de l’histoire de la France ou de l’Europe.
Alors que tendent à s’imposer les repentances post-coloniales et post-esclavagistes (cette dernière oubliant que ce sont les Européens qui ont mis fin à la traite.), le déni de la nation et de la pluralité des civilisations s’impose. Rien de nouveau sous le soleil car l’histoire enseignée est toujours le reflet de l’état du monde du moment et des rapports de force qui le commandent. L’histoire nationale républicaine des hommes de la IIIème République n’était pas d’une parfaite impartialité… La présentation de l’URSS dans les manuels de géographie des années 1960 a aujourd’hui de quoi faire sourire et il en ira sans doute de même bientôt à propos d’autres questions. Le manuel Malet Isaac, tout excellent qu’il fût, transmettait une lecture « républicaine » de l’histoire qui était loin d’être neutre. Le mondialisme qui constitue aujourd’hui la toile de fond idéologique de notre enseignement correspond à un projet porté par l’Occident américano-libéral, face au monde multipolaire en cours de formation et il n’est guère surprenant que Samuel Huntington et son Choc des civilisations aient subi les foudres de la police de la pensée.
L’histoire n’en demeure pas moins une irremplaçable école de discernement. Au lendemain de la première guerre mondiale, Jacques Bainville annonçait, dans ses Conséquences politiques de la paix, les drames à venir et, dès 1972, Pierre Chaunu prophétisait, dans sa Peste blanche, la crise démographique. Contre le déterminisme cher à l’école des Annales, l’histoire demeure le domaine de l’imprévu et de l’inattendu, de l’attentat de Sarajevo à la chute de l’URSS. Elle préserve aussi de l’utopie en ce qu’elle retient tous les faits que, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, Jean-Jacques Rousseau écartait d’emblée. La connaissance du passé entretient aussi la vertu d’admiration propre à la reconnaissance de modèles et l’œuvre de Plutarque fut, de ce point de vue l’école des élites européennes des XVIIème et XVIIIème siècles. L’histoire est aussi la critique du présent et permet d’échapper à l’aveuglement que s’efforcent d’établir les diverses propagandes partisanes. Elle a forgé, au rythme des épreuves endurées et du souvenir des grandes choses accomplies ensemble, le caractère particulier de chaque nation , fondé ainsi la philia qui lie entre eux les membres de la Cité. La connaissance de l’histoire prépare enfin aux épreuves et fournit aux peuples les capacités de résilience nécessaires. Elle indique la voie des redressements, ceux que connut la France au XVème siècle avec l’épopée johannique et ses suites, avec Henri IV qui rétablit la concorde civile après trente ans de guerres religieuses, en 1944 et en 1958 après l’effondrement accablant de 1940 et la décomposition de la IVème République. Au delà de l’homo consumans et de l’homo festivus si bien décrit par le regretté Philippe Murray, l’histoire nous apprend enfin ce que nous sommes, les héritiers d’un passé fait d’épreuves et de grandeurs et les porteurs, dans le temps, d’un avenir que nous devons souhaiter à la hauteur de ce qui nous a précédés.
Il faut pour cela déjouer les manipulations qui ont cours aujourd’hui. « L’Historiquement correct » analysé par Jean Sevillia a correspondu aux strates idéologiques successivement dominantes. Celles-ci peuvent donner aux événements des interprétations novatrices mais, en se prétendant exclusives, elles révèlent rapidement leurs limites. La manipulation s’appuie aussi sur l’anachronisme qui consiste à juger d’un épisode du passé en fonction d’une grille d’interprétation qui nous est étroitement contemporaine. L‘histoire de l’expansion coloniale ou de l’esclavage, quand elle se veulent porteuses de jugements moraux, tombent dans cette ornière. Le manichéisme élémentaire qui prévaut dans la sphère journalistique quand il s’agit de traiter des années quarante – « les plus sombres de notre histoire » selon l’incantation convenue — constitue un autre moyen d’utiliser le passé à des fins qui n’ont rien de scientifique. L’amnésie sélective ou la contestation de certains événements jugés aujourd’hui gênants – de la bataille de Poitiers gagnée par Charles Martel au baptême de Clovis fondant les « racines chrétiennes » de la France — font également partie de l’arsenal des falsificateurs. A l’inverse c’est une hypermnésie qui cherche à s’imposer à propos des crimes des régimes totalitaires du XXème siècle ou d’épisodes tels que celui des mutineries de 1917 ou de la torture durant la guerre d’ Algérie. La police de la pensée veille et verrouille. Olivier Pétré-Grenouilleau en a fait l’amère expérience quand la horde des indignés conduits par Christine Taubira a prétendu lancer contre lui l’accusation d’apologie de crimes contre l’humanité parce qu’il avait simplement rappelé que la traite musulmane et l’esclavage interne au monde africain avaient été plus importants en durée et en nombre de victimes que la traite atlantique organisée pendant trois siècles par les Européens qui y mirent eux-mêmes un terme. Sylvain Gouguenheim fut lui même ostracisé pour avoir montré, dans son Aristote au Mont Saint Michel, que l’Europe médiévale n’avait pas attendu les traductions des auteurs arabes pour redécouvrir le Stagirite…
Le terrain est, on le voit, bien miné mais la résistance est en marche. L’enseignement de l’histoire est aujourd’hui, sauf en de trop rares exceptions, un champ de ruines mais la demande sociale a rarement été aussi forte. L’extraordinaire sursaut mémoriel observé à propos du centenaire de la première guerre mondiale est là pour le prouver. En d’autres domaines, l’histoire militaire, celle du Moyen Age, l’archéologie, la généalogie, l’histoire napoléonienne, l’intérêt pour les reconstitutions et le quotidien de nos ancêtres, celui, grandissant, porté au patrimoine sous toutes ses formes, le succès d’émissions télévisées avancées aux heures de grande écoute, le maintien d’une production historique satisfaisante sur le plan éditorial, dans un secteur par ailleurs sinistré, sont autant de signes encourageants. Le succès des commémorations, en 1987 de l’avènement capétien, en 1989 de la Révolution (dans ce cas, pas forcément dans le sens espéré par ses promoteurs). en 1993 pour le bicentenaire de l’insurrection vendéenne confirment cette tendance lourde et doit nous encourager à écarter tout catastrophisme excessif. Une part importante de la société civile a en effet pris conscience, au niveau des familles, des désastres en cours depuis plusieurs décennies et la réaction est là. Elle profite aussi du retour identitaire très fort qui s’oppose partout aux effets catastrophiques du projet mondialiste, notamment sur le plan culturel. Contre le « village global » unifié par la technique et par le sabir angloïde, contre la pseudo-Europe de Bruxelles qui s’accommode très bien d’être privée d’histoire, notamment de ses racines chrétiennes (il ne faut pas décourager les masses de futurs immigrants en attente de l’autre côté de la Méditerranée), le combat engagé est une lutte de longue haleine qui doit mobiliser les esprits et les énergies, dans les salles de classe où officient encore d’authentiques professeurs, dans les familles demeurées attachées à la transmission du savoir et de la culture, dans les associations… Des exemples récents nous montrent que ce combat est porteur d’avenir. Libérée de soixante-dix ans d’un régime communiste censé « faire table rase du passé », la Russie a retrouvé tous ses fondamentaux historiques et culturels, une condition nécessaire à la reconstitution de sa puissance. Plus près de nous, le peuple suisse sanctionne régulièrement dans les urnes le « politiquement correct » que tente de lui imposer l’oligarchie transnationale et il en va de même du peuple hongrois, bien décidé à ignorer les diktats de Bruxelles ou de Berlin et les leçons de morale qui lui sont prodiguées.
Il ne tient qu’aux Français de se retrouver, au delà de clivages devenus obsolètes, dans la reconquête de leur identité devenue incertaine.
Philippe Conrad (Institut Iliade, 7 avril 2018)