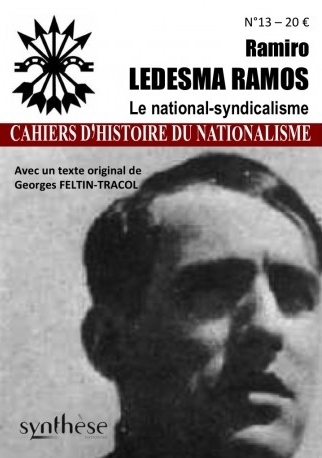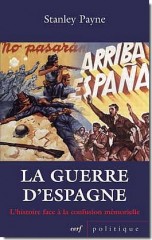José Antonio Primo de Rivera, le politicien-poète du XXe siècle
« En hissant notre drapeau, nous allons le défendre joyeusement, poétiquement. Parce qu’il y a des gens qui croient que pour unir les volontés […] il faut cacher tout ce qui peut susciter l’émotion ou indiquer une attitude énergique et extrême. Quelle erreur ! »
Ce drapeau que José Antonio Primo de Rivera voulait hisser était évidemment un drapeau politique. En le levant, il ajoutait : « Les peuples n’ont jamais été conduits que par les poètes, et malheur à celui qui ne sait pas élever, face à la poésie qui détruit, la poésie qui promet. »
Jamais de tels mots – la conjonction du poétique et du politique – n’avaient résonné avec autant de force dans l’espace public. On ne les avait même jamais entendus à des époques – polis grecque, res publica romaine, monarchie de droit divin – où une sorte de souffle sacré soufflait sur le politique.
Mais qu’en est-il aujourd’hui, alors que la vie politique est devenue une prosaïque affaire de marchands ? Ces paroles – prononcées le 29 octobre 1933 lors de la cérémonie de fondation de la Phalange espagnole – paraissent à nos oreilles modernes aussi extravagantes que bizarres, et ce malgré le fait – ajoutera-t-on peut-être – qu’elles sont esthétiquement fort jolies. Oh oui, elles sont fort jolies, on peut le dire ! Et elles sont très bien dites, ajoutera-t-on sans doute aussi ! Et qu’il était beau, ce pauvre homme, vraiment ! Et cetera.
La conciliation des contraires
La conjonction du poétique et du politique – la tentative de mobiliser les masses en invoquant un souffle poétique ou spirituel – est, il est vrai, une contradiction dans les termes. Mais il y a contradiction et contradiction. Il y a, d’une part, les contradictions affreuses, les non-sens dépourvus de sens. Et il y a, d’autre part, la Grande Contradiction – l’« étreinte des contraires », comme je l’appelle – qui, comme Héraclite le savait déjà, conduit le monde et la vie : cette vie qui n’existerait jamais sans être aiguillonnée par la mort ; ou cet ordre de l’intelligible qui n’existerait jamais sans être entrelacé avec celui du sensible ou de l’émotion.
Qu’est-ce que ce désir, qu’est-ce que ce combat ? Il s’agit d’une aspiration et d’une lutte – l’essence même du projet joséantonien – où s’entremêlent deux termes on ne peut plus contradictoires : révolution et conservation. La révolution qui conduit à rompre avec l’ancienne conception rétrograde du monde, tout en conservant tout ce que, de la tradition, il est impératif de préserver.
C’est là, dans cet embrassement des contraires, que se situe la conjonction du politique et du poétique : dans le combat qui, nécessairement enlisé dans la boue de l’espace public, est animé d’une aspiration poétique ou spirituelle.
Le nœud de la révolution et de la conservation
Ce qu’il faut rompre, selon José Antonio, ce sont les flagrantes injustices sociales du capitalisme libéral (non pas, bien sûr, pour les remplacer par les injustices bien pires du socialisme). Mais ce à quoi il faut mettre également fin, c’est au dépérissement des choses, à la perte de leur sève ou de leur substance : cette conséquence de l’individualisme et du matérialisme qui conduit, écrit-il, « non pas à la mort par catastrophe, mais à la stagnation dans une existence sans grâce ni espoir, où toutes les attitudes collectives naissent chétives […] et où la vie de la communauté s’aplatit, s’entrave, sombrant dans le mauvais goût et la médiocrité ».
Face à cette vie médiocre et chétive, il s’agit d’élever son souffle poétique, de miser sur la renaissance spirituelle d’un monde gouverné aujourd’hui par des désirs matériels exclusifs et présidé par l’égalité et les libertés que, contrairement à ce que prétendent ses ennemis, José Antonio ne rejette nullement. Au contraire, tout en regrettant leur caractère purement formel, il cherche à les revitaliser, à leur donner un sens et un contenu réels.
C’est pourquoi il écrit : « Lecteur, si tu vis dans un État libéral, essaie d’être millionnaire, beau, intelligent et fort. Alors, oui […], la vie est à toi. Tu auras la presse pour exercer ta liberté de pensée, des automobiles pour exercer ta liberté de mouvement. Si tu n’en as pas, si tu n’es pas au cœur du pouvoir économique, tu resteras dans le caniveau. »
La nation au cœur
Et avec tout cela, l’Espagne, la Nation : cette « unité de destin ».
La nation, la patrie : le grand pilier de cet ordre substantiel et organique pour lequel José Antonio plaide et qui est aux antipodes de ce que Zygmunt Bauman appelle la « modernité liquide ».
La nation, la patrie : le lieu de la tradition, des origines, du destin. De tout ce sans quoi nous ne serions rien ni ne dirions rien.
La nation, l’histoire, la tradition : cette lave incandescente qui se déploie au fil des siècles, reliant les vivants aux morts et les projetant vers ceux qui viendront à l’avenir.
La nation : la négation du nationalisme étroit, maussade, grossier, car la patrie, comprise comme elle doit l’être, représente la négation même du patriotisme grossier, plat, chauvin.
La nation : cette unité de destin qui s’oppose au terroir, dont José Antonio combat farouchement l’étroitesse provinciale.
Et le franquisme dans tout cela ?
Quel rapport tout cela a-t-il avec le régime mis en place après la victoire du camp national dans la guerre civile ? Le franquisme a fait de José Antonio un saint et a porté la Phalange sur les autels ; mais ses idéaux n’avaient pas grand-chose à voir avec la réalité de ce régime prosaïque, gris, de plus en plus bourgeois, si éloigné du souffle poétique qui « conduit les peuples ».
Qu’y avait-il de commun entre « l’Espagne joyeuse et en jupe courte » prônée par José Antonio et l’Espagne pudibonde, aux vêtements bienséants et à la pruderie dominante que l’on encourageait du haut des chaires ? La vérité, c’est qu’au-delà des apparences, au-delà de l’attirail de ceintures, d’escadrons et de chemises bleues, les deux n’ont pratiquement rien à voir.
Quinze jours avant d’être fusillé, et alors qu’il se proposait comme médiateur pour essayer de faire cesser l’affrontement mortel entre les deux camps, José Antonio avait eu lui-même l’intuition de tout ce qui le séparait du franquisme naissant. En des termes sommaires – ce sont les notes d’un brouillon – mais profonds et durs, il avait analysé la nature sociale, politique et idéologique de ceux qui avaient pris les armes.
La grandeur de José Antonio
« Un groupe, écrit-il, de généraux d’une médiocrité politique désolante. De purs clichés élémentaires (ordre, pacification des esprits…). Derrière eux : 1) le vieux carlisme intransigeant, borné, inamical. 2) Les classes conservatrices, intéressées, myopes, paresseuses. 3) Le capitalisme agraire et financier, c’est-à-dire : […] l’absence d’un profond sens national ».
Le profond sens national, la clairvoyance, le regard d’aigle : voilà ce qui caractérisait l’homme qui, par un de ces miracles qui ne se produisent que de loin en loin, réunissait deux traits extraordinaires : celui d’un combattant aguerri au combat acharné de l’arène politique, et celui d’un penseur profond et subtil, consacré aux grands défis de l’esprit.
Mais ce miracle fut de courte durée, à peine cinq ans. La rafale d’un peloton de miliciens l’a tué. Ceux qui ont appuyé sur la détente sont pareils aux pilleurs de tombe qui s’imaginent aujourd’hui pouvoir effacer la présence de José Antonio. Vaine tentative ! Car ils ne peuvent rien contre la présence et la mémoire du seul politicien-poète, du seul politicien-philosophe de l’histoire espagnole.
Javier Portella, traduction d’Arnaud Imatz (Site de la revue Éléments, 24 mai 2023)