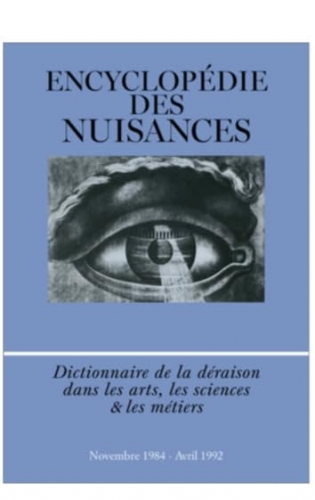Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de César Cavallère cueilli sur le site de l'Institut Georges Valois et consacré à la philosophie du travail des GAFAM...

Corporate Memphis et la philosophie du travail des GAFAM
Art vectorisé, aplats de couleur pop, formes courbes, silhouettes minimalistes, personnages distordus. Vous avez sûrement déjà aperçu ce style graphique, puisqu’il était omniprésent sur l’internet grand public de ces dernières années. Un style qui ne ressemble à rien, et qui ne parle (presque) à personne.
I. La naissance d’un style sans visage
En 2013, Apple commence à déployer des visuels avec des personnages de profil en 2D, faisant un premier pas dans l’appropriation du style postmoderne. En 2017, l’agence média Buck livre à Facebook un écosystème d’animation alors nommé « Alegria ». La commande visait à rajeunir l’esthétique du réseau en perte de vitesse, déjà en proie au vieillissement de sa base d’utilisateurs. Dans les mois et les années qui suivirent, des dizaines et des centaines de marques copièrent le style graphique Alegria, jusqu’à ce que partout où l’utilisateur se promène sur la toile il tombe sur ce style impersonnel. Le « Corporate Memphis » était né.
Google, Facebook, Apple, Indeed, Hinge, Slack, Spotify, Uber, AirBnB. Vous avez forcément aperçu ces personnages grossiers aux épaules et aux mains exagérément volumineuses et aux têtes minuscules. Là où le style postmoderne est abstrait, le Corporate Memphis, appliqué à une fonction particulière, représente des objets. Dans les saynètes déconstruites du Memphis Corporate, la technologie semble permettre la réunion d’individus en des communautés heureuses. Ce lien indépassable entre technologie, travail et bonheur nous rappelle que tous ces produits proviennent directement de la Silicon Valley.
Cette esthétique qui paraît absolument neutre, avec des personnages asexués et aux origines indéterminées, est porteuse d’une idéologie. Nous sommes heureux quel que soit le genre que nous avons choisi, notre sang est sans importance, et le travail rend heureux.
Dans La Société du spectacle (1967), Guy Debord écrit que « [t]out ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. » C’est ce que fait le Corporate Memphis : les personnages, les scènes de travail, les relations humaines ne représentent plus le réel. On ne cherche plus à figurer la vie ou les situations concrètes, mais à imposer une image : celle d’un monde sans conflit, éternellement pacifique.
Et nous pensons tous à la même chose en voyant ce produit industriel apparaître sur les réseaux, comme une image rémanente se reproduisant jusqu’à la nausée derrière nos paupières. « Il n’y a pas d’alternative ». Il n’y a aucune échappatoire. Il n’y a pas d’alternative. C’est le récit de la réplication massive d’un mensonge que tout le monde sait faux, à moins d’être aliéné.
II. L’utopie graphique et son idéologie cachée
Avec cette esthétique, le but pratique recherché par les entreprises du privé est de combler des vides dans les diapositives, ou bien d’illustrer des documents internes et externes en utilisant une grammaire « positive ».
Il se trouve que cette imagerie nous laisse une impression d’être sans âme et paresseuse, notamment parce que des entreprises grand public du secteur numérique (Adobe, Meta) proposent des générateurs de Corporate Memphis, qui ont permis sa large appropriation par les professionnels et les particuliers.
Quel plaisir de travailler ! Nos personnages lisent des graphiques avec le sourire, préparent des diapo avec apaisement, le contentement général étant suggéré par une palette chatoyante. Il s’agit d’une tentative grossière de dépeindre un monde idéal, bien à l’opposé du monde qu’induit la vente massive des informations personnelles des utilisateurs des produits des GAFAM.
Comme Nick Land l’anticipait, l’époque postmoderne est celle de la fusion de la culture et de l’économie : tout devient un contenu capitalisable. Le Corporate Memphis est une interface qui permet d’intégrer nos affects, notre parcours, nos pensées, et d’en faire un produit.
Le Corporate Memphis est une promesse : celle d’un monde sans danger, sans conflit, dans lequel tous s’aiment et collaborent. Mais ce monde n’existe pas. Cette utopie graphique nous met mal à l’aise précisément parce qu’elle est une propagande qui ne dit pas son nom. Tous ces éléments visent à créer artificiellement une culture d’entreprise « positive ». Mais quelle culture, quelle identité pourrait émerger si toutes les entreprises se raccrochent aux mêmes valeurs et à l’exacte même imagerie générique ?
Cette culture d’entreprise universelle était le parfait appeau pour les milléniaux (en principe progressistes) de classe moyenne-supérieure. Cette esthétique reprend les codes de la culture hipster : chemise à carreau, lunettes carrées, bretelles, pouf, baby-foot. Work hard and play hard. On sent d’ici le Starbucks et les chaises du bar branché d’afterwork pour cadres dynamiques faites en palettes. Le Corporate Memphis ne nous renseigne pas sur le produit vendu, mais seulement sur la sociologie visée par la marque : le millénial progressiste de classe moyenne-supérieure.
Il croit à l’émergence de nouvelles formes de travail, il entretient un syndrome de Stockholm avec sa boîte malgré ses multiples burn out, il veut croire au mensonge qu’on lui sert, parce qu’il aime le reflet qu’il y voit, le récit qui justifie son salaire et son mode de vie. Les milléniaux sont une génération cobaye. Cobaye de l’idéologie du cool, de l’hyperconnexion, de l’injonction à l’inclusivité et de l’acceptation du bullshit job.
Aujourd’hui, les marques les plus importantes ont purgé leur image de tout Alegria, tant le style est devenu impopulaire, et principalement auprès des zoomers.
Inclusivité surjouée : l’imagerie de l’inclusion
Cette dimension inclusive s’exprime par les proportions des personnages, qui sont volontairement distordues, avec une tête trop petite et un torse surdéveloppé. Nous pourrions dire que cette esthétique s’inscrit dans le « bodypositivisme » en mettant en valeur l’obésité et en déformant des personnages supposément normalement proportionnés au départ. Les personnes de toute ethnie ou race sont surreprésentées, mais les personnages peuvent être verts, jaunes ou violets. Il est souvent difficile de déterminer le sexe ou l’ethnie des personnages vus.
Plusieurs critiques furent émises : saturation quant à l’omniprésence dans les contenus professionnels ou sur les réseaux sociaux. Ce style est aussi largement repris dans la bande dessinée marquée à gauche, notamment féministe et antiraciste. Cette utilisation accuse une collusion entre deux mondes : les GAFAM et la gauche libérale.
L’inclusivité ne s’exprime pourtant pas vraiment dans les entreprises qui assurent avoir des « valeurs ». Par exemple, beaucoup ne garantissent pas de droit à la déconnexion, gardent d’importantes disparités salariales entre les postes, et sont peu enclins au dialogue social.
Les « politiques d’inclusivités » sont d’ailleurs assez circonscrites sociologiquement. Ce n’est pas l’actionnariat qui va laisser la moitié des parts aux femmes, le paritarisme – quoiqu’on en pense par ailleurs – ne sera non plus jamais recherché pour la main d’œuvre non ou peu qualifiée, et enfin le PDG ne laissera pas sa place à une femme « pour le principe ». Seule la catégorie CSP+ sera concernée : il n’y aura pas de programme d’inclusivité pour le personnel de ménage.
Cette proximité qui semblait évidente entre GAFAM et idéologie progressiste semble pourtant en reflux depuis quelques années, comme en témoignent les exemples de Musk et de Zuckerberg. Les marques affichent de moins en moins leur soutien au mois des fiertés, déjà devenu un vestige du passé. Le mouvement LGBT et le style Memphis sont tous les deux apparus pour le grand public vers 2016 et ont décliné ensemble dès l’aube de 2023.
Réalisme capitaliste et recyclage du temps
En 2009, Mark Fisher, professeur de philosophie britannique publie Le réalisme capitaliste. N’y a-t-il pas d’alternative ? Le terme d’abord forgé comme une parodie du « socialisme réaliste » a pris une autre consistance sous la plume de Fisher : « Le réalisme capitaliste tel que je le conçois ne peut être confiné à l’art ou au fonctionnement quasi propagandiste de la publicité. Il est plutôt une atmosphère généralisée, qui conditionne non seulement la production culturelle, mais aussi la réglementation du travail et de l’enseignement, et qui agit comme une sorte de frontière invisible contraignant la pensée et l’action. »
Fisher dit encore : « Le réalisme capitaliste ne peut être attaqué que si l’on démontre d’une façon ou d’une autre son inconsistance ou son caractère indéfendable ; c’est-à-dire si ce qui est apparemment « réaliste » dans le capitalisme s’avère n’être rien de tel. » selon lui, le réalisme capitaliste est parvenu à imposer une pensée entrepreneuriale, qui s’étend à la société.
III. LinkedIn : vitrine du capitalisme cool
Ce n’est pas un hasard si LinkedIn a fait du Corporate Memphis l’horizon de son réseau social. Le Corporate Memphis et LinkedIn sont deux faces du même réalisme capitaliste : un présent perpétuel sans alternative, masqué par des images de bonheur et traversé par une injonction narcissique à afficher son contentement.
Linkedin comme espace performatif
Le CSP+ sous antidépresseur est content de se lever chaque matin à 5h30 pour donner une leçon de bullshit à ses collègues. La petite dinde diplômée est ravie de faire des teambuildings au lieu de passer du temps avec ses vrais amis ou avec sa famille. En tout cas le pensent-ils. C’est ce qu’ils disent sur LinkedIn, d’ailleurs.
:emoji fusée : Chacun a une histoire de succès professionnel ou personnel inspirante (« avant j’étais en fauteuil roulant mais depuis j’ai réussi à me faire pousser de nouvelles jambes »). À la manière du Memphis Corporate, ce réseau a comme mot d’ordre le même principe qu’une règle implicite de LinkedIn : ne montrer que le positif. Les utilisateurs savent bien qu’ils doivent montrer au reste du panier de crabes à quel point ils sont des winners. Un profil LinkedIn vise à améliorer sa crédibilité vis-à-vis de ses collègues, et au regard des autres entreprises. Comment les utilisateurs pourraient être honnêtes alors même que le seul moyen pour se mettre en avant, c’est de travestir la réalité ?
Alors ils publient, pour raconter à quel point leur motivation a fait la différence, combien ils ont travaillé dur, comment ils ont réussi à sacrifier leur vie personnelle et à ne prendre aucun temps de loisir. Un junior qui ne raconte pas sa success story à la pause midi a-t-il seulement sa place dans la boîte à bullshit ? Le rêve américain est devenu le quotidien du petit cadre du tertiaire, qui romantise sa carrière chaotique à coups de ChatGPT.
Le narratif « girlboss » suit le même schéma : si une femme est dans une situation professionnelle précaire, alors c’est la faute au manque d’inclusivité. Si au contraire elle atteint une place enviable (fusse au titre de quotas et moyennant des politiques d’inclusivité), elle est la seule actrice de son succès. Et d’ailleurs, grâce à ces 5 conseils, toi aussi tu vas pouvoir atteindre tes objectifs comme moi.
Le Cadre aura à peu ou prou le même discours que le « coach » perdu dans sa réorientation et sa cinquantaine après un burn out, ou de celui de l’influenceur vous vendant un obscur Ponzi. Tout le monde souhaite nous « accompagner vers la réussite » ; à se demander pourquoi tout ce beau monde nous harcèle plutôt que de réussir lui-même. Ces personnages de Houellebecq, d’une post-modernité qui implique de décréter le cool et de manifester son contentement en dépit des calmants ingérés, vivent pour et à travers leur travail, et ce en dépit de l’absence cruelle de sens.
La fusion du privé et du professionnel :
Plus inquiétant encore, les utilisateurs parlent maintenant de leur intimité : la maladie d’un proche, leur mariage ou l’arrivée d’un nouveau né… Le privé s’est invité dans un espace professionnel, brouillant encore la frontière entre les deux grandement, grandement fragilisée depuis le temps du confinement. Nick Land parlait de «fusion postmoderne de la culture dans l’économie ».
La technologie est la pierre angulaire de cette intrusion, brouillant les habitudes, comme le capitalisme a pour habitude de brouiller nos repères temporels, comme a pu le faire remarquer justement Jameson. Nous utilisons les mêmes application pour prévenir d’un retard au travail que pour annoncer nos fiançailles sur le groupe familial. Refuser chaque pénétration insidieuse de l’environnement professionnel dans notre vie est suspect. Nous sommes supposés être amis si nous sommes collègues, non ? Et si l’on ne veut pas manger, jouer et dormir avec ses collègues, a-t-on vraiment sa place dans l’équipe ? Ça n’est pas la valeur de notre entreprise.
L’idéologie managériale a intoxiqué les réseaux sociaux, au même titre que la pub. LinkedIn, par sa forme, la présentation des profils, des expériences professionnelles, est en lui-même porteur d’une idéologie. Le problème de l’utilisation de ce réseau ? La concurrence. Il faut générer de l’engagement, et ce régulièrement pour ne pas passer à la trappe. Comme s’il s’agissait d’une extension de notre travail.
L’envers du décor : frustration et soumission
Le travailleur ne vend plus seulement sa force de travail, mais devient lui-même marchandise. Il est une marque, avec un récit motivationnel aussi original qu’une lettre de motivation.
Depuis quelques années, il est possible de remarquer une multiplications des comptes de « bots » et des publications par IA. En début 2024, la plateforme a supprimé 70 millions de faux comptes. Ce n’est pas sans rappeler la théorie de l’internet mort, qui postule qu’après avoir atteint un certain stade dans le développement des machines-outils, la plupart des actions seront menées par des robots. Aujourd’hui déjà, sur la plateforme, la plupart des interactions sont le fait de bots, et cela ne semble pas inquiéter, et le problème pourrait être facilement réglé. Ils font exactement ce qu’attend d’eux la plateforme, à savoir répliquer les schémas de publications, comme un utilisateur normal le ferait. L’IA standardise les contenus. Pourquoi utiliserais-je mon précieux temps pour écrire une publication inspirante alors même que ChatGPT peut faire une chimère des milliers de posts similaires ?
En dépit de ce constat d’un fonctionnement absurde, le Cadre peut se sentir obligé d’assumer régulièrement ce masque social en postant régulièrement. Parce qu’il a déjà un compte, parce que c’est ce que fait sa classe, par peur de se retrouver sans rien, par compensation d’une vie personnelle sans intérêt.
Cependant, ce Cadre aura rencontrera des difficultés pour moralement supporter la mise en concurrence avec les winners du monde entier, et encore plus après qu’ils aient très favorablement embelli leur histoire. De plus, il s’agit de se vendre soi-même dans une dimension intime. Cette auto-objectivisation a de quoi rendre dépressif plus d’un aliéné.
Pour cette raison, Linkedin est tout à fait à l’image de l’idéologie actuelle du management.
« Ici on est comme une grande famille »
L’idéologie managériale s’exprime aussi par le refus de la verticalité. Le N+1 va se comporter comme l’égal de l’employé pour lui donner les directives de façon détournée. « ce serait bien que tu fasses ça », signifie « fais ça ». Ce qui est d’autant plus pernicieux. Le manager ne supporte pas d’assumer l’autorité, il est obligé d’être ton « pote » et de ramener des croissants pour le petit déjeuner (si tu n’es pas sage, seras-tu privé de goûter ?). Si tu travailles bien, peut-être auras-tu la chance de siroter une IPA avec lui après le travail. Les rapports de force semblent absents, mais ce n’est qu’en apparence. Ils existent réellement, et la domination n’en est que plus forte.
Impossible de parler de LinkedIn sans parler de la sémantique et du vocabulaire. Certains mots jargonneux sont associés à une idée positive, même (et surtout) s’il ne veulent rien dire. Les mots sont utilisés pour l’apparence qu’ils donnent, comme un signe de reconnaissance. Si je dis être assertif, motivé, etc. Évidemment, les anglicisme sont des mets de choix, en particulier pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Lorsque le vocabulaire est français, il y a toujours le risque qu’on se rappelle que ça ne veut rien dire. Les anglicismes et les néologismes se transforment en jargon.
Jameson l’avait bien vu dans Postmodernisme et société de consommation : « un monde dans lequel l’innovation n’est plus possible, [où] on ne peut plus qu’imiter des styles morts, parler avec des masques, en empruntant la voix des styles, dans le musée imaginaire ».
Une bombe à retardement
L’esthétique du Corporate Memphis et la rhétorique LinkedIn ne représentent pas la réalité, elles la masquent pour pacifier la conflictualité sociale. Mais cette idéologie, en étouffant toute colère, favorise-t-elle vraiment la résolution des conflits ? Les paroles et les représentations mielleuses sont supposément censées neutraliser l’accès de violence. Mais sans échappatoire à la frustration, elle ne peut que s’accumuler, jusqu’à l’explosion ou la folie.
César Cavallère (Institut Georges Valois, 19 octobre 2025)