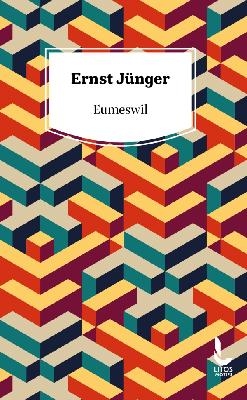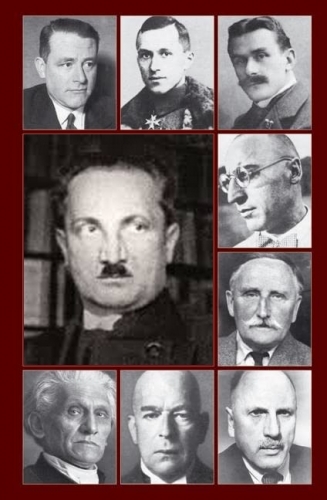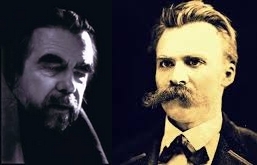Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle droite allemande
Entretien avec Martin Lichtmesz
La Nouvelle Droite (Neue Rechte) est une école de pensée et un réseau organisationnel vaguement défini qui vise à faire revivre et à réinterpréter de manière constructive la tradition conservatrice de la droite allemande, en opposition à l'ordre libéral américanisant qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Elle se situe à la droite des partis centristes de droite CDU/CSU et, dans un sens, va au-delà du populisme de droite (AfD, PEGIDA) et du radicalisme de droite (par exemple, Die Heimat). En tant qu'école de pensée, elle est à la fois « postérieure » et « antérieure » à ses antécédents politiques et idéologiques du 20ème siècle. Elle a été fondamentalement influencée par les penseurs et les théories de la Révolution conservatrice allemande et de la Nouvelle Droite française. Une différence importante, cependant, est que cette dernière est basée sur un retour au paganisme, alors que le mouvement allemand est (principalement) basé sur le christianisme. Dans l'entretien suivant avec Martin Lichtmesz, membre autrichien éminent de la Nouvelle Droite allemande, nous discutons de son parcours personnel, de son travail de traducteur et d'écrivain, de la Nouvelle Droite allemande, de l'Europe centrale et des possibilités offertes par la politique. L'entretien avec Balázs György Kun peut être lu ci-dessous.
- Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis né à Vienne en 1976, j'ai vécu à Berlin pendant quatorze ans et je suis retourné dans mon pays d'origine, l'Autriche, il y a une dizaine d'années. Depuis 2005, j'écris pour des magazines et des revues allemands de droite, tant sur papier qu'en ligne. Actuellement, je contribue principalement au blog et au magazine bimensuel Sezession, ainsi qu'à l'Institut für Staatspolitik (Institut pour la politique de l'État) en Allemagne. En plus d'écrire des livres sur des sujets tels que la politique, la culture et la religion, j'ai traduit plusieurs textes du français et de l'anglais, dont le plus réussi est la célèbre dystopie sur l'immigration de Jean Raspail, Le Camp des saints. Je suis associé à la branche autrichienne de Génération identitaire (GI), bien que je ne participe pas à ses activités. Il m'arrive de faire du streaming avec mon ami Martin Sellner. J'apparais aussi parfois sur des chaînes anglophones.
- Vous avez beaucoup écrit sur les films sur le site Sezession et vous avez également publié un livre sur le cinéma allemand après 1945 (« Besetztes Gelände. Deutschland im Film nach '45 »). Quel est votre réalisateur hongrois préféré et pourquoi ?
- En fait, je connais très peu le cinéma hongrois... Plusieurs films de Miklós Jancsó ont eu une grande influence sur moi, en particulier Csillagosok, katonák (1967). Sátántangó (1994) de Béla Tarr a été une expérience époustouflante, bien que sombre et épuisante. J'ai assisté à deux projections complètes de ce film, ce qui est un véritable test d'endurance puisqu'il dure près de huit heures à un rythme très lent et « hypnotique ». J'ai également apprécié My 20th Century (1989) d'Ildikó Enyedi. J'ai particulièrement aimé la scène où l'acteur autrichien Paulus Manker reprend son rôle de philosophe misogyne Otto Weininger, un rôle qu'il avait déjà joué dans son propre film de folie Weiningers Nacht. Je viens de remarquer, en passant, que les trois films que j'ai mis en évidence sont en noir et blanc.
- Comment décririez-vous la Neue Rechte à nos lecteurs ?
- Il s'agit d'un terme générique, non dogmatique, pour désigner le spectre de la droite « dissidente » et non conventionnelle en Allemagne. Il est surtout utilisé comme un terme générique pratique, et tous ceux qui sont classés dans cette catégorie ne l'apprécient pas ou ne l'acceptent pas. Il fait généralement référence aux personnes ayant des opinions «identitaires », ethno-nationalistes. Parmi les personnes orientées idéologiquement, nous trouvons très souvent ce que nous appelons des « Solidarpatrioten », qui optent pour une position patriotique dans leur approche des questions socio-économiques, qui critiquent le libéralisme du marché libre et les autres variantes du libéralisme. Une position « anti-atlantiste » est très courante dans ce milieu: il s'agit d'un souverainisme qui vise à libérer l'Allemagne de la domination américaine sur le long terme (de manière réaliste, donc à très long terme). Elle est également souvent utilisée comme auto-désignation par ceux qui souhaitent se démarquer des groupes restants de la « Alte Rechte » (« vieille droite »), qui forment un milieu très différent et se caractérisent par leur attachement à certaines nostalgies historiques, à certains symbolismes et à certaines idéologies que la nouvelle droite rejette. Il y a aussi beaucoup de recoupements récents avec le phénomène du « populisme de droite », qui monte en puissance depuis 2015 (au moins), même s'il n'est certainement plus à son apogée.
Le quartier général de la « nouvelle droite » en Allemagne se trouve aujourd'hui à Schnellroda, un petit village de Saxe-Anhalt, où se trouve le « manoir » de Götz Kubitschek, une demeure séculaire restaurée, qui abrite la maison d'édition Antaios Verlag, qui fait date depuis assez longtemps. Avec Erik Lehnert, Kubitschek organise des « académies » où de jeunes militants de droite allemands, autrichiens et suisses se réunissent pendant un week-end pour nouer des contacts communautaires et professionnels, écouter des conférences et des discours et participer à des discussions approfondies sur des sujets spécifiques. En septembre dernier, par exemple, le thème principal était la « propagande » sous tous ses aspects.
D'autres académies se sont penchées sur la géopolitique, l'anthropologie, l'architecture, « l'avenir de l'État-nation et de l'Europe », « l'État et l'ordre », « la politique des partis », « la violence », « la faisabilité » ou une discussion générale sur la situation politique actuelle. Les présentations sont d'une grande qualité intellectuelle et visent à couvrir autant d'aspects que possible du sujet. Cependant, il ne s'agit pas d'une « tour d'ivoire » philosophique et théorique, mais également d'une formation à des fins politiques et stratégiques pratiques. De nombreux participants travaillent au sein de l'AfD (Alternative für Deutschland), le parti d'opposition patriotique le plus important et le plus performant d'Allemagne. Il s'agit en particulier d'une partie importante de l'AfD des Länder « de l'Est », qui entretient de très bonnes relations et de très bons contacts avec Schnellroda.
Naturellement, le « pouvoir en place (et contesté) » n'aime pas cela et tente de faire pression sur ces organisations et réseaux indésirables, notamment par le biais des activités du « Bundesamt für Verfassungsschutz », l'« Office fédéral pour la protection de la Constitution », une institution créée par l'État pour diaboliser et diffamer toute opposition politique. En résumé, lorsque les Allemands parlent aujourd'hui de la « Neue Rechte », ils pensent surtout au réseau autour de Schnellroda, qui se compose d'identitaires, de membres de l'AfD, d'éditeurs indépendants, d'initiatives, de médias, de libres penseurs et d'« influenceurs ». Tous ne partagent pas les mêmes positions, mais ils ont une vision commune de base.
- La Nouvelle Droite (française) a une forte influence en dehors de la France et du monde francophone. La situation est-elle similaire pour la Neue Rechte? Dans l'affirmative, pouvez-vous citer quelques penseurs, hommes politiques et organisations qui ont été influencés par cette « école de pensée » en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays ?
- Pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup d'influence, voire aucune, en dehors de l'Allemagne, car très peu de nos écrits ont été traduits. Certaines actions de GI ont probablement été une source d'inspiration au niveau international, par exemple lorsqu'ils ont escaladé la porte de Brandebourg en 2016 et ont affiché une bannière disant « Secure Borders, Secure Future » (frontières sûres, avenir sûr). Nous sommes certainement en contact avec des personnes partageant les mêmes idées dans de nombreux autres pays européens, tant à l'Est qu'à l'Ouest, ainsi qu'aux États-Unis et en Russie. Cependant, une influence allemande plus importante est à l'œuvre en arrière-plan, car la Nouvelle Droite et la Neue Rechte ont toutes deux de fortes racines idéologiques dans ce que l'on appelle la « révolution conservatrice » des années 1920 et 1930 : les noms de célèbres penseurs classiques tels qu'Oswald Spengler, Carl Schmitt, Ludwig Klages, Ernst Jünger ou Martin Heidegger me viennent à l'esprit.
- Pouvez-vous nous présenter brièvement la maison d'édition Antaios ? Quels sont les livres que vous publiez ? Vous en avez cité quelques-uns qui vous paraissent importants.
- Antaios existe depuis plus de vingt ans. L'éventail des livres publiés est très large : ouvrages théoriques, essais, romans, débats, réflexions philosophiques, interviews ou monographies sur des penseurs et écrivains importants (Ernst Nolte, Georges Sorel, Armin Mohler, Mircea Eliade ou Nicolás Gómez Dávila, pour n'en citer que quelques-uns). Bien sûr, les thèmes habituels de la droite sont au centre : l'immigration de masse, le « grand remplacement », l'identité ethnoculturelle et l'analyse de la myriade de têtes d'hydre que constituent nos ennemis : la théorie du genre, l'antiracisme, le mondialisme, le transhumanisme, la technocratie ou le « cotralalavidisme ». Une série populaire et à succès est celle des « Kaplaken » : des livres courts qui tiennent confortablement dans une poche, écrits par différents auteurs sur différents sujets. Ils constituent une expérience de lecture rapide, instructive et souvent divertissante, un cadeau idéal pour éclairer et égayer amis et parents, et sont très recherchés par les collectionneurs. La série a publié jusqu'à présent 87 volumes.
Il est difficile d'identifier les « plus importants », tant ils sont nombreux, et je suis certainement un peu partial. Deux ouvrages théoriques ont été publiés récemment et ont été bien accueillis par les lecteurs : Politik von rechts (« Politique de droite ») de Maximilian Krah, homme politique de l'AfD, tente de définir l'essence et les contours de la politique de droite aujourd'hui, tandis que Regime Change von rechts (« Changement de régime de droite ») de Martin Sellner est une esquisse impressionnante et approfondie des stratégies métapolitiques nécessaires au changement en Allemagne et en Europe occidentale, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait auparavant sous une forme aussi détaillée et concrète. Parmi les autres ouvrages très influents, citons Solidarischer Patriotismus (« Patriotisme solidaire ») de Benedikt Kaiser et Systemfrage (« La question du système ») de Manfred Kleine-Hartlage, une analyse tranchante de la difficile question de savoir si le changement est possible dans le cadre du système politique actuel (apparemment condamné) (l'auteur nie que ce soit possible).
Mit Linken leben (« Vivre avec la gauche ») de Caroline Sommerfeld et moi-même a également été un « best-seller » dans notre gamme, une sorte de « manuel de survie » pour les personnes ayant des opinions « erronées », conçu pour aider à gagner les débats, à s'omposer dans les débats, à s'orienter politiquement, à démasquer les absurdités de la gauche, à comprendre ses « types » et sa psychologie, et surtout à faire face aux pressions sociales dans la famille, au travail, à l'école, à l'université, dans les amitiés, etc. Son ton est plus "léger" que celui de la plupart de nos livres, et il contient même des conseils de drague pour les gens de droite ! Il a été publié en 2017, au plus fort de la vague ”populiste“ consécutive à la "crise des migrants", et je dois avouer que certaines parties me semblent déjà un peu désuètes et datées, comme si elles étaient maintenues dans une capsule temporelle. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé est Tristesse Droite, publié en 2015, qui documente quelques soirées au cours desquelles un petit groupe de défenseurs de la Nouvelle Droite (dont je faisais partie) s'est réuni à Schnellroda pour avoir une longue discussion ouverte - comme nous le disons - « sur Dieu et le monde », qui a duré des heures et a donné lieu à un livre très inhabituel, qui donne à réfléchir et qui est très intime.
- Avez-vous des projets de livres ou de traductions en cours ? Quels sont ceux que vous considérez comme les plus importants ?
- Il y a un projet majeur sur lequel je travaille depuis un certain temps et qui prendra encore plus de temps. Il s'agit d'une sorte de lexique des films que je considère comme importants ou valables d'un point de vue de droite. Je ne parle pas nécessairement de films « de droite » (il y en a peu qui peuvent être classés comme tels à 100 %), mais de films qui ont une valeur historique, intellectuelle et esthétique pour la pensée de droite. Ce projet s'est transformé en une sorte de projet gigantesque, car je me suis retrouvé avec environ 200 films que je voulais inclure. J'aimerais également ajouter quelques réflexions générales sur la question et la politique de la censure, la responsabilité de l'artiste, les tensions et les points communs entre l'art et l'idéologie, les bons et les mauvais côtés de la culture de masse (je pense qu'il y a des bons côtés), et le présent et l'avenir du visionnage de films à une époque entièrement numérique où le cinéma classique, du moins tel que je le conçois, est en train de mourir.
J'ai un livre plus ancien à mon actif, qui était en fait mon tout premier ouvrage, et que je considère toujours comme un bon travail (il appartient à d'autres de décider à quel point), intitulé « Besetztes Gelände » (« Territoire occupé », 2010), et qui est essentiellement un essai long mais tendu et poignant sur la représentation cinématographique de l'histoire, avec un accent particulier sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle de l'Allemagne.
Toutefois, à mon humble avis, mon livre le plus « important » et le plus ambitieux est « Kann nur ein Gott uns retten ? » (« Seul un Dieu peut-il nous sauver ? »). Il s'agit d'une méditation très profonde, forte de 400 pages, sur la nature de la religion et sa relation avec la politique (pour le dire de manière un peu simpliste), d'un point de vue (principalement) catholique ou plutôt (si j'ose dire) « catholicisant » (j'étais très influencé à l'époque par des auteurs comme Charles Péguy et Georges Bernanos). Néanmoins, je ne me considère pas comme un « vrai » catholique et je reste un « chercheur » plutôt qu'un « croyant ». Quoi qu'il en soit, j'ai mis toute ma vie et tout mon cœur dans cet écrit, et il s'agit avant tout d'une confession assez personnelle, même si j'ai essayé de la dissimuler autant que possible. Aussi, si un traducteur était intéressé, j'apprécierais beaucoup, car je ne pense pas avoir été capable d'aller au-delà de cet écrit.
- Legatum Publishing publiera prochainement une traduction anglaise de votre livre Ethnopluralismus (« Ethnopluralisme »). Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et sur sa pertinence ? Pourquoi le livre et l'idée d'ethnopluralisme sont-ils importants ? J'ai également une question plus complexe, et peut-être plus provocante, à propos de l'ethnopluralisme. Pour autant que je sache, c'est feu le sociologue et historien Henning Eichberg qui a commencé à utiliser ce terme, qui est rapidement devenu un concept important pour la Nouvelle Droite. Comment se fait-il alors que, selon le site web d'Antaios, vous soyez le « premier à présenter un compte rendu complet de ce concept, de ses possibilités et de ses interprétations erronées » ?
Il s'agit d'un malentendu. « Introduire » le concept ne signifie pas que je l'ai inventé, ni que j'ai inventé le terme « ethnopluralisme », qui a été forgé par Henning Eichberg en 1973 (dans un contexte anti-eurocentrique, anti-colonialiste, plutôt « de gauche »). Le point de mon livre est que l'« ethnopluralisme », comme l'« universalisme », est pluriel. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu une seule théorie ou un seul principe contraignant portant ce nom, mais plutôt différentes « versions » qui ne sont pas nécessairement désignées par ce terme. Mon livre est le premier à fournir une vue d'ensemble critique des théories ethnopluralistes, de leur contexte historique, de leurs éléments centraux et de leurs « prédécesseurs » intellectuels et conceptuels. Ma formule est la suivante : « J'appelle ethnopluralisme tout concept qui défend le nationalisme et l'ethnicité en général comme un bien inhérent ». En tant que position politique, c'est une position que la plupart des nationalistes modernes acceptent aujourd'hui comme principe selon lequel tous les peuples du monde sont considérés comme ayant le « droit » à l'auto-préservation et à l'autodétermination pour défendre leur identité ethnoculturelle contre les excès universalistes et l'uniformisation, communément appelés aujourd'hui « globalisme ».
Cette conception prétend avoir surmonté le chauvinisme et le « racisme » de la « vieille droite », qui considérait souvent les autres nations et races comme « inférieures » et donc comme des objets légitimes de conquête, d'asservissement et de colonisation. Au lieu de cela, les autres nations et races sont considérées comme « différentes », sans aucun jugement de valeur, dans une sorte de « relativisme culturel ». Il s'agit d'un nationalisme « défensif » plutôt qu'agressif et envahissant. Il s'agit d'un concept de « vivre et laisser vivre », confronté à une menace historique perçue par toutes les nations et ethnies du monde : un idéal utopique de « monde unique », le rêve de certains, le cauchemar d'autres, dans lequel toute l'humanité est unie sous un seul gouvernement mondial, surmontant toutes les barrières ethniques, raciales et même, de nos jours, de « genre ». Comme l'a dit Alain de Benosit : « Je ne me bats pas contre l'identité des autres, mais contre un système qui détruit toutes les identités ». Guillaume Faye parle, lui, d'un « système qui tue les peuples » et voit dans l'abolition des identités nationales l'aboutissement, la finalité du libéralisme. Ce déracinement ethnique peut prendre plusieurs formes, et l'on peut affirmer - au moins dans une certaine mesure - que la société technologique elle-même conduit inévitablement à la désintégration de la nation et de l'identité ethnoculturelle.
Dans le monde occidental, la manière la plus directe et la plus dangereuse de briser les nations est la politique d'immigration de masse, que Renaud Camus appelle « le grand remplacement ». La position ethnopluraliste, au contraire, souligne que le droit à la patrie et le droit à l'autodétermination doivent prévaloir dans les deux sens: nous, Occidentaux, ne chercherons pas à recoloniser le Sud, mais nous refuserons aussi d'importer le Sud dans notre propre pays.
Cependant, les idées ethnopluralistes n'avaient initialement rien à voir avec la prévention de l'immigration de masse (même dans les années 1970, lorsque Eichberg a développé son concept). Elles remontent au philosophe romantique allemand - et plutôt apolitique - Herder, qui, dès le XVIIIe siècle, était un représentant du mouvement romantique allemand. À la fin du XVIIIe siècle, Herder, philosophe allemand, considérait que la « Volksseele » (« l'âme du peuple », terme qu'il utilisait plutôt que le « Volksgeist », plus familier et plus hégélien) était menacée par l'essor de l'ère industrielle et les idées des Lumières universelles. Au cours du siècle suivant, Herder est devenu le parrain du particularisme et du nationalisme, en concurrence avec les autres grands courants idéologiques de l'époque, le libéralisme/capitalisme et le socialisme/communisme. Même dans ces grandes lignes, il est clair que j'ai une histoire assez longue et compliquée à raconter, et ce n'est que dans les derniers chapitres que j'aborde la Nouvelle Droite française et la Neue Rechte allemande.
Dans mon livre, je ne parle pas seulement de Herder et de Hegel, mais aussi de la critique païenne et polythéiste du christianisme (qui remonte à l'Antiquité), des « peintures monumentales » de l'histoire mondiale de Gobineau, Spengler et Rosenberg, qui cherchaient à proposer des théories du déclin et de la chute ; les idées de Julius Evola sur la « race intellectuelle » ; la vision de Renan sur la nation ; ou les théories proto-ethnopluralistes et culturalo-relativistes de Franz Boas et Ludwig Ferdinand Clauss. Ce dernier, d'ailleurs, était un théoricien de la race plutôt hétérodoxe qui travaillait dans le cadre du système national-socialiste. J'ai trouvé un certain nombre de parallèles et de chevauchements surprenants entre les deux, que personne, à ma connaissance, n'avait remarqués auparavant. L'une des figures de proue de mon livre est l'ethnologue Claude Lévi-Strauss - un autre penseur qui n'a jamais utilisé cette définition - qui est peut-être le théoricien le plus important de l'« ethnopluralisme » de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le cadre que j'utilise pour contextualiser le terme est emprunté au sociologue allemand Rolf Peter Sieferle, qui a écrit des livres qui ont fait date et qui éclairent l'émergence du monde moderne comme peu ont pu le faire.
Ce n'est que dans le dernier chapitre que j'exprime mes propres opinions, qui sont très différenciées. Je ne considère pas l'ethnopluralisme comme un concept philosophique vraiment durable et détaillé, et son utilité politique est assez limitée. En revanche, je le considère comme une « idée régulatrice » ayant une valeur essentiellement éthique.
En bref, c'est ce que je pourrais développer ici plus longuement, mais qui peut être mieux compris à partir de mon livre. La version anglaise comportera des mises à jour du texte, des ajouts et des chapitres supplémentaires. En fait, je pense qu'il s'agit d'un sujet qui, à première vue, semble simple, mais qui, en réalité, est très profond. Mon livre tente de donner un aperçu de cette « famille » d'idées et de ses opposants.
- Dans l'ensemble, que pensez-vous de Viktor Orbán en tant qu'homme politique ?
- Je ne peux pas aller trop loin dans ce domaine parce que je ne le connais pas assez bien, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour nous, identitaires d'Europe occidentale, Orbán - malgré ses nombreux défauts, il est vrai - est plutôt un modèle que nous admirons et que nous espérons suivre. La situation politique et métapolitique en Hongrie semble bien meilleure qu'ici. C'est un objectif que nous nous efforçons d'atteindre. D'un autre côté, contrairement à la Hongrie, nous sommes déjà confrontés au problème que notre pays est gravement endommagé par l'immigration de masse et une situation démographique défavorable. Je devrais demander à des Hongrois comme vous ce qui, selon vous, ne va pas avec Orbán et ses initiatives politiques.
- Que signifie l'Europe centrale en tant que région ou en tant que base d'identité, en tant que strate d'identité, pour la Neue Rechte et/ou pour votre vision personnelle du monde ?
- Je ne peux parler que de ma vision personnelle du monde, et elle est plus sentimentale ou esthétique que purement politique. Il fut un temps où j'espérais que l'Autriche pourrait rejoindre une sorte de bloc de Visegrád « populiste » qui s'opposerait aux politiques mondialistes de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne. Cela aurait été, en substance, une sorte de « redémarrage » politique de l'espace autrefois dominé par l'empire des Habsbourg, que je tiens en très haute estime. Aujourd'hui, je crains que cela ne se produise jamais.
Personnellement, même si je me considère comme étant plutôt abstraitement ou historiquement « allemand », mon identité immédiate n'est pas vraiment « teutonne », mais plutôt distinctement autrichienne, avec des sympathies pour l'Est européen. Si je regarde mon arbre généalogique et les noms qui y figurent, je suis en fait un « bâtard de l'empire des Habsbourg », avec des ancêtres (semble-t-il) hongrois, slovènes et tchèques. Pourtant, aussi loin que je puisse remonter, les différentes branches de ma famille sont restées à peu près dans la même zone géographique, ont parlé allemand et sont catholiques depuis au moins deux siècles.
- Pourriez-vous nous donner un aperçu des tendances politiques actuelles en Autriche ?
Je peux honnêtement dire que je trouve la politique autrichienne contemporaine plutôt fatigante, ridicule et ennuyeuse et que je vais rarement voter. Le pays est gouverné par l'ÖVP, un parti pseudo-conservateur/de « centre-droit » corrompu et mafieux qui est bien plus nuisible que n'importe lequel de ses « opposants » de gauche (il est actuellement en coalition avec les Verts). Mon dédain pour eux a pris des proportions démesurées pendant la folie des années Cov id, lorsqu'ils ont terrorisé pratiquement tout le pays, ce qui a au moins suscité une résistance saine, patriotique et « populaire » et une méfiance à l'égard des grands médias, qui sont d'horribles putes du pouvoir - je ne veux pas insulter les vraies prostituées en les comparant aux journalistes, car elles sont plus honnêtes et font au moins du bien à la société.
Le seul choix d'opposition disponible est la FPÖ (« Parti de la liberté »), qui est bien sûr également imparfait, mais qui a au moins un génie au sommet, Herbert Kickl, qui a été vilipendé comme "fou" par les médias il y a deux ans pour s'être opposé par principe aux « confinements » et aux vaccinations obligatoires, mais qui est maintenant - au moins selon les derniers sondages - l'un des hommes politiques les plus populaires d'Autriche. Certains prédisent déjà qu'il sera le prochain chancelier. Je suis plutôt pessimiste à ce sujet et, d'une manière générale, je n'ai guère confiance dans la politique parlementaire, qui ne fait généralement que peu ou pas de différence. Je crains un peu que le Kickl sortant ne déçoive et ne fasse trop de compromis, comme c'est généralement le cas pour tout candidat dont on attend une solution. Je l'admire tellement pour son courage, son intelligence et son honnêteté que j'aimerais qu'il reste «propre », ce qu'il ne peut faire qu'en étant dans l'opposition.
Martin Lichtmesz, propos recueillis par Balázs György Kun (Euro-Synergies, 30 mai 2024)