
Au sommaire :
- sur le blog du Choc du mois, Julien Jauffret mouche avec intelligence et courage le libéral droitier Claude Goasguen ;
Solidarité avec les sans-papiers ?
- sur Mécanopolis, Jean-Marc Desanti ajuste Sarkozy et sa stratégie du déclin.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Au sommaire :
- sur le blog du Choc du mois, Julien Jauffret mouche avec intelligence et courage le libéral droitier Claude Goasguen ;
Solidarité avec les sans-papiers ?
- sur Mécanopolis, Jean-Marc Desanti ajuste Sarkozy et sa stratégie du déclin.

Nous avions annoncé la parution aux éditions Res Publica de La fin de monde moderne, un essai d'Alexandre Rougé, journaliste vinicole et engagé, dont on peut lire les talentueux articles dans Le Choc du Mois. Nous reproduisons ici la préface que lui a donné, pour cet essai, Alain de Benoist. Bonne lecture !
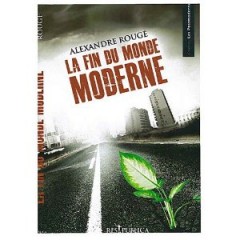
Préface à La fin du monde moderne
Au XVIIIe siècle, la modernité, dont les racines sont beaucoup plus anciennes, a trouvé sa légitimation théorique dans l’idéologie du progrès. Celle-ci, formulée notamment par Condorcet (Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, ouvrage posthume paru en 1795), s’articule autour d’une affirmation simple : l’humanité, depuis ses débuts, est engagée de manière unitaire dans une perpétuelle marche en avant qui associe l’amélioration de ses conditions d’existence à l’amélioration continuelle de l’homme. Il en résulte que la nouveauté (le novum) vaut pour elle-même au seul motif qu’elle est nouvelle. Cette marche en avant équivaut à un affranchissement du passé. Les sociétés traditionnelles déterminaient en effet leurs règles et leurs principes en fonction de ce qui paraissait avoir fait ses preuves dans le passé (la tradition, les ancêtres) : le terme grec archè renvoie aussi bien à l’« archaïque » qu’à ce qui fait autorité. C’est même l’ancienneté des coutumes qui en garantissait en quelque sorte la valeur. Convaincues de la réalité du progrès, les sociétés modernes se légitiment au contraire par une promesse d’avenir. Elles ne sont pas plus libres – bien qu’elles pensent souvent l’être –, mais déterminées par la certitude de « lendemains qui chantent » : l’hétéronomie par le futur remplace l’hétéronomie par le passé. C’est pourquoi elles tendent à ne voir que « préjugés » et « superstitions » dans la façon de faire des Anciens. Elles aspirent, elles, à un Homme nouveau, émancipé de tout ce qui, auparavant, faisait obstacle à la grande marche en avant du progrès.
L’idéologie du progrès est un historicisme. Reprenant la conception unilinéaire et vectorielle d’une histoire ayant un début et une fin absolus, qui provient de la Bible, mais en l’énonçant sous une forme profane (l’avenir remplace l’au-delà, tandis que le bonheur se substitue au salut), elle adhère de ce fait à l’idée de nécessité historique : l’histoire se dirige nécessairement dans une direction, et son trajet la porte nécessairement vers le meilleur. Mais c’est aussi un universalisme, car il s’agit d’une histoire globale, à laquelle tous les peuples sont également appelés à participer, certains d’entre eux pouvant seulement accuser du « retard », tandis que d’autres sont plus « en avance », ce qui autoriserait les seconds à presser les premiers de les rejoindre (et d’adopter leur modèle), fût-ce au prix de mesures coercitives. Comme déjà chez saint Augustin, l’humanité est regardée comme un seul et même organisme, indéfiniment perfectible et qui ne cesse de grandir.
Bien entendu, après Condorcet, les théoriciens du progrès, libéraux ou « progressistes », se diviseront sur la direction du progrès, le rythme et la nature des changements censés l'accompagner, éventuellement aussi sur ses acteurs principaux. Mais tous seront d’accord pour définir le progrès comme un processus accumulant des étapes, dont la plus récente est toujours jugée préférable et meilleure, c'est-à-dire qualitativement supérieure à celle qui l'a précédée. Cette définition comprend un élément descriptif (un changement intervient dans une direction donnée) et un élément axiologique (cette progression est interprétée comme une amélioration). Il s'agit donc d'un changement orienté, et orienté vers le mieux, à la fois nécessaire (on n'arrête pas le progrès) et irréversible (il n'y a pas globalement de retour en arrière possible). L'amélioration étant inéluctable, il s'en déduit que demain sera toujours meilleur.
Longtemps défendue comme un article de foi, l’idéologie du progrès ne s’en heurte pas moins aujourd’hui à des doutes qui ne cessent de s’étendre. Les totalitarismes du XXe siècle et les deux guerres mondiales ont sapé l'optimisme qui prévalait au siècle précédent. Les désillusions sur lesquelles se sont fracassées bien des espérances révolutionnaires ont suscité l'idée que la société actuelle, si désespérante et privée de sens qu'elle puisse être, est malgré tout la seule possible : la vie sociale est de plus en plus vécue sous l'horizon de la fatalité. L'avenir, qui apparaît désormais imprévisible, inspire plus d'inquiétudes que d'espoirs. L'aggravation de la crise paraît plus probable que les « lendemains qui chantent ».
Il n’y a plus grand monde aujourd’hui pour croire que le progrès matériel rende l'homme meilleur, ou que les progrès enregistrés dans un domaine se répercutent automatiquement dans tous les autres. Dans la « société du risque » (Ulrich Beck), le progrès matériel apparaît lui-même comme ambivalent. On admet qu'à côté des avantages pratique qu'il confère, il a aussi un coût. On voit bien que l'urbanisation sauvage a multiplié les pathologies sociales, et que la modernisation industrielle s'est traduite par une dégradation sans précédent du cadre naturel de vie. La destruction massive de l'environnement a donné naissance aux mouvements écologistes, qui ont été parmi les premiers à dénoncer les « illusions du progrès ». On redécouvre qu’il y a dans tous les domaines des limites ou des frontières. Les réserves naturelles ne sont pas inépuisables, et aucun arbre ne peut monter jusqu’au ciel. Même dans le domaine sportif, la recherche de la performance quantifiée atteint ses limites, puisque la plupart des records ne sont plus battus désormais que par des dixièmes ou des centièmes de seconde. Le développement de la technoscience, enfin, soulève avec force la question des finalités. Le développement des sciences n'est plus perçu comme contribuant toujours au bonheur de l'humanité : le savoir lui-même, comme on le voit avec le débat sur les biotechnologies, est considéré comme porteur de menaces. Dans des couches de population de plus en plus vastes, on commence à comprendre que plus n'est pas synonyme de mieux. On distingue entre l'avoir et l'être, le bonheur matériel et le bonheur tout court.
Pourtant, la thématique du progrès reste prégnante, ne serait-ce qu'à titre symbolique ou mythique. La classe politique continue d'en appeler au rassemblement des « forces de progrès » contre les « hommes du passé », et de tonner contre l'« obscurantisme médiéval » (ou les « mœurs d'un autre âge » de telle ou telle catégorie de population). Dans le discours public, le mot « progrès » conserve globalement une résonance ou une charge positive (« c’est quand même un progrès »). L'orientation vers le futur reste également dominante. Même si l'on admet que ce futur est chargé d'incertitudes menaçantes, on continue à penser que, logiquement, les choses devraient globalement s'améliorer dans l'avenir. Relayé par l'essor des technologies de pointe et l'ordonnancement médiatique des modes, le culte de la nouveauté reste plus fort que jamais. On continue aussi à croire que l'homme est d'autant plus « libre » qu'il s'arrache plus complètement à ses appartenances organiques ou à des traditions héritées du passé. L'individualisme régnant, conjugué à un ethnocentrisme occidental se légitimant désormais par l'idéologie des droits de l'homme, se traduit par la déstructuration de la famille, la dissolution du lien social et le discrédit des sociétés traditionnelles, où les individus sont encore solidaires de leur communauté d'appartenance. Mais surtout, la théorie du progrès reste largement présente dans sa version productiviste. Elle nourrit l'idée qu'une croissance indéfinie est à la fois normale et souhaitable, et qu'un avenir meilleur passe nécessairement par l'accroissement constant du volume de biens produits, que favorise la mondialisation des échanges. Cette idée inspire aujourd'hui l'idéologie du « développement », qui continue à regarder les sociétés du Tiers-monde comme (économiquement) en retard par rapport à l'Occident, et à faire du modèle occidental de production et de consommation l’exaltant destin de toute l'humanité.
*
L’idéologie du progrès a également été critiquée d’un point de vue théorique, cette critique s’étendant souvent (mais pas toujours) au monde moderne, puisque celui-ci a trouvé son principal vecteur dans cette idéologie. Pour résumer les choses de façon rapide, on peut dire que cette critique a, dans l’histoire des idées, emprunté deux formes principales.
La première est d’ordre métaphysique, et s’opère généralement au nom de la Tradition. Ceux qui en ont donné la formulation la plus rigoureuse, ou du moins la plus ambitieuse, se réfèrent en général à une Tradition primordiale, dont les hommes se seraient progressivement écartés. L’image de l’Age d’Or, reformulant la croyance au Paradis terrestre, n’est pas loin. En un lointain passé, les hommes auraient vécu dans l’harmonie résultant de leur respect ou de leur conformité à des principes éternels. Après quoi, par une série d’étapes s’enchaînant les unes aux autres de façon quasi nécessaire, ils auraient entamé une longue déchéance. « Comme la chute se continue jusqu’à épuisement des possibilités les plus inférieures de l’état terrestre, écrit Jean Borella, la société est forcée d’accroître les contraintes obligatoires. Les lois prolifèrent, tachant, sans y parvenir, de combler par leur démultiplication réticulaire le vide de plus en plus béant qu’engendre l’effacement des principes dans le cœur humain ». Il y a donc bien eu évolution, mais cette évolution, à partir d’une sorte de péché originel (l’entrée dans l’histoire ?), est en fait une involution. On remarquera qu’ici l’idée de nécessité historique, si présente dans l’idéologie du progrès, est conservée, mais que son sens est strictement inversé. Ce que les uns regardent comme progrès toujours plus accentué serait à interpréter comme déclin toujours plus affirmé. Dans cette perspective, le monde moderne est considéré comme l’apothéose du déclin, le point d’aboutissement d’une dissociation, d’une dissolution généralisée. (D’autres parleront de « fin de cycle », la nécessité historique gouvernant selon eux des cycles appelés à se succéder éternellement). L’homme a pris la place de Dieu, et finalement ce sont les objets qui ont pris la place de l’homme.
Telle est par exemple la critique formulée par Julius Evola (Révolte contre le monde moderne, 1934) et, plus encore, par René Guénon dans deux ouvrages célèbres (La crise du monde moderne, 1927 ; Le règne de la quantité et les signes des temps, 1945), où l’opposition temporelle du monde traditionnel et du monde moderne rejoint l’opposition spatiale entre l’Orient et l’Occident. Pour Guénon, la « dégénérescence spirituelle de l’Occident » résulte d’un « éloignement des principes » accéléré par l’« action de dissolution » exercée par certains milieux.
La seconde critique, incontestablement plus terre à terre, mais peut-être aussi plus réaliste, s’opère sous un angle historique et sociologique. Ses tenants se bornent à constater que l’avènement du monde moderne va de pair avec un certain nombre de phénomènes sociaux et politiques observés de longue date : la promotion de la classe bourgeois aux dépens des classes populaires et de l’aristocratie, la montée de l’individualisme aux dépens des solidarités organiques propres aux sociétés traditionnelles, l’épanouissement des valeurs marchandes aux dépens des valeurs non négociables, la montée de l’indistinction due à la diffusion de l’idéologie du Même, la perte des repères qui en résulte, la toute-puissance de la technoscience (définie par Heidegger comme « métaphysique réalisée », surtout depuis que la pensée cartésienne a posé l’homme comme maître souverain d’une nature transformée en pur objet de sa maîtrise), l’appauvrissement spirituel qui va de pair avec l’enrichissement matériel, l’avènement enfin du système de l’argent, ce dernier n’étant pas pris seulement comme un moyen d’échange, mais comme l’équivalent universel qui permet d’estimer et de retraduire toutes les qualités dans le langage de la quantité. « L’argent est tout, domine tout dans le monde moderne », disait Péguy. La modernité a remplacé le sentiment par la sentimentalité, la morale par la « moraline », l’humanité par l’« humanitaire », la sensibilité par la sensiblerie. La modernité, c’est la logique de l’avoir contre celle de l’être. Et en même temps le « tout à l’ego ».
Cette seconde critique a été le fait d’un nombre considérable d’auteurs, appartenant à des horizons politiques plus différents qu’on ne le croit souvent. Après Georges Sorel (Les illusions du progrès, 1908), elle est présente chez Péguy – « Tout le monde est malheureux dans le monde moderne […] La misère du monde moderne, la détresse du monde moderne est une des plus profondes que l’histoire ait jamais eu à enregistrer » –, et après lui chez Bernanos. On la trouve, au tournant des années 1930, chez des auteurs ayant subi l’influence plus ou moins marquée de René Guénon (André Breton, René Daumal, Roger Caillois, Raymond Queneau, Antonin Artaud, etc.), mais aussi chez des précurseurs de l’écologisme contemporain, comme Bernard Charbonneau. C’est d’ailleurs dans l’entre-deux guerres que le sentiment d’une « crise » du monde moderne commence à se répandre : Freud écrit Malaise dans la civilisation (1931), Paul Valéry publie ses Regards sur le monde actuel (1931), tandis que Husserl s’interroge sur La crise des sciences européennes (1935). Une critique analogue se retrouve chez un contempteur du « système technicien » comme Jacques Ellul qui, dénonçant avec force le fondement idéologique du positivisme, montre que l’homme croit se servir de la technique, alors que c’est lui qui la sert, mais aussi chez Martin Heidegger, avec sa critique du Ge-stell, ou dispositif général d’arraisonnement du monde.
La critique de la modernité, ou tout au moins de certains de ses aspects, s’observe aussi chez Karl Marx, avec sa dénonciation du fétichisme de la marchandise et de la « réification » (Verdinglichung) des rapports sociaux en régime capitaliste. Il y a d’ailleurs une critique du monde moderne d’inspiration marxiste, qui naît en France en 1926 autour de la revue Philosophies, avec des hommes comme Georges Friedmann et Paul Nizan, et se développe en Allemagne avec les travaux de Theodor Adorno et Max Horkheimer sur La dialectique de la raison (1944). Dans une période plus récente, il faudrait encore citer Ivan Illich, qui s’en prend aux formes de « contre-productivité » sécrétées par la civilisation industrielle, et plus récemment les théoriciens de la décroissance qui, tel Serge Latouche, plaident contre l’hybris, la démesure et la négation des limites qui caractérisent l’hyperconsommation marchande et le productivisme contemporain.
A laquelle de ces deux critiques s’identifie le plus Alexandre Rougé ? Il me semble qu’il se situe un peu à l’intersection des deux. Il est plus proche de la première quand il parle du monde moderne comme le résultat d’une « grande profanation », quand il décrit l’homme comme un « animal avant tout religieux », quand il prône un retour ou un recours au sacré (tout en qualifiant de « pléonasme » l’expression « croyance illusoire »), enfin quand il appelle ses contemporains à redécouvrir l’importance de l’amour, injonction qui n’est d’ailleurs pas dénuée d’équivoque (s’agit-il d’éros ou d’agapè ?). Il est en revanche plus proche de la seconde quand il condamne avec brio les tares de la société marchande, décrit le libéralisme comme l’« idéologie moderne par excellence », stigmatise l’idéologie du « développement » et rappelle que le capitalisme, avant d’être un système économique, déploie tout un système anthropologique fondé sur une conception bien précise de l’homme (l’Homo œconomicus qui cherche en permanence à maximiser son meilleur intérêt matériel) et de la vie sociale (comme sphère soumise à l’expansion illimitée de l’accumulation du capital sur une planète tendanciellement transformée en un vaste marché homogène).
Alexandre Rougé annonce par ailleurs la « fin du monde moderne ». C’est même le titre de son livre. « Ce qui prend fin aujourd’hui, écrit-il, c’est la vision profane du monde et de la vie ». « La modernité, ajoute-t-il, succombe à sa propre logique, poussée à l’extrême ». Elle se « liquéfie » – ce qui n’est pas faux, puisque nous sommes entrés à tous égards dans une société « liquide » (Zygmunt Bauman), faite de flux et de reflux, de vagues éphémères et transitoires, qui ne laissent plus rien apercevoir de ferme ou de durable.
Il y a là un certain optimisme. En un sens, le plus dur est passé, puisque le monde moderne se termine ! Dans l’un de ses livres, René Guénon écrivait pour sa part que, « si tous les hommes comprenaient ce qu’est le monde moderne, celui-ci cesserait d’exister ». Formule saisissante s’il en est, mais qui laisse songeur. Comme l’a bien noté Jean Borella, « toute critique est un savoir de l’illusion. Mais le savoir de l’illusion n’équivaut pas à sa disparition ». Annoncer la fin du monde moderne n’est-il alors qu’une proclamation de principe, un effet de rhétorique ? Ou bien peut-on dire qu’objectivement, le monde moderne touche à sa fin parce que ses principes (ou son absence de principes) ont épuisé tout ce sur quoi il pouvait déboucher ? Prophète du présent, Alexandre Rougé fait-il une description objective ou se borne-t-il à exprimer sa conviction que c’est fini, tout simplement parce que ça ne peut plus durer ? Le débat reste ouvert, évidemment.
Mais il faut aussi réaliser que nous habitons nous-mêmes le monde moderne. En proclamer la fin montre que nous lui sommes étrangers, mais c’est encore en son sein que nous sommes condamnés à vivre cette « étrangèreté ». Nous ne nous reconnaissons pas dans le monde moderne, et en même temps il est notre monde, notre univers, le décor de nos existences. Autre question, enfin : la fin du monde moderne est-elle de nature à permettre un retour en arrière ? Permettrait-elle de retrouver par exemple des formes sociales et spirituelles que nous avons depuis longtemps oubliées ou perdues ? Ou bien faut-il contraire, battant en quelque sorte la modernité sur son propre terrain, miser sur l’après-modernité – la postmodernité au sens plein du terme – plutôt que sur l’avant-modernité ? Là aussi, le débat est ouvert.
C’est en tout cas ce genre de questions stimulantes que l’on est amené à formuler à la lecture de l’essai d’Alexandre Rougé. Elles sont autant de raisons de le lire. Peut-être l’auteur n’échappe-t-il pas à un certain style incantatoire, qui abonde en affirmations « définitives » et, en leurs diverses guises, cent fois répétées. Mais il faut avant tout y voir un cri du cœur. Derrière la tristesse et l’amertume, parfois la rage, on sent dans ces pages une aspiration à un plus-être, à une récupération de ce dont l’homme a été méthodiquement spolié et dépouillé.
Certains cris du cœur sont contagieux, et c’est peut-être ainsi que l’on en finira avec les tares de la modernité. N’oublions pas que même le béton le plus dur finit par se fissurer, que même la nuit la plus noire contient la promesse d’une lumière, que même la boue la plus envahissante finit un jour par sécher.
Alain de Benoist
Initialement publié en 2006, La France perd la mémoire, essai de l'historien Jean-paul Rioux, vient d'être réédité en format poche dans la collection Tempus de chez Perrin. Nous reproduisons ici la recension qu'en avait fait la (défunte ?) revue Horizons stratégiques, publiée par le Centre d'analyse stratégique du gouvernement, sous la plume de Julien Winock.

Jeune retraité de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Rioux est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire culturelle du XXe siècle. Ses travaux ont renouvelé l'approche des temps forts du siècle dernier par une analyse approfondie des répercussions sociales et culturelles des mutations politiques. Dans cet essai percutant, empreint d'inquiétude et d'interrogation, il interroge le rapport que nous entretenons avec notre passé depuis une trentaine d'années. Entre le milieu des années 1970 et les années 2000, la France a vécu les « Trente Mémorieuses » qui ont « laissé prospérer une mémoire convulsive et virale ; elles ont médiocrement suivi ces Trente Glorieuses qui de 1945 à 1975 avaient, elles, installé la croissance et le mieux être sans se soucier de discordance des temps, sans regret, hiatus, ni latences, sans coups d'œil inutiles sur le rétroviseur ». Le grand récit national a laissé place à une floraison de mémoires sur un mode d'abord bon enfant puis, pour certaines d'entre elles, revendicatif et dénonciateur. Or pour l'historien cet essor des mémoires est bien la conséquence d'une « démission de notre histoire ».
Transformée par trente années d'expansion économique et de bouleversements sociaux, la France du milieu des années 1970 s'est tournée vers son passé au moment où la modernité galopante en effaçait les traces à vive allure. Entre nostalgie, engouement pour le « rétro » et quête d'une authenticité perdue, les Français ont plébiscité nombre de témoignages, enquêtes et récits évoquant la vie de la campagne, la France des terroirs, le souvenir des métiers disparus... Certains succès tels Le Cheval d'orgueil de Pierre-Jakez Hélias, vendu à 2 millions d'exemplaires, relèvent du phénomène de société. Ce « culte des racines très sage » n'alimentait alors aucune revendication identitaire. Dans les années 1980, « la crise s'est mise à broyer et non plus seulement à exhumer les valeurs héritées que l'on tenait encore pour constitutives et patrimoniales ». La mémoire ne fut alors d'aucun secours pour affronter la fragmentation de la société, la désertification des campagnes, la désindustrialisation et l'épuisement du modèle d'intégration républicain.
Dans la foulée de l'année 1980 qui lui est consacré, le patrimoine devient un nouveau mode de fidélité au passé : à côté des monuments nationaux et des édifices publics les plus emblématiques, les innombrables constructions anciennes souvent modestes font l'objet d'un attachement et d'un souci de conservation insoupçonnés auparavant. Tout ou presque acquiert le qualificatif de patrimoine tandis que le devoir de mémoire se généralise à tout propos aussi bien dans le cas de l'ancien résistant que de la petite-fille de lavandière. Le succès du phénomène n'a donc rien de réjouissant selon J.-P. Rioux pour qui la notion de patrimoine « a implosé, minée par l'absence de hiérarchie des signes et des traces, dilapidée aux quatre coins de la conscience médiatique des choses par la monotonie de son exhibition ». Il faut y voir plus une « ambition par défaut » qu'un renouvellement des formes du sentiment national, un « témoin visible d'un passé devenu lui-même invisible » selon l'expression de Pierre Nora. La « mémoire patrimoine » apparaît plus animée par des aspirations identitaires, des considérations esthétiques ou une frilosité à l'égard d'un avenir inquiétant que par un attachement à la mémoire-Nation.
Le bicentenaire de la Révolution française a révélé selon Rioux le tiède attachement d'un peuple pour l'événement fondateur de sa modernité politique et sociale. Les Français ont apprécié les manifestations commémoratives mais plus dans « une expectative amusée que réflexive ». Les sondages révélaient que les grandes œuvres de la Révolution occupaient dans la mémoire nationale une moindre place que certains événements postérieurs (instauration du suffrage universel, loi Ferry...). En définitive la dimension festive de ce bicentenaire triomphait aux dépens de son sens politique et civique comme le démontrait le succès rencontré par le défilé du 14 juillet organisé par Jean-Paul Goude : « Ce point d'orgue fut donc cosmopolite et parisien, individualiste et grégaire, sans rapport clair et net avec la gravité et la force morale et civique qu'on pouvait encore porter au crédit des droits qu'on célébrait ».
L'histoire de France a donc cessé, selon l'auteur, d'être ce pilier de notre identité collective. L'immense « capital symbolique et tutélaire [...] s'est délité et dissous sous nos yeux, sous l'effet de nos crises, nos doutes, nos impuissances, de notre difficulté à penser un avenir commun pensé dans un destin singulier ». La mémoire est entrée en compétition avec l'histoire pour réinterpréter notre passé. « Or, sans régulation par l'histoire, des mémoires parcellaires jouent, on le voit aujourd'hui avec la question coloniale et de l'esclavage, par défaut d'élan collectif, un rôle disproportionné dans l'écriture d'une partition nationale renégociée ». Jusqu'aux années 1970, l'enseignement de l'histoire bénéficiait en France de plusieurs conditions qui en faisaient une discipline cardinale : l'importance qui lui était attribuée dans la formation de l'esprit et de la conscience nationale, les liens entre l'enseignement secondaire et la recherche universitaire et le couplage de l'histoire avec la géographie. L'histoire à l'école se heurte aujourd'hui aux « nouveautés culturelles, générationnelles, sociales, internationales qui renouvellent et disloquent le sentiment d'appartenance, le goût d'agir ensemble, l'espoir de maîtriser un jour plus librement le cours des choses ». Nous assistons selon J.-P. Rioux à une revanche du social sur le national. Les recommandations officielles entérinent cette évolution puisqu'il est désormais question à travers l'enseignement de l'histoire de « donner aux élèves une mémoire [...] aider à constituer ce patrimoine qui permet à chacun de trouver une identité ».
La place de notre histoire dans les cœurs et les consciences tenait également aux enjeux politico-idéologiques dont elle était investie. Depuis la Révolution, la « guerre des deux France » a opposé républicains et monarchistes, gauche et droite. Mais force est de constater aujourd'hui que « nous n'assistons plus à un affrontement aussi acharné ni aussi argumenté entre l'ordre et le mouvement, la gauche et la droite, les "gros" et les "petits", le Nord et le Sud, ou tout autre processus d'antagonisme binaire ». La disparition de cet antagonisme peut être vue comme le signe d'une maturité, celle d'un pays pacifié se reconnaissant enfin dans son régime politique et les grands principes régissant la société. Mais elle témoigne aussi d'un affaissement de la morale républicaine et d'une indifférence croissante pour la chose publique, y compris les grands enjeux. « Ainsi n'y eut-il ni débat ni affrontement en 1996 sur le passage à l'armée de métier et l'abandon du service national ».
Longtemps tabous ou au mieux noyées dans la globalité de la Seconde Guerre mondiale, la période de l'Occupation et la complicité du régime de Vichy dans la Shoah sont devenus l'angle quasi exclusif sous lequel la période est désormais envisagée. « La "victimisation" a rattrapé puis rélargi la nationalisation "franco-française" de l'enjeu. Les médias ont donné le meilleur écho à ce cours imprévu, les écoliers et leurs maîtres ont été invités à suivre massivement son mouvement sémantique et moral. » Ce devoir de mémoire a pris selon l'auteur « une densité sociale proportionnée aux hantises du présent autant qu'à la vivacité d'un passé qui ne "passe pas" ». Sans en contester la légitimité, l'historien nous met en garde contre son caractère obsessionnel qui en vient à rendre inopérante une recherche historique sereine fondée sur l'examen critique et raisonné des faits. À rebours d'une telle conception purement morale des faits, l'historien estime au contraire que « toute transmission utile et véridique passe d'abord par l'intelligence et la connaissance, et ensuite par la reconnaissance ».
Faisant suite au débat sur l'Occupation, la question de la colonisation a récemment resurgi avec vigueur. J.-P. Rioux rappelle pourtant l'absence de vraie mémoire nationale de la guerre d'Algérie longtemps restée un « fantôme, un tabou, une occultation avant que le pays consente à la nommer très tardivement une guerre, en 1999 [...] Le rappel de son souvenir a été tenu pour impossible et inutile parce qu'il a paru incompatible avec ce qui avait constitué la mémoire nationale. » Appelant de ses vœux le développement de la recherche historique sur l'esclavagisme et la colonisation, il estime légitime que d'aucuns se considèrent comme des victimes et invoquent un passé « fait de douleur et d'injustice » pour affirmer leur fierté collective mais « à condition, aussi bien que ce souvenir pourtant resté si horriblement singulier ne leur tienne pas lieu d'identité à jamais, ne les entretienne pas dans un perpétuel sentiment de malheur, d'exploitation et d'injustice ».
Pourquoi notre mémoire commune est-elle devenue un Clemenceau, « un porte-gloire désarmé, un encombrant à recycler, une impureté immorale et assassine ? ». Aux yeux de l'historien, nous aurions changé de temporalité au point que le présent est devenu notre seul angle de vue : « le présent fait la loi ; l'accélération et l'émiettement de la temporalité dénient l'origine et la destination ». À l'origine de cette forme de dérèglement mental, Jean-Pierre Rioux incrimine tout particulièrement les médias et leur culte de l'instant, de l'immédiateté, de la vitesse et de l'émotion. Or selon lui, « le sens de l'intérêt général, le sentiment d'une appartenance collective, du goût même de la démocratie et de l'autorité s'apprennent, s'expérimentent, vivent de ruptures et de continuités. L'instantanéité les fragilise, un présent despotique les tétanise ».
Discrédité, notre passé ne plus être une source d'expérience et de sacré. Nous perdons du coup la possibilité de partager une croyance commune en notre pays et l'attachement à une forme de transmission à nos enfants.
La multiplication des lois mémorielles aboutit à sanctuariser des « bouts d'histoire disjoints, des bribes de passé en charpie, pour apaiser des porteurs de mémoires ». À ce titre, J.-P. Rioux incrimine sans ménagement le pouvoir politique qui a « divorcé de l'autorité et de la durée pour s'ébattre dans la houle d'un présent en image et en abymes. Il n'a plus le souci premier d'une mémoire collective prête à commémorer, honorer, distinguer pour unir ; prête à mettre l'unité nationale sur pied de guerre et d'espérance ». La tyrannie du présent conduit par ailleurs à pratiquer en toute bonne conscience les anachronismes les plus grossiers : les faits du passé ne sont plus appréhendés en fonction de leur époque mais bien davantage selon nos conceptions présentes du bien et du mal.
Face à cette perte de notre mémoire collective, Jean-Pierre Rioux en appelle en définitive à un « devoir d'intelligence ». L'homme contemporain se doit de renouer avec la grande règle de vie qu'est la concordance des temps : « Faute de se situer dans le passé et de se projeter dans l'avenir, une société est inintelligible, s'enferme dans son opacité, s'immobilise puis entre en convulsion, avant d'agoniser. Il lui faut aussi s'enchanter, se gorger de promesses et d'envies pour reverdir car, disait La Tour du Pin, "tous les pays qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid" ». C'est également en réfléchissant davantage à notre époque que nous pourrons, selon lui, retrouver notre mémoire en soupesant de nouveau « l'héritage, la transmission et la promesse ».
Julien Winock (Horizons stratégiques n°1, juillet 2006)
Nous reproduisons ici ces Notes sur la dissolution du "pouvoir politique" publiées par Philippe Grasset sur son site d'analyse De Defensa.

Notes sur la dissolution du “pouvoir politique”
Face à la structure crisique
Notre époque a changé la définition de l’événement qu’est une “crise”, en allongeant indéfiniment un phénomène caractérisé initialement par sa briéveté, en l’“institutionnalisant” par la durée, en le structurant en une “structure crisique” qui caractérise la situation du monde. Face à cette situation, le pouvoir politique a perdu ses références et l’on découvre son incapacité complète d’adaptation dans son incapacité de trouver des références nouvelles. Le “pouvoir politique” s’est révélé comme une matière invertébrée et sans substance, dépendant totalement de références extérieures et mettant en lumière sa perte complète d'autonomie créatrice.
Devant la “structure crisique“, – «Insensiblement, le pouvoir s’est transformé d’une certitude de fer en une liquéfaction accélérée; d’une structure de béton armée en une coulée de sable qui glisse entre les doigts... Insensiblement mais à une confondante rapidité. L’espace de temps pour mesurer ce changement est remarquablement court, – quelques années suffiront, certainement, pour en repérer les bornes, – de la décennie des années 1990 où s’installe ce pouvoir qui semble achevé, à 2006-2008, où les entreprises les plus assurées et les positions les plus affirmées semblent se dissoudre à une vitesse dont nul ne semble se rendre compte dans les palais et les ministères….»
L’emprisonnement de l’âme
Le problème essentiel qui affecte nos élites et nos directions politiques dans cette situation nouvelle est psychologique. Ces élites sont totalement “sous influence”, incapables de la moindre pensée autonome, privées de la culture générale qui permet de cultiver l’autonomie de la pensée.
Pour autant, il ne s’agit pas de “robots” sans âme, de mécaniques. Au contraire, il y a dans les élites politiques un désarroi et une incompréhension devant la vacuité et la vanité de leurs actions, lorsque vacuité et vanité apparaissent à l’occasion d’événements de crise de plus en plus nombreux. Il en résulte une fragilité extrême de la psychologie, d’autant que le “devoir” de ces élites leur fait obligation d’applaudir le système dont l’effet de l’action est si catastrophique.«[L]a fragilité de leur psychologie se rapproche de plus en plus dangereusement du point de rupture.»
Le désordre naît de l’impuissance et de la fragilité de la psychologie
Les deux éléments additionnés, à la fois la perte de références due à la structure crisique révélant l’inexistence de la politique sans ces références, et la fragilité de la psychologie conduisent à l’impuissance complète de la réalisation du sens des événements, et à l’impuissance de toute prévision. Ces conditions créent un désordre rampant qui permet à des situations étranges de se développer, comme, par exemple, la position d’omniprésence d’un Robert Cooper dans la détermination de la politique extérieure de l’UE.
Il ne s’agit plus ni d’idéologie, ni d’engagement éventuellement extrémiste, ni de complots, ni de corruptions diverses, – sauf, justement, la corruption psychologique qui implique une sorte de pathologie. Pathologie dans le chef de ceux qui ne sont plus capables d’animer la politique, pathologie en sens inverse d’un Cooper qui anime une politique extérieure sans aucune légitimité et au nom de principes totalement dépassés et usurpés.
La psychologie malade de l’idéal de puissance
Cette situation de la psychologie est clairement née du choix de “la politique de l’idéal de puissance” (ou, dans sa version grossière US, “la politique de l’idéologie et de l’instinct”). Cette politique est liée à une seule conception, à un seul outil, qui est la force elle-même, la “force brute”.
Devant les déboires et les catastrophes rencontrées ces dernières années, la politique n’a fait que devenir à la fois et parallèlement, de plus en plus extrémiste et de plus en plus impuissante. C’est l’illustration de “la puissance devenue impuissance” et de la psychologie devenue pathologie extrémiste. Ces situations sont de véritables prisons et son inconsciemment subies comme telles, accentuant le malaise.
Le pouvoir face à son néant existentiel
Des exemples en cours montrent la façon dont le pouvoir politique se trouve complètement à la dérive. Il est faux de dire qu’il ne dispose plus de moyens et de pouvoirs. C’est lui qui a mobilisé des ressources colossales pour sauver le système financier. Quoi qu’on pense de cette opération, il reste que c’est une démonstration de pouvoir. Le résultat en est une aggravation de la crise, une aggravation de la paralysie du pouvoir, comme si la démonstration de l’existence de son pouvoir n’avait eu comme effet que d’accentuer à la fois la sensation et la situation d’impuissance du pouvoir politique.
Que ce soit BHO face au “oil spill”, Israël face à l’affaire des “flottilles de la liberté”, les pays européens dans le crise de l’euro, on se trouve devant un gâchis systématique de la fonction de responsabilité du pouvoir. On n’y voit aucune action construite mais des réactions à court terme face à des événements par ailleurs prévisibles. Le résultat est un “pouvoir politique” courant derrière l’événement et laissant les événements construire une réalité politique.
La structure crisique de la situation du monde à réduit le pouvoir politique à une situation proche de l’entropie, à un “néant existentiel”.
Le point de fusion
Comme on l'a dit, cette quasi disparition du pouvoir politique ne tient nullement à l’absence de pouvoirs ni de moyens mais plus généralement à sa position au point de confrontation des deux forces qui conduisent le système général. La crise de ce système général conduit en effet à un antagonisme de plus en plus constant, de type automatique, entre les deux forces qui le constituent : le système du technologisme, fournisseur de puissance, et le système de la communication, créateur de virtualisme pour habiller cette puissance.
Cette situation d’antagonisme a commencé en 2004-2005 et s’est institutionnalisé depuis la crise du 15 septembre 2008. Le système du technologisme accumule les échecs et les catastrophes tandis que le système de la communication, répondant à sa fonction primale s’inspirant de la philosophie médiatique du sensationnel qui devait faire la promotion des victoires du technologisme, fait la promotion de ce qui est sensationnel, c’est-à-dire de ses défaites.
Pris dans cet antagonisme, le pouvoir politique ne sait plus comment agir ni dans quel sens. Sa puissance est devenue inefficiente, et littéralement impuissante. Sa paralysie est complète.
Le cadavre bouge-t-il encore, – en attendant la suite ?
Aujourd’hui, le pouvoir politique ne peut plus espérer retrouver une quelconque efficacité que dans des situations extraordinaires où il se trouve, d’une façon spectaculaire qui serait mise en évidence par le système de communication, en opposition avec une initiative du système du technologisme.
On peut envisager l’hypothèse que, dans les événements récents, le comportement du Turc Erdogan face à Israël a été dans ce sens. C’est bien insuffisant pour annoncer le moindre tournant sérieux, mais cela signale l’existence d’une certaine diversité possible dans l’activité du pouvoir politique par rapport au système (contre le système).
Tout cela reste extrêmement parcellaire. La situation générale est bien de cette paralysie du pouvoir politique pour la cause objective des contradictions du système général en crise. C'est un processus d'autodestruction du système. Effectivement, – «La plus criante [des contradictions du système] est la destruction systématique du pouvoir politique qui, pendant deux siècles, l’a généreusement et scrupuleusement servi. Ces temps heureux où le système de l’idéal de la puissance semblait encore avoir une certaine cohésion, notamment avec des pouvoirs politiques puissants, sont définitivement finis. […] Nous ne [les] regretterons certes pas, occupés à observer ce qui pourrait [le] remplacer…»
Philippe Grasset, De Defensa, 14 juin 2010