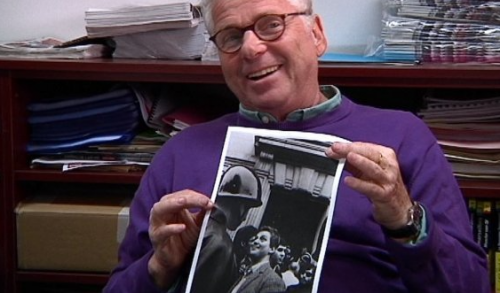Christopher Lasch, le tourisme de masse et la révolte des élites
Des touristes dans leurs propres pays … L'historien Christopher Lasch l'avait déjà souligné dans son testament politique, La Révolte des élites ou la trahison de la démocratie. Les «élites» des États-Unis (mais le constat vaut aussi pour celles des pays d'Europe occidentale, ce qui n'est pas l'objet du livre de Lasch) se réjouissent que «le monde bouge». Leur idéal est la mobilité, qu'elle soit géographique ou virtuelle. Elles choisissent les réseaux plutôt que le lieu, l'uniformisation accélérée contre les frontières et la diversité réelle. Elles se voient comme des citoyens du monde, se déchargeant ainsi des obligations civiques inhérentes à la citoyenneté. Elles dénigrent la nation, cadre de nos démocraties, en ce qu'elle entrave leur idéal d'émancipation et qu'elle les astreint à la solidarité politique et économique avec leurs concitoyens.
«L'homme de nulle part»
Christopher Lasch s'interroge: les élites se pensent-elles encore comme américaines? Elles ont plus en commun avec leurs homologues d'autres pays plutôt qu'avec leurs propres concitoyens! Les modes de vie et la vision du monde des gens ordinaires aux États-Unis leur sont rebutants voire étrangers. C'est pourquoi elles s'emploient à «créer des institutions parallèles ou alternatives» pour s'extraire du sort commun. L'Amérique des côtes méprise celle du centre, rétrograde à ses yeux car enracinée. L'Amérique des gens ordinaires, comme la France périphérique, ne souhaite pas vivre en touriste dans son propre pays. Elle ne cherche pas à se dépayser dans un univers climatisé et standardisé ; elle veut se sentir chez elle, dans la continuité de son histoire.
Le mot «touriste» remonte à Stendhal, quand l'écrivain «faisait des tours» sur les lieux de mémoire napoléonien. C'est bien autre chose aujourd'hui. Le touriste contemporain, même s'il s'agit ici d'une généralisation, n'est plus voyageur. Il est un consommateur en puissance qui traverse un monde débarrassé de ses négativités, transparent et par là exploitable. Il est vautré dans son confort, dans sa sécurité, dans son narcissisme (selfies). Il vit dans l' «Empire du même» (mêmes chaînes de restauration, même empire du globish, mêmes slogans …), bien qu'il clame sans cesse son amour de la différence. Il est en quête, permanente et pressée, de bonheur et ne veut pas s'entraver avec des dépendances.
Le touriste est l'«homme de nulle part» dont parle Hervé Juvin. Il n'a guère d'égards pour l'histoire et la géographie. L'histoire nationale n'est ainsi «valorisée» que dans le cadre des musées, c'est-à-dire «entre quatre murs», et l'on prend bien soin de l'accompagner d'une lecture binaire bourreaux/victimes. La muséification n'est pas le triomphe de l'histoire. Elle est le signe que nous pensons en finir avec le tragique de l'Histoire en le mettant en vitrine! Le passé, croit-on, est définitivement enterré. Les visiteurs de musées observent d'un œil superficiel ces hommes et civilisations étranges, guerrières, patriarcales, qui sont pourtant ceux qui nous ont rendus possibles, ceux sans lesquels nous ne serions pas. Quant à la géographie, les frontières sont un obstacle à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, et aux réseaux dans lesquels les élites se meuvent avec aisance.
La quête de l'indifférenciation
La «construction européenne», artifice langagier pour masquer l'ampleur de la déconstruction, est une bonne illustration de ces refus des contraintes temporelles et spatiales. Elle fait fi de la diversité des nations. Elle est hors-sol, comme les élites qui l'ont produite et n'ont pas hésité à passer outre le vote des peuples (le référendum de 2005) pour maintenir leur bijou d'inconsistance.
«Il ne saurait y avoir de démocratie contre les traités» a-t-on entendu au moment de la crise grecque. La «vision touristique» du monde, de ceux qui nous «gèrent» plus qu'ils ne nous gouvernent (gouvernement), ne connaît pas le peuple, ni le politique. La démocratie, pourtant, implique d'abord l'existence d'un corps politique, d'un demos, souverain. Elle est pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple!
Il est significatif que les «élites» françaises en soient réduites à opposer un argument «touristique» aux critiques de l'euro, cette «monnaie sans visage» (Juvin). Grâce à l'euro, les touristes n'ont pas à changer leur monnaie dans les pays membres de la zone. Quel progrès! Que pèsent, à côté de cette immense réussite, les divergences économiques et politiques croissantes entre les pays, la désindustrialisation, le chômage? Ce type d'argument relève du mépris de classe.
La réalité aux oubliettes
Le touriste contemporain, contrairement au voyageur, se fait détester des locaux, alors qu'il prétend «aimer», œuvrer au mélange des cultures et à leur amitié, donc à leur pacification. Il est l'homme lige de la mondialisation heureuse! Son amour est pourtant fait de bien peu d'attachements: il suffit qu'une destination ne soit plus desservie pour qu'il se précipite sur une autre. Pour lui, tout est remplaçable! Il participe à l'uniformisation du monde (les lieux de vacances, les enseignes, le globish etc.), et à la destruction des ressources (destruction de terres fertiles, émission de CO2 etc.). Il n'en appelle pas moins (car il a un minimum de conscience!) à développer un «tourisme de masse soutenable», de même que les élites parlent de «croissance verte». Deux inepties.
La prétention des élites à répandre une conception du monde occidentale, maquillée souvent en discours «humanitaire», se paie de ressentiment! Car elle se fait au mépris des traditions, des coutumes, des mœurs et de la diversité des langues. Au discours sur le «monde ouvert», fluide, plus démocratique, «sans frontière», pacifique, répondent des murs toujours plus nombreux et des séparations au sein même des territoires. Le monde uni par la globalisation est d'autant plus fragmenté (sécessions, communautarismes, islamisme).
La destruction de la diversité du monde à laquelle participent les élites est une destruction de la réalité. Comme les touristes, dont l'imaginaire est façonné par l'industrie du loisir, elles vivent dans une «hyper-réalité». Ce n'est pas pour rien que la «construction sociale de la réalité» est leur dogme, comme le souligne avec justesse Christopher Lasch. Il suffirait de la déconstruire pour pouvoir la reconstruire à partir de zéro. L'idéologie du genre et les transhumanistes y contribuent avec ténacité!
Le multiculturalisme comme bazar universel
La société à reconstruire, selon ces élites, est évidemment multiculturelle. Leur vision du monde, là aussi, est touristique. Elles ont en tête l'image du bazar coloré, tolérant, festif et abondant, qui met à disposition les cuisines et les vêtements du monde entier. Elles voient dans l'immigration un moyen de faire entrer le monde chez soi et, par-là, d'être touristes chez elles.
Elles se réjouissent de la diversité des restaurants auxquels elles peuvent accéder et de la nounou d'origine étrangère qui garde leurs enfants. Le tout sans avoir à subir, protégées qu'elles sont au-dedans de leurs frontières invisibles (digicodes, contournement de la carte scolaire, homogénéité culturelle et sociale des immeubles qu'elles habitent), les conséquences désastreuses d'une immigration de masse sur l'intégrité et la pérennité d'une communauté nationale! Elles fonctionnent comme l'Union européenne, qui juge les hommes remplaçables: la population européenne baisse? Comblons «le manque» par les immigrés!
À cette approche s'ajoute une lecture binaire de l'histoire, entre bourreaux et victimes qui méritent réparation (discrimination positive). Des groupes particuliers dont on exagère la souffrance doivent obtenir de l'État une «estime de soi» (Christopher Lasch). Big Mother se charge avec douceur et bienveillance de ceux qui sont jugés victimes, et «psychiatrise» les fauteurs de «discriminations», l'usage de ce mot traduisant la haine de la différence réelle.
La discrimination, étymologiquement, est en effet un discernement. Ne pas distinguer, ne pas voir de différence, c'est se livrer à une unique option. Remarquons cette autre chose: ces discours sur les victimes de l'Histoire et les réparations induites ont des approches communautaristes ou individuelles, pas collectives. Quid de la démocratie, loi de la majorité, avec une telle conception?
Persévérer dans l'erreur
Les élites ont l'obsession du «modèle», non pas lié à une histoire et à une géographie, mais du «modèle» venu de l'extérieur: l'Allemagne pour l'économie, la Finlande pour l'éducation, la Suède pour le féminisme. Les singularités, quand elles ne vont pas dans le sens de l'émancipation des élites, sont à domestiquer, à mettre aux normes. Le monde est convoqué pour éradiquer le singulier! Philippe Murray parlait de «mondification», c'est-à-dire d'une «homogénéisation du monde», de sa «mise aux normes touristiques planétaires par indifférenciation de toutes les manières de vivre et de penser».
Un tel programme implique l'optimisme - démesuré - de penser que la guerre ne viendra jamais troubler la «fête». En nous désignant, l'ennemi islamiste nous a rappelés à notre impuissance: à nos pertes de souveraineté, au peu d'épaisseur de nos mœurs, à la faible intensité de notre sacré. Les élites n'ont pas pour autant (ou en tout cas insuffisamment) pris conscience de ce qui nous livre à l'adversaire. Comme le touriste, elles poursuivent leur parcours balisé et confortable, dans une bulle où le tragique de l'Histoire n'a pas sa place. Le Mal ressurgit dans l'Empire du Bien sous les traits de l'islamisme, gros de nos renoncements et nos lâchetés? À cela, celles qui pourraient donner leur direction à la société n'ont rien d'autre à proposer que de lever nos verres …
Laurent Ottavi (Figaro Vox, 27 juillet 2018)