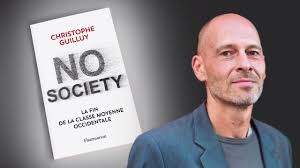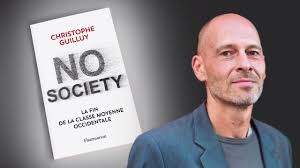
« No Society » : le constat implacable de Christophe Guilluy
L’édition en format poche de No Society – La fin de la classe moyenne occidentale, enrichie d’un avant-propos consacré au phénomène des Gilets jaunes, est l’une des lectures les plus indispensables du moment. Le géographe Christophe Guilluy y propose une forme de synthèse de ses analyses, bien moins manichéennes que ne le voudraient ses détracteurs. Cet ouvrage constitue sans conteste l’un des livres de chevet de tout responsable « populiste » ayant à cœur d’offrir une perspective politique victorieuse au « Bloc populaire ».
Partant de la fameuse formule de Margaret Thatcher en octobre 1987, « There is no society », qui entendait ainsi justifier le bien fondé de ses réformes libérales, Christophe Guilluy déroule une analyse que l’on pourrait résumer en quelques points saillants :
- Ce message libéral donc par essence apolitique, porté par une vision mondialiste devenue idéologie, dont la portée s’est accélérée après la chute du Mur de Berlin et la disparition du bloc soviétique, a été entendu par l’ensemble des classes dominantes occidentales.
- Sa conséquence immédiate ? La « grande sécession du monde d’en haut »d’avec ses peuples et ses pays originels, qu’avait analysé dès 1995 Christopher Lasch dans La Révolte des élites et la trahison de la démocratie(Champs Flammarion, 2010) et que rappelle très bien le président de TV Libertés Philippe Milliau dans son message du nouvel an 2020.
- Les conséquences concrètes que nous subissons aujourd’hui, après trente ans de nouvelle « trahison des élites », sont l’abandon du bien commun et l’avènement du chaos de la « société relative » caractéristiques des pays occidentaux – « la réalité d’une société désormais travaillée par des tensions ethno-raciales qui rappellent en tout point celles de la société américaine ».
- « La rupture du lien, y compris conflictuel, entre le haut et le bas, nous a fait basculer dans l’a-société. No more society.» Le sacrifice volontaire, sur l’autel de la mondialisation, des classes moyennes autrefois matrices des sociétés occidentales, a débouché sur la prolétarisation, l’atomisation et finalement la désespérance du « bloc central » constitué du peuple au travail – l’échec du mouvement des Gilets jaunes ne pouvant qu’accentuer cette désespérance sociale, avec des risques évidents pour le maintien de toute « paix civile ».
Dès lors, comment « refaire société » – c’est-à-dire en réalité refaire un peuple, avec un territoire, des coutumes et des lois qu’il aurait en propre ? C’est à cette réhabilitation du politique qu’appelle Guilluy, avec la pertinence qu’impose la tournure des événements, légitimant en grande partie ses analyses antérieures (notamment dans La France périphérique en 2014 et Le crépuscule de la France d'en haut en 2016), malgré les limites de quelques-unes de ses références par trop crypto-chevènementistes.
Phénoménologie de la « société ouverte »
La partie principale de l’ouvrage de Christophe Guilluy est relative au constat de la société produite par l’avènement de l’idéologie multiculturaliste et « diversitaire » (cf. Mathieu-Bock Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, Les éditions du Cerf, 2016). Idéologiquement progressiste, multiculturelle et techno-marchande, la « France d’en haut » a promu cette forme de post-démocratie (car réalisée sans le consentement du peuple souverain, et en lui retirant l’essentiel de ses prérogatives politiques, avant de le faire disparaître économiquement puis socialement), avec d’autant plus d’entrain qu’elle a su se préserver des externalités négatives d’un tel « modèle » (ghettos ethniques, effondrement du système éducatif, chômage structurel et massif, explosion de la criminalité de rue, etc.). Et ce, en utilisant cyniquement le lumpenprolétariat immigré à son profit :
- pour répondre à ses besoins de services dans les métropoles constituant ses lieux de vie privilégiés (ménage, cuisine, garde d’enfants, transports, traitement et recyclage des déchets, etc.) ;
- mais aussi pour contenir voire délégitimer les revendications salariales ou simplement sociales de l’ancienne « working class » autochtone, accusée au moindre prétexte de racisme, pour ne pas dire de bêtise crasse (les « déplorables » dénoncés par Hillary Clinton en visant les électeurs de son opposant républicain en 2016) – technique permettant « le verrouillage du débat public » afin d’écraser dans l’œuf toute velléité de révolte.
Ce que décrit Guilluy, c’est « le repli d’une bourgeoisie asociale » : « En réalité, la société ouverte et mondialisée est bien celle du repli du monde d’en haut sur ses bastions, ses emplois, ses richesses. Abritée dans ses citadelles, la bourgeoisie ‘progressiste’ du XXIe siècle a mis le peuple à distance et n’entend plus prendre en charge ses besoins. L’objectif est désormais de jouir des bienfaits de la mondialisation sans contraintes nationales, sociales, fiscales, culturelles…. Et peut-être, demain, biologiques » [en pariant sur la révolution de l’intelligence artificielle et le transhumanisme].
Une nouvelle lutte des classes ?
A l’impasse que constitue cette « a-société » par nature centrifuge, quand elle n’est pas sécessionniste, répond le besoin de « commun » d’un peuple certes relégué aux marges géographiques, culturelles et économiques de la société, mais toujours majoritaire : la « France périphérique » représenterait 60 % de la population, constituant « un socle populaire irrépressible ». Mieux, toujours selon Christophe Guilluy, cette population majoritaire se penserait encore, malgré sa prolétarisation accélérée, comme « référent culturel » d’une France qui ne voudrait pas mourir, car disposant d’un socle de valeurs cohérent et fédérateur :
- La nécessité de préserver le cadre national « qui conditionne la défense du bien commun » et qui comprend celle des services publics ;
- L’attachement à « la réalité d’un monde populaire sédentaire beaucoup plus durable » que le « mythe de l’hyper-mobilité » ;
- « La préservation d’un capital culturel protecteur [face] à la construction d’un monde de l’indistinction culturelle » ;
- Et finalement, mais de façon très concrète et palpable, le refus instinctif de l’invasion migratoire, qui déstabilise la société populaire et en modifie les contours ethniques comme les attaches culturelles.
Même s’il s’en défend, Guilluy voit ainsi se dessiner une nouvelle lutte des classes entre les « gagnants » et les « perdants » de la mondialisation, les premiers constituant « une bourgeoisie dont le seul objectif est de maintenir sa position de classe » et les seconds regroupant ceux « qui adhèrent de moins en moins à la doxa de la société ouverte » – mais qui bénéficieraient aujourd’hui d’un mouvement de balancier favorable.
L’analyse est d’autant plus convaincante qu’elle rejoint les dichotomies mises à jour aussi bien par David Goodhart entre « Anywhere » et « Somewhere » (The Road to Somewhere : The Populiste Revolt and the Future of Politics, 2018), par Michel Geoffroy entre « super-classe mondiale » et « peuples » (La super-classe mondiale contre les peuples, Via Romana 2018), par Jérôme Sainte-Marie entre « bloc élitaire » et « bloc populaire » (Bloc contre bloc : La dynamique du Macronisme, Les éditions du Cerf 2019), ou encore très récemment par Michel Onfray entre « ceux qui exercent le pouvoir » et « ceux sur lesquels s’exerce le pouvoir » (La Grandeur du petit peuple, Albin Michel 2020).
Eviter le spectre de la « guerre civile »
Pour Guilluy, « les classes dominantes ont créé les conditions de leur impuissance à réguler, à protéger (…) par une dépendance accrue au système bancaire et aux normes supranationales du modèle mondialisé ». Mais ce faisant, elles se sont engagées dans une « fuite en avant économique » qui les condamne à terme. « La réalité est qu’aujourd’hui la classe dominante cherche moins à préserver la société qu’à gagner du temps (y compris en refusant ou en freinant l’application des résultats des urnes – du référendum européen de 2005 aux élections italiennes de 2018 en passant par le Brexit). » Or le vent tourne : « Croire que le mouvement des Gilets jaunes ou celui des brexiters n’est qu’un phénomène conjoncturel est une absurdité. C’est au contraire le produit d’une recomposition sociale de temps long, qui fait émerger une nouvelle polarisation politique », qui dépasse évidemment le vieux clivage institutionnel droite-gauche. Et ce, au moment même où « la posture morale du monde d’en haut a vécu » : « Le monde politique, académique ou médiatique ânonne les versets de la doxa dominante mais n’a plus qu’une influence culturelle marginale sur le monde d’en bas. »
En annonçant « la fin du magistère des prétentieux », qui contraindra ces derniers à rejoindre le monde réel ou à disparaître, Christophe Guilluy se montre à la fois optimiste et volontariste. Pour conjurer l’accentuation des fractures sociales, voire un risque de « guerre civile » largement mis en scène et instrumentalisé par le pouvoir, il mise en effet sur la réconciliation de la France d’en haut avec le « môle populaire », en prenant acte de la concomitance de deux « victoires »:
- Victoire technique, liée à l’essoufflement du modèle économique et sociétal actuel : « L’heure est au développement durable, à la relocalisation des activités, à la baisse de la mobilité, ni par idéologie ni par passéisme, mais simplement parce que les contraintes économiques, écologiques et sociales nous l’imposent » ;
- Victoire idéologique : confrontés de surcroît à la perte de leur hégémonie politique et culturelle, les « Anywhere » doivent « reprendre le chemin de l’Histoire », celui d’une réintégration démocratique par réconciliation avec les « Somewhere » – « Aidons-les à réintégrer la communauté nationale ! » plaide ainsi Guilluy.
Tout « populisme » a besoin d’une élite
Pour atteindre cet objectif, Guilluy ne mise pas seulement sur la bonne volonté du « bloc élitaire ». Il a bien conscience qu’il faut que le « bloc populaire » dispose de sa propre élite, apte à engager un rapport de force qui lui serait favorable : « Aucun processus [révolutionnaire] ne peut émerger sans l’engagement d’une fraction des élites ou de la bourgeoisie en faveur des plus modestes, et donc une volonté de préserver le bien commun ». Dit autrement : « Pas de mouvement de masse, pas de révolution sans alliance de classes ! »
Cette élite doit notamment garantir la réintégration du « bloc populaire » dans les circuits économiques : « On ne peut prétendre au respect et encore moins à un statut de référent culturel ni à aucun pouvoir politique sans intégration économique ». Ce que les auteurs de la postface au « manuel de guérilla culturelle » publié récemment à La Nouvelle Librairie par François Bousquet (Courage !, 2019), affirment également sans ambiguïté : « L’économie, la bonne économie qui réalise et qui crée, est au fondement, aussi, au même titre que la génétique et la culture, de notre identité européenne. […] Rêvons à un réinvestissement de l’économie par nos forces vives. […] Nous devons lever des armées de chefs d’entreprise soudés et enracinés. »
Le récent Dictionnaire des populismes (éditions du Cerf, 2019) réalisé sous la direction de Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin, ne fait pas l’impasse sur ce sujet. Dans un article consacré à l’élitisme, Alexandre Avril s’oppose à l’opposition entre celui-ci et le populisme : « Cette vision simpliste et antagoniste des choses n’est pas celle de la théorie politique classique, qui voit plutôt dans la dualité organique du peuple et de l’élite une division fonctionnelle et non pas concurrentielle ». Et de préciser que « le populisme peut être entendu non comme une simple critique anti-élitiste mais au contraire, comme l’aspiration à restaurer les principes et la fonction classiques de l’élite : celle de former le petit nombre des plus vertueux, qui sont aussi les plus aptes à gouverner et à conduire le peuple dont ils sont indissociables ».
« Même le populisme a besoin d’un élite », rappelle aussi Pascal Gauchon dans le dernier numéro de la revue Conflits (n°25, janvier-février 2020, « Les yoyos du populisme », p. 70-71) : « Le vrai problème des populistes est leur rapport aux élites. En se contentant de les dénoncer, ils mobilisent, mais se privent de leurs réseaux et de leur savoir-faire ». Car si la preuve a été faite que les populistes peuvent accéder au pouvoir, au moins dans le cadre de coalitions s’agissant du continent européen, « peuvent-ils y rester et agir ? »
C’est sans doute l’enjeu principal des mois et années à venir. Et ce n’est pas le moindre des intérêts de No Society que de ne pas faire l’impasse sur un sujet aussi essentiel. Car de la capacité du « bloc populaire » à se doter d’une élite, politique, intellectuelle et économique, dépend directement ses perspectives de pouvoir.
Grégoire Gambier (Polémia, 14 janvier 2020)