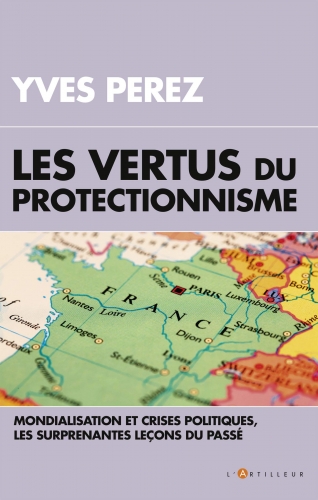«La désinstruction nationale: une non-assistance à une jeunesse en danger»
FIGAROVOX.- Qu’est-ce que la désinstruction nationale que vous dénoncez dans votre ouvrage?
René CHICHE.- Il fut un temps, pas très lointain d’ailleurs, où l’on quittait l’école en sachant convenablement lire et écrire, c’est-à-dire où l’école instruisait. On entre aujourd’hui à l’université en sachant à peine lire et en ne sachant pas du tout écrire. C’est un fait. Et cela est proprement stupéfiant. Comment peut-on tolérer que des générations entières passent une quinzaine d’années sur les bancs de l’école et parviennent jusqu’aux portes du supérieur en maniant leur propre langue comme s’il s’agissait d’une langue étrangère? Ce n’est d’ailleurs même pas assez dire pour qualifier le charabia dans lequel sont écrites la plupart des copies que je lis. Il y a toujours eu un petit nombre de très mauvaises copies comme de très bonnes mais désormais les copies indigentes à tout point de vue constituent la grande majorité des copies, au point qu’on juge bonnes des copies qui étaient hier seulement médiocres.
Pour qu’on comprenne bien que je ne suis pas en train de hurler à la catastrophe à cause de quelques fautes d’orthographe ou de quelques perles qu’il est si facile d’exhiber mais dont on ne peut en réalité tirer aucune conclusion, j’ai pris la peine de donner un échantillon représentatif de ces copies dans le premier chapitre, lui-même intitulé «bac à l’oréat» parce que c’est ainsi que je l’ai vu écrit une fois sur l’en-tête d’une copie d’examen. J’aurais pu en remplir dix volumes. Ceux qui liront cet échantillon comprendront alors immédiatement ce qu’est la «désinstruction»: lorsque l’institution censée prendre soin de l’esprit des jeunes gens les laisse dans un tel état de quasi-illettrisme tout en leur promettant «la réussite» matin, midi et soir, je crois que ce néologisme n’est même pas assez fort pour décrire ce qui est de la non-assistance à jeunesse en danger, affamée de lettres et de culture que l’école renonce à transmettre parce qu’un grand nombre des acteurs considère que ce sont des vieilleries inutiles. L’école n’instruit plus et laisse l’esprit en jachère.
Le problème, ou plutôt le scandale, est qu’on a interdit de dévoiler la réalité aussi bien que l’ampleur de cette désinstruction. Tous ceux qui osent soulever un coin du voile se font immédiatement rappeler à l’ordre par quelque colonel de pensée veillant à l’orthodoxie en la matière. «Les jeunes de maintenant savent d’autres choses», dit-on. Ils ont «d’autres compétences». Ah bon? Parce que la dextérité dans la manipulation du clavier virtuel serait une «compétence»? L’aptitude à baragouiner la langue de Shakespeare compenserait l’incapacité à manier passablement celle de Molière? Bien sûr que non! Ce sont des fadaises, et j’ai écrit ce petit livre pour qu’on cesse une bonne fois de nous les servir et qu’on ait enfin le courage de regarder la réalité en face. La langue est l’instrument de toute connaissance, y compris et surtout l’instrument de la connaissance de soi. On ne peut rien savoir vraiment quand le moyen de la compréhension n’est pas maîtrisé. À défaut de savoir, on apprend par cœur des cours auxquels on ne comprend strictement rien, comme je le relate par des anecdotes dont j’aurais pu là encore remplir plusieurs volumes. Or, entre croire et savoir, il faut choisir.
Quand penser devient de plus en plus difficile pour les élèves (par manque de mots, de concepts), quelles sont les conséquences à venir pour ces futurs citoyens?
Penser n’est pas difficile pour les élèves, penser est interdit. Vous savez, penser est difficile et le demeure, même pour des penseurs professionnels! Car «penser, c’est dire non!»: non à la première idée qui se présente, non à la facilité, non à l’habitude et ainsi de suite. Il ne s’agit donc pas que penser devienne facile. Il est si facile de se contenter d’à-peu-près. Or savoir à peu près lire, c’est en réalité ne pas savoir lire. Et ainsi du reste: penser approximativement, c’est adhérer à un discours et réagir à des mots comme un taureau devant le chiffon rouge.
C’est croire, et non penser. On n’apprend à penser qu’en grande compagnie. Alors oui, on doit s’inquiéter des conséquences politiques de la désinstruction, parce qu’en République, l’école est d’abord instituée non pour procurer un métier ou je ne sais quel savoir-faire mais pour qu’il y ait des citoyens dignes de ce nom, capables de juger et de critiquer. Oui, il faut s’inquiéter de ce que deviendront des élèves qui n’ont presque rien lu, qui ne connaissent Montesquieu ou Montaigne que de nom, à qui l’on apprend, en croyant bien faire, à décrypter les «fake news» pendant des heures où l’on renonce à leur apprendre les subtilités de leur propre langue. Il faut s’inquiéter du devenir de ceux que l’on a privés d’heures de français au cours desquelles ils auraient acquis la maîtrise de la langue en puisant à la source et que l’on préfère faire débattre de tout et de rien sous couvert d’un prétendu «enseignement moral et civique» qui est une forme de dressage, quand on ne va pas jusqu’à faire commenter des «tweets» en classe!
Mais la formation du citoyen n’est pas seulement intellectuelle, elle est aussi morale, et de ce point de vue encore, l’école renonce. Presque personne n’ose déplaire. Il faut non seulement aimer mais faire aimer la difficulté si l’on veut penser et se tenir debout, puisque c’est la difficulté surmontée qui fait progresser. Mais on fait tout le contraire: on cherche à intéresser au lieu d’instruire et l’on traite l’élève en consommateur, allant jusqu’à dévoyer la pédagogie pour la mettre au service de la paresse et de la désinstruction. Songez par exemple que le Code de l’éducation lui-même a banni le mot «instruction» de la loi et que la noble tâche de l’école n’est plus d’instruire, comme le voulait Condorcet, mais de garantir (oui, garantir!) la «réussite»! La belle affaire! On réclamera bientôt la réussite par pétition!
D’ailleurs on le fait déjà. On oublie toutefois que la réussite présuppose le travail, l’effort et même l’échec, duquel on apprend à se relever par persévérance, et c’est cela qui est formateur. Les professeurs sont aux premières loges de ce triste spectacle et ne cessent de dénoncer et déplorer ce fonctionnement absurde auquel tous cependant consentent ou se résignent. Un élève qui a des difficultés passera tout de même dans la classe supérieure, où ses difficultés grossiront et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elles deviennent des lacunes qui paraîtront insurmontables. On ne lui fera pas trop remontrance, de peur de le traumatiser. Il parviendra jusqu’en Terminale en ne sachant pas écrire. Il se trouve enfin des gens, même parmi les professeurs, ceux que j’appelle les militants de la désinstruction, pour justifier ce passage automatique d’un niveau à l’autre. Ils ont d’ailleurs supprimé la notion même de niveau et l’ont fait remplacer par celle de «cycle» en prétextant qu’il fallait respecter les «rythmes» d’apprentissage: voilà, entre autres choses, comment des élèves arrivent jusqu’au baccalauréat non seulement en ne sachant pas s’exprimer avec clarté mais en n’ayant parfois jamais travaillé.
Face aux «pédagogistes», existe-t-il encore des enseignants fidèles à un enseignement classique, historiquement républicain?
On ne devrait pas qualifier de «pédagogistes» ceux qui s’emploient à détourner la pédagogie de sa vocation, qui n’est pas de s’adapter mais bien d’élever. Il y a en effet une poignée de militants de la désinstruction, y compris dans le corps enseignant, mais ce qui est en cause, c’est le fonctionnement de l’institution plutôt que le rôle et la responsabilité de tel ou tel. Les «pédagogistes» sont avant tout des carriéristes. Quand on aime son métier, on le fait et on ne passe pas son temps à en parler. L’artiste puissant, dit Alain, ne parle guère.
Dans un chapitre intitulé «Les boutons de manchettes», j’explique et décris assez crûment la façon dont le professeur que vous qualifiez de «classique», c’est-à-dire «à l’ancienne» (manière de parler à la fois révélatrice et dramatique), est aujourd’hui menacé par ceux qui étaient auparavant chargés de le protéger, chefs d’établissement aussi bien qu’inspecteurs. Il faut aller sur le terrain pour observer comment les choses se passent. Les chefs d’établissement sont poussés à se prendre pour des «managers» et, pour se faire bien voir de leur propre hiérarchie, ont tendance à inciter les professeurs à faire de même. On voit ainsi proliférer une nouvelle espèce d’enseignants prompts à faire des «projets», à faire parler d’eux, à faire les intéressants. La plupart du temps, ces «projets» sont affligeants. Mais, voyez-vous, un professeur qui fait simplement son travail, qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à faire parler de lui dans le journal de la commune, est considéré par sa hiérarchie comme un mauvais professeur, voire un encombrant que l’on attend de pouvoir remplacer par un enseignant (j’emploie ce mot à dessein pour le distinguer de celui de professeur) docile, recruté par contrat, taillable et corvéable à merci.
On parle désormais de «l’équipe» pédagogique comme de «la communauté éducative»! Il y a cependant toujours des professeurs, de vrais hussards noirs, et en réalité ils le sont encore presque tous, et cela en vertu de leur mode de recrutement. Car un professeur est avant tout un intellectuel. C’est sans doute la raison profonde pour laquelle, si on veut en finir avec les hussards et les remplacer par des animateurs ou de simples assistants dans le face-à-face entre l’élève et l’écran auquel certains voudraient que ressemble dorénavant l’enseignement, on cherchera d’abord à réformer le mode de recrutement et le concours, qui fait encore la part belle à la maîtrise d’un champ disciplinaire. L’autorité morale du professeur a pour fondement son autorité intellectuelle. Et depuis toujours ceux qui font profession de penser ont pour ennemis jurés, à leur corps défendant, tous ceux qui mettent l’administration des choses au-dessus du gouvernement des hommes et du soin que l’on doit à l’esprit.
René Chiche, propos recueillis par Marguerite Richelme (Figaro Vox, 10 janvier 2020)