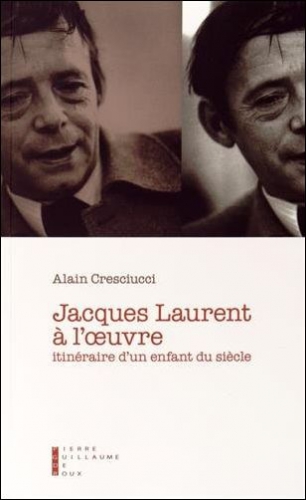La mélancolie comme figure de la condition néolibérale
La condition néolibérale dont nous sommes les habitants contraints présente un caractère structurellement mélancolique. Selon la leçon de Freud, la mélancolie se configure comme souffrance pour un objet perdu dont, en fin de compte, l’on ressent incessamment la présence oppressante sous la forme de la conscience de son absence. Il s’agit, toujours en termes freudiens, du renversement du deuil : se sentant comme trop proche de l’objet perdu, le mélancolique ne peut procéder à la symbolisation de la perte. Pour le dire avec les mots de Freud, l’ombre de l’objet ne cesse de tomber sur le moi.
La perte qui rend mélancolique l’actuelle condition néolibérale est double et concerne l’avenir comme dimension projectible et la politique entendue comme lieu du conflit, et comme espace social de la discussion rationnelle de futurs alternatifs devant être concertés unanimement. Comme l’a récemment démontré Giovanni Leghissa dans son essai Néolibéralisme, Une introduction critique, le néolibéralisme se présente comme la condition dans laquelle la politique n’est plus rien. Celle-ci, variant de la formule de von Clausewitz, est avilie dans une pure continuation de l’économie avec d’autres moyens, servant le marché et les multinationales. La dépolitisation de l’économie est l’autre visage de l’économisation de la politique : la gestion techno-administrative glaciale du social et la gouvernementalisation biopolitique de la vie nue, détrônent la décision politique de la communauté souveraine. La ratio œconomica de la théologie mercantile n’accepte d’autres raisons, y compris celle du politique. C’est pour cela qu’il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de décliner la critique marxiste de l’économie politique sous la forme inédite d’une critique de l’économie dépolitisée. Le rêve de Lénine « tout le pouvoir aux soviets ! » s’est renversé pour devenir le cauchemar néolibéral « tout le pouvoir aux économistes ! ».
La raison pour laquelle le capital post-1989 procède à la dépolitisation intégrale du monde est même trop évidente. Comme j’ai essayé de le démontrer de façon étendue dans mon étude Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo (2012), nous sommes dorénavant dans une phase du capitalisme qui peut de droit se qualifier de « capitalisme absolu », c’est-à-dire l’époque du fanatisme de l’économie et du monothéisme du marché. Le capital est aujourd’hui absolu parce qu’il est « délié de » (ab-solutus) chaque limite résiduelle, de tout frein pouvant limiter son développement. Dans l’actuelle conjoncture, le capital s’est affranchi de toute valeur (morale, religieuse, etc..) qui puisse le freiner ou même seulement en ralentir le développement, et c’est en ce sens qu’il faut expliquer le démantèlement de la culture bourgeoise, composée de valeurs non apparentées à la reproduction mercantile, que le capital a réalisé à partir de 68. Soixante-huit n’est pas un moment où l’on s’émancipe du capital, c’est le capital qui s’émancipe, libéré de cette vieille culture bourgeoise (étique, religion, Etat, Buildung etc.) : la lutte soixante-huitarde contre la culture bourgeoise a ouvert la route à l’actuel capitalisme post bourgeois. Ce dernier est lui-même soixante-huitard et contestateur, permissif et anti-disciplinaire, ne reconnaissant aucune autorité pouvant freiner la souveraineté absolue de la forme marchande. Le contrôle total de la société, à partir de 68, advient à travers la libéralisation toujours croissante de la sphère privée confiée au self-service généralisé du consumérisme de la part d’individus isolés à la recherche de l’enrichissement esthético-hédoniste du propre moi individuel : tout est possible, à condition qu’il y en ait toujours plus et que l’on possède une valeur d’échange correspondante pour se le permettre.
Si 68 a liquidé la culture bourgeoise, la phase qui s’ouvrit avec 1989 a en revanche inauguré une phase de programmatique « dépolitisation » (Schmitt) cohérente avec l’absolutisation même du nomos de l’économie. L’économie se maintient, par sa nature, sur un espace sans confins, en produisant une globocratie anonyme et impersonnelle, déterritorialisée et sans culture, sans Etats et sans une résiduelle force pour la freiner. Détacher l’économie de la politique – le rêve réalisé du néolibéralisme aujourd’hui triomphant – signifie épargner la première des interventions régulatrices de la seconde, neutralisant cette dernière et favorisant le plein déploiement de l’actuelle situation mondiale, dans laquelle il n’y a de souverain que le marché. En cohérence avec sa logique de développement absolutus, le capital correspondant à lui-même doit neutraliser chaque pouvoir politique capable de le freiner, de façon à ce que le glacial rapport de force économique s’impose sans limites dans la forme d’un ordre dépolitisé : la deregulation[1] et « l’Etat minime » représentent le visage de ce programme de dépolitisation dont le but est la suppression de tout élément pouvant discipliner l’économie autonomisée.
En 1800, dans son travail L’Etat commercial fermé, Fichte avait condensé l’essence du nomos de l’économie dans la formule Handelsanarchie, « anarchie commerciale » : la théologie secrète consubstantielle au rythme de la mondialisation coïncide avec la désarticulation de l’ordo politicus, remplacé par la désorganisation organisée du marché international et de sa structure enracinée et réfutant toute norme, amorphe et non gérable par la politique des traditionnels Etats nationaux. Le pouvoir apolitique de l’économie peut ainsi naviguer sans être dérangé dans l’espace mondialisé, en dehors du rayon de l’action de la politique. L’anarchie commerciale dénoncée par Fichte correspond à l’actuelle deregulation[2] propre au laissez faire[3] global du code néolibéral : le capitalisme régulé ne peut exister, puisque son essence même est la dérégulation, l’entropie efficace qui emporte toute norme qui aspire à freiner et limiter la dynamique de la croissance infinie.
Ainsi, le dépassement de la traditionnelle forme étatique constitue un passage obligatoire pour la dépolitisation, pour l’anéantissement de la force d’une politique encore capable d’agir sur l’économique. Rendre inefficientes les unités étatiques à travers l’instauration d’un ordre apolitique est la condition pour imposer les deux principes convergents de l’anarchie commerciale et de la dépolitisation intégrale de la sphère économique. Si aujourd’hui toute tentative d’une politique qui ne serait au service du nomos de l’économie est inefficiente, ou même d’une politique qui rechercherait son contrôle (l’on pense déjà simplement au projet de la « Taxe Tobin » sur les transactions financières), cela dépend essentiellement du fait que le politique, à la différence de l’économique, ne peut être opérant que dans l’espace circonscrit de la décision souveraine de la communauté avec primauté du politique. C’est pour cette raison que l’idée d’une politique internationale est aujourd’hui, ipso facto, impossible et, en plus, révèle le vrai visage idéologique de la légitimation de la soumission du politique à l’économie.
L’idéologie de la mondialisation représente le plus emblématique accomplissement idéologique du capitalisme absolu. Elle présente en positif, toujours en omettant d’exhiber l’enchevêtrement de contradictions qui l’accompagne, l’idéal devenu maintenant réalité d’un capitalisme sans confins ni limites. La mondialisation est la forme flexible et post moderne de l’impérialisme : l’exact contraire, donc, du tranquillisant universalisme paisible des droits de l’Homme avec lequel est présentée cette mondialisation, par la pensée unique politiquement correcte. Au lieu de la rassurante formule « Mondialisation », « globalisation », il serait alors opportun d’employer le néologisme « mondialitarisme » démontrant comment la mondialisation capitaliste coïncide avec ce totalitarisme réalisé à échelle planétaire qui, sans frontières le séparant d’autres réalités, ne laisse rien en dehors de lui.
Le nouvel impérialisme de l’ère mondialisée vise aujourd’hui à inclure, avec une hospitalité seulement apparente, tous les peuples et les nations dans l’unique model internationalisé du système néolibéral, dans un asséchement à peu de choses près intégral de la souveraineté nationale et de l’hégémonie du politique sur l’économique. Un fait est révélateur : la politique, entendue comme continuation de l’économie par d’autres moyens, est étiquetée de plus en plus rigoureusement en langue anglaise, comme governance[4], autrement dit avec une expression qui dit ouvertement la réduction de l’espace politique en pure gestion économique analogue au gouvernement d’entreprise des multinationales capitalistes, ou mieux, de l’actuelle unique immense entreprise capitaliste coïncidant avec l’espace du globe. C’est justement le temps de la politique absente.
Diego Fusaro (Cercle Aristote, 29 octobre 2014)
Notes :
[1] En anglais dans le texte
[2] Idem
[3] En français dans le texte
[4] En anglais dans le texte