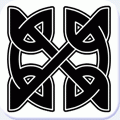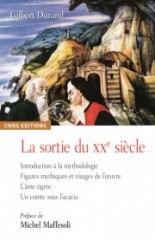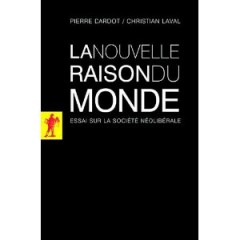Nous reproduisons ici la seconde partie de l'entretien donné, pour la revue Eléments ( n°136, juillet-septembre 2010), à François Bousquet par deux des principaux animateurs de la Nouvelle Droite, Alain de Benoist et Michel Marmin.
Bonne lecture !

La Nouvelle Droite est-elle de gauche ? (suite)
François Bousquet : Que reste-t-il du projet initial de la Nouvelle Droite, qui visait à la prise du pouvoir culturel, au sens gramscien du terme ? Comment jugez-vous rétrospectivement cette volonté de peser sur le monde, en tout cas dans sa dimension culturelle? Le «Manifeste de la Nouvelle Droite de l’an 2000» est-il toujours d’actualité ?
Alain de Benoist : La ND n’a jamais cessé de livrer une «guerre culturelle». La prise du pouvoir culturel est évidemment une perspective autrement ambitieuse qui, il faut bien le dire, reste dans l’immédiat de l’ordre du pieux souhait. La référence à Gramsci, qui date des années 1970, a elle-même souvent été mal comprise : il ne s’agissait pas d’établir, au sens strict, un parallèle entre l’activité d’Antonio Gramsci et celle de la ND – parallèle qui trouve immédiatement ses limites –,mais de faire comprendre, à ceux qui avaient encore du mal à l’admettre, l’utilité concrète d’un travail de la pensée distinct de l’action politique. À la même époque, la ND a exploré la possibilité de donner à «la droite» des idées qui de toute évidence lui manquaient. Cette tentative a culminé dans l’aventure du Figaro-Magazine, de 1978 à 1982,mais n’a pas abouti, par manque de moyens d’abord,mais surtout pour des raisons qui me paraissent aujourd’hui évidentes : cette droite n’avait tout simplement ni le désir ni les capacités de se doter d’un véritable outillage théorique, surtout quand celui-ci contredisait ses préoccupations électorales et ses intérêts de classe. Depuis, les circonstances sociales-historiques ont totalement changé. Les anciennes familles de pensée se sont plus ou moins dissoutes, et sont en train de se recomposer. Toute la difficulté, dans la période à la fois de déclin et d’inter-règne où nous sommes, est de discerner les lignes de force du paysage idéologique à venir. Une autre difficulté est d’identifier le sujet historique et les agents sociaux concrets susceptibles de mettre en œuvre des pratiques susceptibles de dépasser l’idéologie dominante actuelle. Les conditions culturelles préalablement nécessaires à la résolution de ces difficultés ne sont pas encore mûres actuellement. C’est la raison pour laquelle ce qui importe le plus, dans les conditions présentes, est de poursuivre le travail d’analyse et de proposition auquel nous nous livrons depuis maintenant plus de quarante ans, en restant plus que jamais attentifs aux changements. Dans cette perspective, les bases de réflexion et les orientations du «Manifeste de l’an 2000» – l’une des meilleures synthèses que nous ayons publiées – sont plus actuelles que jamais.
François Bousquet : N’y a-t-il pas un problème de compatibilité à droite avec la figure de l’intellectuel qui est au cœur du projet de la ND? Autrement dit, la greffe, non pas tant de l’intelligence que de l’intellectuel, serait-elle vouée à ne pas prendre sur un corps de droite ? Et plus largement, la droite serait-elle définitivement fâchée avec l’intelligence ?
Alain de Benoist : La droite est fâchée avec les intellectuels depuis l’affaire Dreyfus. Je me souviens que, dans ma jeunesse, quand on parlait des «intellectuels de gauche», il y avait toujours quelqu’un pour dire que c’était un pléonasme ! Maurras ne s’est jamais considéré comme un intellectuel, mais il dissertait en revanche volontiers sur l’«avenir de l’intelligence». D’autres gens de droite proclament que l’intelligence a beaucoup moins d’importance que le caractère, ce qui n’est d’ailleurs pas faux (ils oublient seulement que les deux ne sont pas incompatibles). Il est certain, enfin, que l’on a assisté depuis un demi-siècle à une destitution progressive de l’intellectuel, qui était naguère regardé comme «conscience morale» et «porte-parole des sans-voix» à l’époque où l’Université avait encore du prestige,mais qui aujourd’hui n’est plus, au mieux, qu’un objet médiatique parmi d’autres. J’appelle pour ma part «intellectuel» quelqu’un qui consacre sa vie à un travail de la pensée consistant notamment à comprendre et à mieux faire comprendre le monde dans lequel il vit. Je considère que ce travail est nécessaire, et que ceux qui accusent les intellectuels de disserter sur le sexe des anges au lieu de faire face aux «urgences» sont de tristes imbéciles. Il n’y a pas plus lieu de reprocher aux philosophes de «se borner» à faire de la philosophie que de reprocher aux médecins, aux peintres, aux informaticiens ou aux fleuristes de «se borner» à faire leur travail. Dans une société normale, on a besoin de tous les talents : une société uniquement composée d’intellectuels (ou de médecins, ou de peintres, ou d’informaticiens, etc.) serait évidemment tout à fait invivable !
François Bousquet : Quels ont été les grands tournants idéologiques de la Nouvelle Droite ? Peut-on dire qu’il y a eu un «moment Nietzsche»,un «moment Dumézil»,un «moment Heidegger»? Comment qualifier le «moment» actuel de la Nouvelle Droite ?
Alain de Benoist : On peut dire cela,mais on pourrait certainement identifier d’autres «moments» qui, de toute façon, ne peuvent pas être les mêmes pour chacun d’entre nous pris isolément. Pour ce qui me concerne, je pourrais aussi bien parler d’un «moment Rougier», d’un «moment Lupasco», d’un «moment Arnold Gehlen», d’un «moment Koestler», d’un «moment Freund», d’un «moment Louis Dumont», d’un «moment Althusius», d’un «moment Baudrillard», d’un «moment Christopher Lasch», etc. Mais ce ne sont là que des repères d’un itinéraire personnel. Si l’on regarde les choses plus objectivement, je pense que l’on pourrait périodiser l’histoire de la ND de la façon suivante : après une période de fondation, qui correspond pour moi à une rupture radicale avec l’horizon de pensée de l’extrême droite (et non, comme n’ont cessé de le dire ses adversaires, à une tentative de la doter de «nouveaux habits»), on a d’abord, durant les années 1970, une période d’exploration systématique du paysage idéologique, avec d’inévitables ambiguïtés, quelques flottements ou errements théoriques, des scories droitières qui se sont dissoutes progressivement. Cette période s’achève en même temps que l’expérience du Figaro-Magazine. Suit une période intermédiaire, allant jusqu’à la fondation de Krisis, en 1988, qui est surtout une période d’éclaircissements et de mises au point. À partir du début des années 1990 commence la période actuelle, qui est celle de la maturité. C’est aussi, je pense, celle durant laquelle la production intellectuelle de la ND a atteint son meilleur niveau. D’une façon générale, je dirais que l’évolution de notre courant de pensée s’est opérée dans le sens d’un approfondissement, tant en raison de sa dynamique interne que de la transformation du monde extérieur : comme je l’ai déjà dit, ceux qui croient que le même langage peut être tenu indépendamment des circonstances sociales-historiques sont de piètres penseurs. Cette périodisation est aussi celle qu’ont pu observer les chercheurs qui, en France et surtout à l’étranger, se sont le plus sérieusement penchés sur son histoire.
Michel Marmin : Chacun des acteurs de la ND en général et d’Éléments en particulier peut en effet baliser son itinéraire de «moments» différents, sans parler de ces «moments» intimes décisifs que peuvent fonder un livre (pour moi, ce fut le cas avec Don Quichotte, Les confessions de Rousseau, L’éducation sentimentale de Flaubert, Notre jeunesse de Péguy ou l’évangile de Luc, et ça l’est actuellement avec la lecture, exhaustive, continue, crayon en main, de À la recherche du temps perdu), un tableau, une pièce de musique, ces «moments» intimes n’étant pas sans rapport (comment pourrait-il en être autrement), quelle que soit la modalité du rapport (consonant ou dissonant), avec les «moments», extérieurs et publics, de la ND. Alain de Benoist en cite quelques-uns. Il en est un, parmi les plus récents, auquel j’attache une importance particulière : c’est le «moment ÉricWerner» dont les ouvrages et les articles (au premier chef ceux qu’il donne à Éléments et dans ce numéro même) ont ouvert des horizons inédits à la philosophie politique de la ND et lui ont apporté des propositions pleines de nuances, de scrupules, d’inquiétude et de culture. Les livres d’Éric Werner sont de ceux qui peuvent provoquer un choc, un ébranlement intérieur salutaire. C’est surtout vrai pour La maison de servitude, ça l’est plus encore pour le dernier, Portrait d’Éric, dont la délicatesse philosophique, la limpidité formelle, la profondeur et la sincérité rétrospective et introspective sont telles que l’auteur ne nous en voudra pas de prendre notre temps afin de tenter d’en dégager la substance pour nos lecteurs. Mais ceux-ci ne doivent pas attendre pour le lire : Portrait d’Éric est paru chez Xenia (et il ne leur en coûtera que 16 euros).
François Bousquet : Tout à fait d’accord avec toi. Sa «réplique au Grand Inquisiteur», La maison de servitude, est sans l’ombre d’un doute une grande lecture des évangiles, à la russe. On la retrouve dans L’évangile selon saint Matthieu de Pasolini, chez Tolstoï ou Ellul. Une lecture radicale. Mais comment ne le serait-elle pas pour celui qui lit les évangiles avec le cœur. Or, les chrétiens ont reçu ce livre avec un haussement d’épaules…
Michel Marmin : Dont acte…Il est vrai que, bien que rigoureusement athée, je me considère comme infiniment plus «chrétien» que la plupart des bons catholiques que j’ai rencontrés.
François Bousquet : Avec le recul, assumez-vous la totalité de l’héritage de la Nouvelle Droite ? Ou bien en rejetez-vous certaines parties ? Si oui, lesquelles ?
Alain de Benoist : Par principe, j’assume tout : nul n’est libre de changer son histoire ! Mais il y a certainement des orientations ou des prises de position qui se sont à l’expérience révélées plus pertinentes ou plus fécondes que d’autres. Ceux qui se flattent de ne rien regretter sont rarement ceux qui ne se sont jamais trompés,mais plutôt des psychorigides incapables de se remettre en question et de faire leur autocritique. Au début des années 1970, par exemple, j’ai écrit quelques textes sur l’écologie, le travail, la théorie de la connaissance, que j’ai tendance à regarder aujourd’hui comme tout à fait erronés. J’ai eu tort aussi d’employer le mot «nominalisme» dans un sens qui a été mal compris. De même, l’importance que la ND a attachée dans le passé à des problématiques comme celle du quotient intellectuel était sans doute excessive. Comme le disait Spengler, dans les affaires humaines, l’histoire prime les sciences naturelles ! Dans tout chemin de pensée, il y a ainsi des voies que l’on explore et qui se révèlent des impasses. Tout cela est naturel. Cela dit, quand on relit tout ce que nous avons produit au cours des quatre dernières décennies, on peut surtout constater que nous avons généralement eu raison avant les autres, et que nous avonsmême parfois été prophétiques. Je serais tenté de dire qu’au fil des années, la ND est tout simplement devenue adulte, dépassant et rejetant à la fois l’adolescentisme de droite (l’univers héroïque paternel des dieux et des héros) et l’infantilisme de gauche (l’univers fusionnel-maternel de l’indistinction sociale), qui ne sont pas seulement deux formes pré-oedipiennes du comportement,mais aussi deux conceptions de la vie foncièrement impolitiques. En France, la ND est une école de pensée sans aucun équivalent depuis plus d’un demi-siècle. Elle est d’ailleurs déjà entrée dans l’histoire des idées.
François Bousquet : Cela ne fait aucun doute. Raison de plus pour ne pas éluder ou minorer ce que la ND a été, de droite en l’occurrence (ce qu’elle a peut-être été plus encore par le style qui a longtemps été le sien – et en ces matières, il ne trompe guère). Or, je trouve que vous avez tendance à l’oublier…
Alain de Benoist : Pas du tout, puisque je viens au contraire de le rappeler. Il n’y a d’ailleurs rien de honteux à être ou avoir été «de droite»!
Michel Marmin : Nul n’est libre de changer son histoire, dit Alain de Benoist. Hélas ! suis-je tenté d’ajouter. J’ai personnellement adhéré sans réserve à tous les «moments» de la ND. Mais je dis franchement que je n’aime pas, avec le recul, le premier «moment», quand la ND, qui n’avait d’ailleurs pas encore été ainsi nommée, affichait une arrogance nietzschéo-darwinienne qui tenait sans doute beaucoup à la jeunesse de ses principaux acteurs. J’ai alors écrit dans Éléments des articles (enfin, deux ou trois) que je regrette d’avoir écrits et que je ne relis pas sans rougir. J’espère que, plus de trente ans après, il y a prescription…Mais le «gauchissement» de la ND est venu assez vite, et il n’a pas été sans entraîner des ruptures parfois violentes (mais rarement des ruptures personnelles, l’amitié, à droite, résistant plus facilement aux ruptures idéologiques qu’à gauche). Curieusement, c’est lorsque la ND a atteint au maximum de sa présence à droite, c’est-à-dire à l’époque du Figaro-Magazine, que j’ai pu contribuer à cette évolution, et cette évolution, je l’ai vécue comme une libération, comme un retour à ma vraie nature, que j’avais en somme «forcée». C’est en gros ce que j’ai essayé d’expliquer dans La pêche au brochet en Mai 1968. J’étais alors critique de cinéma au Figaro, et, loin de célébrer les films du système, comme on l’eût attendu d’un critique de droite, je plaidais pour le cinéma indépendant, voire d’avant-garde, pour les films du Tiers-monde, pour des documentaires on ne peut plus «gauchistes» sur la drogue ou l’immigration…Je n’ai évidemment pu tenir très longtemps. En fait, ce «gauchissement» s’est moins traduit par un rapprochement avec la gauche que par un éloignement de la droite. Je pense, j’espère, que cet éloignement est aujourd’hui consommé.
François Bousquet : Dans La pêche au brochet, tu résumais ainsi ta vision de 68: «Une abbaye de Thélème, légèrement actualisée par Wilhelm Reich». Pardonne-moi, mais avec Reich, on est à des années-lumière de Kant. Un personnage sympathique au demeurant, ce Reich, comme tout ce qui est délirant, et chez lui ça l’était superlativement, mais peut-on vraiment prendre au sérieux son pansexualisme et ses orgones sans une bonne dose de LSD? Pour le reste, on a l’impression qu’avoir été de droite constitue pour toi une expérience traumatisante, en tout cas malencontreuse et accidentelle. Comment te soignes-tu?
Michel Marmin : D’abord, une rectification. Je n’ai pas employé cette image rabelaisienne et reichienne pour résumer Mai 1968 ou la vision que j’en ai eue: elle se rapporte exclusivement à un minuscule projet utopique (entre les mille autres que l’époque a suscités) dans lequel j’ai trempé. Sinon, je partage ton point de vue sur Wilhelm Reich, surtout rétrospectivement,mais son délire,mêlé cependant de vraies intuitions, aura eu au moins le mérite d’inspirer l’un des films les plus rigolos de ces cinquante dernières années,W.R. Les mystères de l’organisme du cinéaste yougoslave Dusan Makavejev (1971). Pour le reste, je crois que tout engagement, quel qu’il soit, entraîne une mutilation, donc un traumatisme, à moins de n’être qu’une brute ou un simple. S’engager à droite, c’est inévitablement amputer ou refouler ce qui, en nous, est «de gauche». Je me suis soigné avec le retour du refoulé !
François Bousquet : Quel jugement portez-vous sur la vague identitaire qui déferle en Europe et qui, en France, emprunte certains thèmes, et non des moindres, à ce que fut la Nouvelle Droite dans les années 1970?
Alain de Benoist : Après la liberté et l’égalité, l’identité (individuelle ou collective) est aujourd’hui au centre des débats. C’est la raison pour laquelle j’ai consacré à ce thème un petit livre, Nous et les autres, dans lequel j’ai essayé d’approcher au plus près ce qu’il faut entendre sous ce terme. La «vague identitaire» dont tu parles ne me surprend donc pas,mais l’expression peut aujourd’hui désigner des choses très différentes. Dans plusieurs pays d’Europe, par exemple, la revendication identitaire s’associe à un plaidoyer ultra-libéral en faveur de la logique du marché, à une xénophobie agressive et à un populisme purement démagogique (on s’adresse certes directement au peuple,mais en continuant de parler en son nom au lieu de créer les conditions lui permettant de s’exprimer lui-même). Ma sympathie pour la cause identitaire s’arrête là où elle débouche sur la xénophobie et l’appel implicite à la guerre civile. En outre, je ne soutiendrai jamais un mouvement identitaire dont les positions en matière économique ou de politique étrangère iraient à l’encontre de ce que je pense. Je n’ai pas de sympathie particulière, par exemple, pour la Ligue du Nord italienne – phénomène atypique rigoureusement intransposable en France –, dont la ligne erratique a pour seule constante un mépris affiché pour la moindre «efficience» et la pauvreté des gens du Sud (le Sud commençant en l’espèce au nord de Rome). Je signalerai en revanche que le plus beau film identitaire de ces dernières années, c’est Le retour en Arménie du communiste Robert Guédiguian, ce dont la droite identitaire ne s’est apparemment pas aperçue.
Les idées voyagent et n’appartiennent à personne, même pas à ceux qui les ont émises. On peut donc faire l’usage que l’on veut de celles de la ND. Certains de ces usages, néanmoins, ressortissent en quelque chose de l’hommage du vice à la vertu, dans la mesure où ils déforment les idées qu’ils empruntent ou les réduisent à des slogans. De ceux qui viennent après nous, et prétendent se situer dans la même ligne, on attend qu’ils aillent plus loin qu’on n’a pu aller soi-même, non qu’ils régressent en figeant un corpus théorique auparavant vivant. Dans le récent débat avorté sur l’identité nationale, personne ne s’est montré spécialement brillant, faute de pouvoir conceptualiser cette notion. Ceux qui parlent le plus d’identité se contentent en général d’aligner des stéréotypes et de s’arc-bouter sur des moments supposés fondateurs d’une histoire idéalisée,moments retenus au demeurant de façon strictement sélective (Robespierre, pourtant, fait tout autant partie de l’identité française que Jeanne d’Arc). Mais l’identité, ce n’est pas le passé. Et surtout, ce n’est en rien un concept de l’ordre de la «mêmeté». Loin d’être ce qui en nous ne change jamais, l’identité est ce qui nous permet de changer sans cesse sans jamais cesser d’être nous-mêmes. Dans mon livre, je récuse toute approche essentialiste de l’identité, dont je rappelle au contraire la dimension fondamentalement dialogique (on n’a pas d’identité quand on est tout seuls). J’affirme aussi que ce qui menace l’identité d’un peuple c’est toujours moins l’identité d’un autre peuple que le système général de la modernité, ce «système à tuer les peuples» – tous les peuples – intrinsèquement destructeur de toute diversité. Certains croient que s’il n’y avait pas d’immigrés en France, nous retrouverions tout naturellement notre identité. Ils ne voient pas que cette identité a déjà été éradiquée par la société du profit généralisé, de la fausse conscience généralisée, du spectaculaire-marchand généralisé. Rendre possible la réappropriation autonome d’une identité collective, c’est d’abord contribuer à faire s’effondrer les mythologies fondatrices de la temporalité marchande, de la tyrannie du plaisir chosifié, de l’insignifiance mondaine, de la mystification même de la vie.
François Bousquet : L’essentialisme, la pétrification sont indiscutablement une des pathologies de l’identité, et plus spécialement d’une identité malade. Mais cette pathologie ne travaille les sociétés contemporaines qu’à la marge. Les Européens semblent aujourd’hui bien plus souffrir d’amnésie identitaire que d’hypermnésie.
Alain de Benoist : L’amnésie est la conséquence logique de la disparition des repères, et du fait que toutes les dimensions de la temporalité ont été rabattues sur l’instant présent. Cela dit, l’appel à la «mémoire» est toujours ambigu. Il peut aussi être paralysant : il suffit de voir comment le «devoir de mémoire» a été mis au service de la «repentance».On oublie trop, quand on cite la phrase de Nietzsche : «L’homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue», qu’aux yeux de Nietzsche l’«homme de l’avenir» se confond avec ce «dernier homme» qu’il exècre absolument. Pour Nietzsche, c’est l’oubli, non la mémoire, qui est la condition de l’«innocence» nécessaire à un nouveau commencement.
Michel Marmin : Ceux qui me connaissent et, éventuellement, me lisent savent combien je suis resté sensible aux liens charnels, à l'enracinement généalogique et local, et les identitaires auraient, à moi aussi, toute ma sympathie, s'ils n'avaient, comme je le crains, la vue obscurcie par la globalisation, qui n’est ni un bienfait ni un méfait,mais un fait, avec les flux de population qu’il entraîne et que ne manquera pas d’aggraver la catastrophe climatique qui ne fait que commencer. Moi aussi, il m’arrive de regretter le temps des lampes à huile et de lamarine à voile, et ce n’est pas, parfois, sans un serrement de coeur que je revois la France telle que l’avaient si joliment photographiée en noir et blanc les cinéastes des années 1950 (et telle que je l’ai connue) et, a fortiori, telle que l’on illustrée les frères de Limbourg dans Les très riches heures du duc de Berry…Mais les nostalgies ne sauraient fonder un projet politique, et celui des «identitaires»me paraît géométriquement voué à l’échec, nonobstant les succès marginaux qu’ils pourront obtenir çà et là en exploitant des peurs compréhensibles. Je ne suis sûr que de deux choses. La première, c'est que de la France que j'aime, celle sur laquelle s'est construite mon identité personnelle, il ne reste plus qu'un fantôme. La seconde, c'est que l'immigration et l'«islamisation» n'y sont pour rien. Elles sont, tout au plus, les conséquences d'un mal beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. Pour moi, l'identité de la France et l'identité de l'Europe n'ont plus à être «défendues», mais sont à réinventer en s'attaquant d'abord à la racine du mal. Lequel n'est pas seulement local, mais, je le répète, global.
Mais je dois préciser que certains «identitaires», ou prétendus tels, me font carrément horreur quand leur défense de l’identité nationale est en réalité le prétexte à l’expression, plus ou moins masquée, du racisme le plus répugnant et de la xénophobie la plus bête, ces vieux démons de l’extrême droite. Ils me font penser à ces nazis auxquels Jean Dujardin, dans le désopilant OSS 117. Rio ne répond plus, promet de donner un État pour eux tous seuls, dans des frontières sûres et reconnues…La question est alors de savoir si les «identitaires» y accepteraient les «Narbonoïdes dégénérés» et «négrifiés» (Louis-Ferdinand Céline) du sud de la Loire !
François Bousquet : Que le racisme soit vulgaire, cela ne fait aucun doute. Et meurtrier de surcroît. Mais c’était plus vrai hier qu’aujourd’hui, où il est criminalisé. Ce qui règne, en tout cas dans les sphères qui comptent, c’est un antiracisme angélique, un déni statistique de l’immigration et des positions moralement confortables (et compatibles avec ce confort moral).Mais je voudrais en revenir à la question qui me taraude depuis le début de cet entretien: ne faut-il pas choisir ? À un moment donné, il faut bien choisir, sauf à risquer le sort de l’âne de Buridan, qui meurt de faim, faute d’avoir su choisir entre le picotin d’avoine et le seau d’eau. J’ai toujours en tête la phrase de Lamartine, qui, ne voulant siéger ni à droite ni à gauche, siégeait au plafond. Siégeriez-vous à votre tour au plafond?
Alain de Benoist : Bien sûr qu’il faut choisir. Après le moment de la réflexion, doit venir le moment de la décision. C’est la raison pour laquelle j’ai de longue date insisté sur la notion d’«ennemi principal». C’est aussi la raison pour laquelle j’ai toujours trouvé absurde la position de ceux qui s’abstiennent de prendre position sur tel ou tel problème (qu’il s’agisse de l’évolution de l’Amérique latine ou de la situation en Palestine occupée) au motif que «cela ne nous concerne pas». Ce sont eux qui siègent au plafond: dans un monde globalisé, tout nous concerne. Mais encore faut-il distinguer entre le travail de la pensée proprement dit et le jugement qui s’exerce sur les circonstances concrètes. Dans le domaine des idées, le sens des nuances et la volonté de synthèse n’est pas un «refus de choisir». En outre, le «choix» entre deux abstractions aussi inconsistantes et obsolètes que «la droite» et «la gauche» ne mène nulle part. Tu dis que Lamartine ne voulait siéger «ni à droite ni à gauche». Moi, je ne suis pas dans la logique du «ni ni» (ou dans celle du «ou bien ou bien»),mais dans celle du «et et». Pour ce qui est des circonstances concrètes, en revanche, je crois que la ND – et tout particulièrement Éléments – ne s’est jamais abstenue de choisir. Que ce soit sur la construction européenne, la guerre en Irak ou en Afghanistan, la géopolitique, les rapports avec la Russie, la crise financière, les défis écologiques, les problèmes sociaux, la mise en place d’une société de surveillance, etc., elle a au contraire constamment tranché.
François Bousquet : L’islam vous paraît-il compatible avec la civilisation européenne, pour laquelle Éléments est censé œuvrer ?
Alain de Benoist : Telle que tu l’énonces, la question semble poser une hypothèse d’école. On n’en est plus là, puisque l’on compte aujourd’hui à peu près 54 millions de musulmans en Europe (bonne chance à ceux qui veulent les «mettre dehors»!). Ces musulmans ne sont pas tous des immigrés, tant s’en faut,mais l’immigration a bien entendu fortement contribué à en augmenter le nombre. Cette immigration, qui est une immigration de peuplement, a transformé en relativement peu de temps les sociétés européennes, non pas en sociétés «multiculturelles», comme on le répète un peu partout – elles sont au contraire de plus en plus monoculturelles, puisqu’elles baignent toutes dans l’unique culture de la marchandise –,mais en sociétés multi-ethniques. La critique de l’immigration, comme celle des pathologies sociales (grandissantes) qui en résultent, est tout à fait légitime, à condition de s’opérer sur d’autres bases que celles de la xénophobie et de l’exploitation des faits-divers. Éléments a dans le passé consacré un épais numéro à cette question, ce qui épargne d’avoir à y revenir. Le livre récent de la démographe Michèle Tribalat, Les yeux grands fermés, en constitue un utile complément. À mes yeux, l’immigration se définit d’abord comme l’armée de réserve du capital, sa fonction première étant d’exercer une pression à la baisse sur les salaires, avec le soutien implicite des tenants du «sans-papiérisme» (Besancenot est le meilleur allié du patronat).
Depuis quelques années, cependant, on constate que la critique de l’immigration a plus ou moins cédé la place à une critique de l’«islamisation». Ce glissement progressif, qui n’est pas fortuit, change radicalement le sens de la critique. Il était en effet possible de critiquer l’immigration sans nécessairement critiquer les immigrés, qui en sont aussi les victimes avant d’en être éventuellement les bénéficiaires. Avec la critique de l’«islamisation», c’est-à-dire du droit pour les musulmans de pratiquer leur culte et de faire reconnaître leur identité religieuse dans l’espace public, ce sont au contraire les musulmans qui sont stigmatisés en tant que tels. Ce que je trouve inacceptable.
Les trois religions monothéistes ont toutes été, à un moment ou un autre, des religions «immigrées» dans l’espace européen. Il est notoire que je n’ai personnellement pas de sympathie pour le monothéisme, dont j’ai au contraire constamment critiqué les fondements d’un point de vue philosophique. Mais critiquer une religion, ce n’est pas s’en prendre aux hommes. Dès l’instant où des musulmans vivent en Europe – qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore –, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas jouir en matière de culte des mêmes libertés à juste titre déjà reconnues aux chrétiens et aux juifs, aussi longtemps bien entendu que l’exercice de ces libertés ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la nécessaire loi commune. Ce qui ne veut pas dire que cela ne puisse pas poser des problèmes. Cela peut au contraire en poser, et il appartient alors aux pouvoirs publics de chercher à les régler. Si, par «islamisation», on entend en revanche le fait pour des non-musulmans de se voir imposer des pratiques islamiques, je trouve cela, bien entendu, tout aussi inacceptable. Mais pour l’instant, ce ne sont pas des séries islamiques que l’on voit tous les soirs à la télévision, ni des films islamiques qui envahissent nos écrans ! Je ne peux admettre, d’autre part, le lien constamment entretenu entre l’immigration et l’islam, puis entre l’islam et l’islamisme, enfin entre l’islamisme et le terrorisme : ce sont là des phénomènes contigus,mais différents. L’islam est la religion d’un milliard et demi de croyants, l’islamisme une forme radicalisée de l’islam (allant jusqu’aux aberrations salafistes ou wahhabites), le terrorisme islamique un phénomène politique sous habillage religieux enmême temps qu’une réaction convulsive contre le matérialisme occidental. Amalgamer le tout dans une dénonciation de l’immigration est une démarche confusionniste dont on ne voit que trop, dans le domaine géopolitique, à quelles puissances elle ne manquera pas de profiter. Qui a donc intérêt aujourd’hui à voir l’islam succéder à l’Union soviétique dans le rôle de l’empire du Mal ?
Traiter de l’immigration à partir d’une critique de l’islam est à mon avis la plus mauvaise façon de procéder. Croit-on vraiment que les problèmes de l’immigration vont se résoudre par l’athéisme, la police des costumes et le jambon? Par la castration «à la suisse» des trop phalliques minarets ? Que tout irait mieux si les jeunes immigrés désertaient les mosquées pour adopter le matérialisme pratique qui constitue déjà le mode de vie de tant de Français «de souche»? Denis Tillinac écrivait récemment : «Dans les familles musulmanes pratiquantes, on inculque aux jeunes des vertus plus nobles que l’appât du fric, le culte de soi et la vénération des idoles télévisuelles». Ce n’est pas faux. Pour ma part, d’ailleurs, je préférerais habiter près d’une mosquée plutôt que d’un centre commercial (ou avoir pour voisin un universitaire musulman plutôt qu’un skinhead) !
Les partisans de l’Algérie française nous expliquaient il y a cinquante ans que la France pouvait faire de tous les musulmans d’Algérie des «Français à part entière». Elle n’a même pas réussi à donner aux familles des harkis des conditions de vie décentes. Aujourd’hui, les marmitons de l’islamophobie, dont l’anti-islamisme reprend à son compte tous les clichés judéophobes du XIXe siècle, tout en se nourrissant des souvenirs de l’historiographie chrétienne, nous expliquent qu’on ne peut vivre en Europe en étant musulman, ce que font quand même déjà plus de 50 millions de personnes. L’islamophobie représente tous les musulmans en délinquants ou en terroristes potentiels, traitant tous ceux qui contestent cette approche de vendus, traîtres, résignés, candidats à la dhimmitude, etc. On ne va pas loin en procédant de la sorte. Au-delà des fantasmes de droite («La France va devenir une République islamique !») et de l’angélisme de gauche («On est tous citoyens du monde !»), au-delà aussi des «valeurs républicaines» et de l’anti-communautarisme convulsif dont se réclame une classe politique tout entière imprégnée de jacobinisme – de l’extrême droite à l’extrême gauche –, ce n’est pas à la religion des gens que je m’intéresse en priorité, ni même à leur lieu de naissance,mais aux valeurs dont ils se réclament, à ce qu’ils pensent et à ce qu’ils veulent faire. «Tous les hommes de qualité sont frères», écrivais-je déjà dans Les idées à l’endroit. Soit l’on cherche à réaliser le vivre-ensemble, aussi bien que cela est possible, soit l’on pousse à la guerre civile. Seul un grand projet collectif, un grand projet mobilisateur, serait susceptible de transformer tous les concitoyens en compatriotes. Je reconnais volontiers qu’on en est loin.
Michel Marmin : Je n’ai rien à ajouter à la conclusion d’Alain de Benoist. Je me permets tout de même de profiter de cette question pour faire un petit point d’histoire du cinéma. J’ai été le co-scénariste du premier film français à aborder franchement (c’est-à-dire avec franchise) la question de l’islam et de l’immigration, Pierre et Djemila de Gérard Blain, et qui plus est d’un point de vue à la fois empathique et réaliste (c’est-à-dire ne méconnaissant pas les souffrances, les pathologies et les conflits que l’immigration de masse n’a pas manqué de susciter). C’était il y a quasiment un quart de siècle (1987), et le film fut violemment attaqué à l’extrême droite (à cause de son empathie) et à l’extrême gauche (à cause de son réalisme), alors qu’il n’était que modestement prophétique. J’ai l’impression que rien n’a changé depuis, et que les réactions seraient aujourd’hui les mêmes… Comme quoi, et c’est tout le problème de la ND, il est très inconfortable d’être indépendant : le goût de la vérité et le souci de l’honnêteté exposent à bien des désagréments !
François Bousquet : Vous connaissant, j’aurais plutôt tendance à classer vos deux tempéraments dans la famille des pessimistes et du pessimisme – la condition de l’homme historique, du moins de droite (on n’en sort pas). Qu’en dites-vous ?
Alain de Benoist : Tu connais le mot de Bernanos : «Les optimistes sont des imbéciles heureux, les pessimistes des imbéciles malheureux». Le pessimisme de droite s’enracine dans une vision réaliste de la nature humaine : l’homme n’est pas un être «mauvais»,mais il est un être risqué, dynamique et dangereux (pour lui-même). Je n’ai rien à redire à cette vision. Sur ce sujet, il est aussi de coutume de citer Gramsci : «Pessimisme de l’intelligence, optimisme de la volonté». La formule pourrait être retournée.
François Bousquet : Ce que vous faites sert-il à quelque chose ?
Alain de Benoist : Voilà bien une question que je ne me pose pas, non parce qu’elle m’indiffère, mais parce qu’on ne pourra y répondre que dans cinquante ans ! J’ajoute que les préoccupations utilitaires ne sont pas mon fort. Je suis bien conscient de ce que la ND occupe une ligne de crête. Le travail qu’elle fait n’est pas facile, ni dans l’ordre de la pensée ni dans l’ordre de la pratique. Non seulement elle ne cherche pas à plaire, mais elle prend consciemment le risque de déplaire. Cela suscite parfois des incompréhensions. Cela lui vaut des critiques et des hostilités croisées, sans rien qui les compense. Amicus Plato, sed magis amica veritas («Ami de Platon,mais plus encore, ami de la vérité») : Cervantès place dans la bouche de Don Quichotte la célèbre phrase d’Aristote. Ce peut
être aussi unmot d’ordre.On essaie de faire lemieux possible ce pour quoi on pense être le plus fait. À partir de là, on fait ce que l’on croit nécessaire. C’est déjà bien. En d’autres temps, cela s’appelait faire son devoir.
Michel Marmin : Moi, je me la pose tout le temps, et, dans mes accès de déprime, je réponds : «à rien»…Mais je ne le pense pas véritablement. J’ai quatre petits-enfants, et je suis profondément convaincu que ce que nous faisons pourrait les aider à trouver leur voie, c’est-à-dire à penser par eux-mêmes dans un monde qui se pense de moins en moins et à ne pas fermer les yeux devant le réel, aussi effrayant et chaotique soit-il, eh bien ! Cela aura servi à quelque chose.